Accueil > Argumentaires > Édito > 2003, l’année terrible
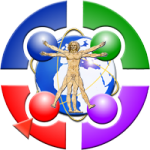 2003, l’année terrible
2003, l’année terrible
dimanche 14 avril 2002
Par là même, l’illusion d’une autorégulation des systèmes d’échanges et de paiements s’est dissipée, entraînant un retour en force des Etats dans le soutien de la conjoncture comme dans la conduite des politiques structurelles, ramenant le pouvoir du côté de la politique économique et non plus de celui des marchés (Etats-Unis en tête avec une action coordonnée de la politique monétaire et budgétaire, le recours au protectionnisme et à la dévaluation du dollar, le soutien direct des secteurs les plus touchés par les attentats du 11 septembre 2001).
Après la mise en place effective de l’euro en 2002, l’actuelle procédure budgétaire constitue ensuite, sur le plan européen, le premier test grandeur nature des institutions de l’Euroland, et notamment de la mécanique du pacte de stabilité destinée à coordonner les finances publiques des onze Etats membres.
Enfin, en l’absence de débat économique lors des élections présidentielle et législatives, la loi de finances pour 2003 fournit la première occasion de prendre connaissance et d’évaluer les priorités économiques et sociales du nouveau gouvernement.
Le budget pour 2003 doit donc être évalué au regard de trois critères : la crédibilité des hypothèses économiques et des comptes qui en résultent ; la cohérence de la politique économique dont il est la traduction ; l’impact sur le système de l’Euroland et, plus largement, sur les engagements européens de la France.
"Le mensonge n’est pas haïssable en lui-même, mais parce qu’on finit par y croire", soulignait Marcel Arland. Ainsi la bulle spéculative s’est-elle nourrie de la pseudo-norme du retour sur investissement de 15 %, érigée en loi d’airain du capitalisme dérégulé avant de disparaître avec le krach.
De même, le gouvernement français s’obstine contre toute raison à soutenir que le taux de croissance naturel de l’économie française s’élève à 3 % et qu’il ne sera que légèrement affecté à la baisse par la configuration redoutable d’un krach boursier mondial, des scandales comptables et financiers, du blocage du processus de mondialisation et de la perspective d’un conflit en Irak.
L’erreur est complète. Du point de vue des structures, le potentiel de croissance de l’économie française est limité à 1,5 %, ce qui correspond à un taux de chômage incompressible qui se situe entre 8,5 % et 9 % de la population active.
Ces performances ne peuvent être significativement améliorées que par une conjoncture exceptionnellement favorable (ce qui fut le cas de 1997 à 2000) ou par des réformes fondamentales du fonctionnement de l’Etat, des prélèvements fiscaux et sociaux, du marché et du droit du travail, de la protection sociale, réformes que l’ensemble de la classe politique s’accorde pour exclure.
A l’inverse, elles ont vocation à être très inférieures en cas de récession mondiale, ainsi qu’il fut observé en 1993 après la guerre du Golfe (croissance négative de – 1 %, chômage repassant de 9 % à 11,5 %, déficits publics dérapant entre 4 % et 5 % du PIB).
Or 2003 se présente comme une nouvelle année terrible. Avec une croissance de l’ordre de 1 %, hors l’hypothèse d’une guerre avec l’Irak qui, via la hausse du pétrole au-delà de 30 dollars le baril (contre une hypothèse de 25 dollars dans la loi de finances), ferait basculer l’économie mondiale et la France dans la récession.
Du côté de l’offre, le nombre des faillites est en train de doubler sous l’effet des contraintes de trésorerie liées aux 35 heures et à la suspension des crédits bancaires aux entreprises, tandis que les profits et les investissements régressent.
Du côté de la demande, les exportations sont en très fort recul (– 10 %) et la consommation est en passe de s’enrayer, sous l’effet de l’arrêt des créations d’emplois et de la hausse du chômage qui va toucher à nouveau 10 % de la population active.
Le constat est clair : en guise de déficit zéro pour 2004, la France va droit à la croissance zéro pour 2003. Ce qui, en termes de finances publiques, se traduira par un déficit compris entre 3,5 % et 3,8 % du PIB, très comparable à celui qui attend l’Allemagne et qui peut être estimé à 3,7 % du PIB contre 2,7 % officiellement.
Compte tenu des mécanismes cumulatifs des dépenses liées à la fonction publique (115 milliards d’euros), à la dette (38 milliards d’intérêts pour 880 milliards d’encours) et à la protection sociale (déficit de 6 à 7 milliards pour la seule assurance-maladie), comme de la chute des recettes fiscales liées à la baisse de l’activité, la France se trouve sur une tendance de déficit de 4 % à 5 % du PIB pour 2004.
Cela apparaît au reste parfaitement logique compte tenu de l’absence de changements fondamentaux dans la régulation de l’économie et dans la sphère publique (sinon la hausse de 10 % des effectifs de la fonction publique) depuis le début des années 1990.
Ce spectaculaire dérapage des finances publiques françaises ne constitue pas pour autant une faute de politique économique. Il est paradoxalement justifié par la gravité de la situation de l’économie mondiale que masquent des hypothèses de croissance irréalistes.
La crise des années 1930 montre que trois conditions doivent être réunies pour transformer le dégonflement d’une bulle spéculative en déflation mondiale : une politique monétaire restrictive ; une faillite en chaîne des banques ; une course aux barrières protectionnistes et aux dévaluations compétitives qui détruit le système des échanges et des paiements internationaux.
Aujourd’hui, ces trois conditions ne sont heureusement pas remplies dans leur totalité, mais les signaux d’alerte localisés ne manquent pas : le maintien d’une politique monétaire déflationniste par la BCE (qui n’a rien compris ni rien appris de la stag-déflation européenne du début des années 1990) ; la montée du risque systémique sur le secteur bancaire au Japon (créances douteuses équivalentes au PIB de l’Australie) mais aussi en Europe et aux Etats-Unis, ce qui se traduit par un début de credit crunch ; la conversion de l’administration Bush au protectionnisme et la dévaluation du dollar.
Dans ces conditions, une politique budgétaire de retour à l’équilibre, par ses effets déflationnistes, serait totalement contre-productive, y compris sur le plan des finances publiques puisqu’elle détruirait plus de recettes fiscales qu’elle ne réduirait les dépenses.
Il est par ailleurs juste de rappeler que le gouvernement agit sous la contrainte d’une situation financière très dégradée du fait du laxisme de la gauche plurielle (15 milliards d’euros de prélèvements supplémentaires de 1997 à 2002 intégralement affectés à la fonction publique).
Pour autant, il est permis de s’interroger sur le contenu du déficit, qui reflète l’absence d’une politique économique cohérente. Le déficit peut en effet être consacré à la modernisation des structures économiques ou sociales, ou aller à des dépenses improductives. C’est à ce second choix que s’est rangé le gouvernement, dans la continuité de ses prédécesseurs.
Le déclin économique de la France ne cesse de s’accélérer, avec un PIB désormais inférieur de 9 % à celui du Royaume-Uni (alors qu’il était de 25 % supérieur dans les années 1970), un PIB par tête qui la place au 12e rang en Europe et au 18e au sein de l’OCDE, un taux d’emploi de 58 % et un investissement stagnant depuis le début des années 1990.
Le problème français est donc d’abord un problème d’offre, lié aux politiques malthusiennes poursuivies par les différents gouvernements depuis la fin des années 1980, faites de déflation monétaire et fiscale, d’une part, d’éviction du travail par le jeu des préretraites et des 35 heures, d’autre part.
Une utilisation dynamique du déficit devrait donc s’articuler autour de deux volets : le renforcement de l’offre productive par une forte baisse des impôts (notamment les plus antiéconomiques tels l’impôt sur le revenu et l’ISF) et des charges, incitant à la mobilisation du travail et du capital ; la réorientation des dépenses publiques vers les investissements structurants générant de fortes externalités (transports, énergie, télécommunications...) et vers les secteurs d’avenir, au premier rang desquels la recherche.
Les Etats-Unis mènent actuellement ce type de politique, à travers 50 milliards de dollars de baisse d’impôts qui ont jusqu’à présent permis d’éviter la récession et des programmes massifs de soutien public à la recherche (38 milliards de dollars pour la défense, 27 pour la médecine...).
Or le budget 2003 a choisi de ne pas choisir en se privant de toute marge de manœuvre du fait de la non-réforme de l’Etat et en pratiquant le saupoudrage.
Les baisses d’impôts et de charges sont en définitive limitées et éclatées entre les ménages et les entreprises. Le caractère symbolique des suppressions d’emplois civils (1 089 sur 58 000 départs en retraite) entraîne une hausse des charges de la fonction publique de 2,5 milliards d’euros (dont 1,3 milliard pour les retraites, ce qui n’empêche pas un prélèvement de 830 millions sur le régime général de la CNAV, extraordinaire exemple de solidarité à rebours des salariés travaillant jusqu’à 65 ans vers les fonctionnaires retraités à partir de 60).
L’investissement civil, laminé de 4,7 milliards en 2002, ne progresse que de 650 millions d’euros en 2003. Dans le même temps, le budget de la recherche est soumis à d’importantes coupes.
L’argent public reste donc affecté en priorité à un certain nombre de clientèles et de corporations, et non pas orienté vers la restauration de la base productive de la nation.
D’un point de vue européen, le budget de la France pour 2003 apporte la démonstration du caractère pervers et inapplicable du pacte de stabilité. La France, mais aussi l’Allemagne et l’Italie (sauf manipulation de leurs comptes) dépasseront, sans doute largement, les 3 % de déficit en 2003 et ne seront nullement en situation d’équilibre en 2006. Cette mise en échec d’un mécanisme absurde sur le plan théorique (car ajoutant la déflation à la déflation) comme sur le plan pratique (la norme de 3 % est laxiste en période de haute croissance comme lors de la seconde moitié des années 1990 et dangereuse en période de crise) n’aurait rien que de très satisfaisant si elle ne laissait entier le problème de la conduite de la politique économique de l’Euroland.
Si le pacte de stabilité est absurde, il reste vrai qu’une discipline budgétaire est indispensable entre les onze membres, sauf à provoquer l’implosion à terme de la zone monétaire. Mais cette discipline ne peut être que politique, fondée autour d’un gouvernement économique de l’Euroland et non pas sur de pseudo-critères dont le degré de sérieux est équivalent à la défunte norme du retour sur investissement de 15 % du capital investi.
Deux conclusions en découlent. L’Euroland, confrontée à une crise majeure du capitalisme, ne peut rester davantage dénuée de toute capacité à définir et conduire une politique économique, et s’installer durablement dans le pire des compromis, expérimenté dans les années 1990, fondé sur une politique monétaire déflationniste et une politique budgétaire hors de tout contrôle. D’où l’absolue nécessité de réformer le statut de la BCE et de lui donner un contre-pouvoir politique, chargé notamment de la coordination des politiques budgétaires.
Seconde condition : la France, au-delà du choix de court terme qui consiste à laisser filer les déficits et une fois le risque de déflation conjuré, va se trouver inéluctablement confrontée d’ici à 2005, comme dans les années 1980, à un nouveau choix cardinal entre la poursuite de ses engagements européens – au premier rang desquels sa participation à l’Euroland – et l’immobilisme de ses structures corporatistes.
Sous 2003 pointent non seulement le spectre de 1993 – avec la récession – mais celui de 1983 – avec le tournant de la rigueur.
 Contrepoints
Contrepoints