Accueil > Argumentaires > Édito > Lumières, République : on liquide
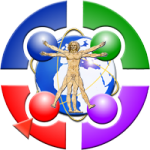 Lumières, République : on liquide
Lumières, République : on liquide
dimanche 14 avril 2002
Après deux semaines de guerre picrocholine, la signification de l’offensive menée à l’intérieur de la gauche sous la signature de Daniel Lindenberg et avec la bénédiction de Pierre Rosanvallon contre quelques intellectuels emblématiques commence à se découvrir. L’apparence était un pamphlet, assez mal ficelé – Daniel Lindenberg, avec ses Années souterraines, nous avait donné naguère beaucoup mieux –, contre les dérives « réactionnaires » d’une génération en rupture avec l’héritage de Mai 68.
Qui est « réactionnaire » ? Qui est « progressiste » ? Réflexions sur une passion française
La réalité est assez différente. Il s’agit d’une nouvelle querelle des Anciens et des Modernes, dans laquelle les Modernes, armés de la panoplie des sciences sociales, annoncent leur rupture avec un autre héritage, qui est, ni plus ni moins, celui des Lumières. L’ordre dont il est question dans le titre de l’article, Le Rappel à l’ordre, publié sous forme de livre par Daniel Lindenberg, n’est en aucune façon l’ordre moral, qui peut être, au surplus, de droite comme de gauche. Les « rappels à l’ordre » incriminés dans ce texte, et qui valent à leurs auteurs l’étiquette de réactionnaires, sont essentiellement ceux qui s’inscrivent dans la continuité de l’ordre républicain.
Lumières, République : on liquide. Tout doit disparaître. Tel est le message qui ressort d’un discours développé dans la plus extrême confusion.
Pour apporter un peu de clarté dans l’affaire, ni le réquisitoire ni même la défense, convenons-en, ne nous ont facilité la tâche. Le libelle est obscurci par le fait qu’il mélange, pour les besoins de sa démonstration, des écrivains d’humeur, comme Maurice Dantec et Michel Houellebecq, dont peu importe qu’ils soient ou non réactionnaires, avec des intellectuels, Régis Debray, Alain Finkielkraut, Marcel Gauchet, Pierre Manent ou Pierre-André Taguieff, qui sont de purs produits de la tradition républicaine.
En regard, la riposte flamboyante des stigmatisés s’est conclue sur un manifeste publié par L’Express, qui a plaidé la cause de la liberté d’expression de l’intellectuel. Cette réponse a consisté dans une mise en garde contre les procès d’intention « politiquement corrects », appuyés sur ces deux piliers de la langue de bois que sont le nominalisme et l’amalgame. Mais est-ce tellement là le danger qui nous menace ?
Une thèse fait florès en ce moment : nous assisterions à une radicalisation de la droite et de la gauche, avec réaction, racines et communautés d’un côté, et droits de l’homme, égalité, métissage, de l’autre. Un néo-maurrassisme, ou plutôt un néo-barrésisme à droite, contre un néo marxisme-léninisme à gauche. De part et d’autre de cette ligne de clivage, nous assisterions au passage de quelques transfuges de chaque camp. Une telle radicalisation est possible, encore que douteuse : la droite est beaucoup trop pragmatique pour cela, et la gauche, qui s’arme pour la prochaine élection présidentielle, ne commettra pas l’erreur de lâcher la bride aux groupuscules impatients de la remarxiser.
Le débat de fond auquel Pierre Rosanvallon voudrait apparemment attacher son nom est plus subtil. C’est un avatar, revu à la lumière des sciences sociales, de la querelle entre républicains et démocrates, qui remonte à 1989. Cette querelle oppose les tenants de l’individualisme universaliste hérité des Lumières aux adeptes du multiculturalisme identitaire. Ce qui rend le débat particulièrement complexe et sensible est qu’il divise de l’intérieur la droite et la gauche.
Nul ne sait, sinon les intéressés eux-mêmes, si Debray, Finkielkraut, Manent ou Taguieff sont de droite ou de gauche. Ce qui est sûr est qu’il faut n’avoir rien compris à l’histoire et à la géographie des mouvements d’idées dans notre pays pour prétendre que ceux-ci sont du côté de l’identitarisme et de la « réaction ». Il est vrai que chacun, à sa manière, s’inquiète, avec nombre d’autres, des dérives de la culture de masse, du « droit-de-l’hommisme », de l’égalitarisme et de l’islam. Cela n’en fait pas pour autant des « réactionnaires ». Le point de vue qui détermine leurs critiques est même rigoureusement inverse de celui qui leur est reproché.
Le procès du « droit-de-l’hommisme », par exemple, n’est en aucune façon celui des droits de l’homme. Contrairement à ce qu’affirme Daniel Lindenberg, son angle d’attaque se situe aux antipodes de la célèbre formule de Joseph de Maistre, l’un des pères de la contre-révolution, qui disait avoir rencontré des Anglais, des Espagnols, des Allemands, des Persans, mais n’avoir jamais rencontré l’Homme abstrait, avec majuscule, de sa vie. Le problème posé par les critiques du « droit-de-l’hommisme » est celui de la défense de droits particuliers, droits des minorités et des identités sexuelles, ethniques ou religieuses, au nom d’une conception pervertie, retournée contre elle-même, des droits universels de l’homme.
Les principes fondateurs de la construction politique des Lumières ne sont pas en effet des outils, adaptables et pour ainsi dire corvéables à merci selon la nature des problèmes à résoudre, comme on l’a vu, il y a deux ans, dans le débat sur la parité. Ils constituent un projet de libération de l’individu dont les éléments ne sont pas séparables. On ne peut séparer les droits de l’homme de la distinction entre Dieu et César, entre la loi et le droit, entre le droit et la morale, entre l’espace public et la sphère privée, entre le politique et le social, entre le social et le culturel, etc. Ce sont ces séparations qui fondent l’autonomie du citoyen responsable. Et c’est sur la pertinence de ce projet, sur la manière de le mettre en oeuvre et de hiérarchiser ses critères, que porte la réflexion de la plupart des philosophes visés par Daniel Lindenberg. Leurs réponses peuvent diverger, comme ce fut le cas à propos du conflit serbo-croate ou du Kosovo. Mais on est loin, avec une telle approche, de la thèse de la « réaction ».
Le danger du « droit-de-l’hommisme » est la tentation de répondre, en son nom, à des revendications de discriminations positives qui bafouent la simple dignité humaine. Par exemple, va-t-on accepter d’accorder aux Corses, comme le projet Jospin y tendait, la préférence nationale en matière d’emploi que l’on a toujours refusé de reconnaître sur le plan de l’ensemble du pays ? S’opposer à l’instauration d’un système aussi fortement négateur du principe de l’égalité de tous devant le droit, principe qui est la meilleure garantie de l’autorité de la loi, n’est pas, que l’on sache, de la « réaction ».
Il est, de même, deux manières de faire le procès de l’islam. L’une consiste à reprendre à son compte l’idée d’un conflit de civilisations, conflit à l’intérieur duquel l’Occident se place sous l’étendard de sa vieille tradition catholique. L’autre consiste à s’inquiéter, pour les sociétés libérales, quelles qu’elles soient, des offensives menées par les pratiquants de la religion musulmane contre les contraintes de la laïcité. Cette inquiétude, qui se place dans la perspective du projet émancipateur des Lumières, n’est pas, que l’on sache, de la « réaction ».
On pourrait multiplier les exemples à propos de l’articulation entre l’égalité et l’école, la résistance à l’oppression et la sûreté, la justice et la liberté. Ce qui compte, en l’occurrence, est la fidélité à un projet politique multiséculaire, qui est loin d’être achevé.
Or telle n’est pas du tout l’attitude de ceux qui, comme Pierre Rosanvallon, se placent du côté de la modernité. Leur perspective, qui est celle des sciences sociales, est un regard sans projet. Dans cette approche, les principes organisateurs de la société ne sont pas des valeurs hétéronomes dont les points d’application sont débattus par les élus et arrêtés par la loi. Ce sont des valeurs autonomes, endogènes à la société, qui font l’objet de délibérations publiques entre les groupes et qui sont médiatisées par les experts et par les juges.
Alors que pour les Anciens la maîtrise du processus historique repose sur l’éducation et sur les institutions, les Modernes, ou supposés tels, prennent appui sur la connaissance des rapports sociaux et sur la reconnaissance des forces en présence. Dans le phénomène de l’éducation de masses, par exemple, le paramètre clef est la réalité des masses. L’Ancien aura beau chercher un moyen de sauver la transmission des grands principes et de la culture, de façon à élever globalement ces masses, sans sacrifier ni le haut ni le bas de l’échelle, le Moderne répond que la priorité est de prendre en compte le nombre, et que tout le reste doit s’ensuivre : le pédagogisme, la révision des programmes vers un plus petit commun dénominateur, la reconnaissance des cultures, langues et pratiques minoritaires, etc. Un infini sépare ces deux regards.
Le Moderne prétend que l’idéologie n’est pas son fort. En réalité, il a substitué le social au politique. La foi dans la possibilité de formuler un savoir scientifique sur la société, de faire coïncider le bien, le juste et le vrai à partir d’une stricte observation des faits est son idéologie, et même son credo. A l’opposé de la philosophie des Anciens, cette logique, qui encourage l’éclatement de la société en communautés enracinées dans une foi et une culture, et placées en situation de négociation permanente les unes avec les autres, est la pourvoyeuse de l’ordre moral, qui est un mixte d’identitarisme idéologique et d’utilitarisme social.
Conservatrice par essence, puisqu’elle entérine les faits et se borne à en tirer les résultantes, c’est elle qui recueille, en fait, à droite l’héritage du maurrassisme et à gauche celui du marxisme-léninisme. Elle consacre la revanche de l’expert sur l’intellectuel. Elle triomphe dans les milieux universitaires. Elle fait impression sur les médias. Le pouvoir politique actuel lui résiste. Pour combien de temps ?
 Contrepoints
Contrepoints