Accueil > Argumentaires > Édito > Epître aux névrosés de l’antiaméricanisme
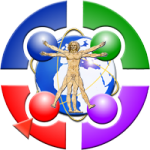 Epître aux névrosés de l’antiaméricanisme
Epître aux névrosés de l’antiaméricanisme
lundi 14 avril 2003
Défendre la mondialisation est devenu une gageure, mais se déclarer pro-Américain ou même "antiantiaméricain" — à l’instar des compagnons de route du marxisme qui se disaient autrefois "antianticommunistes" — relève de l’hérésie. Certes, à la différence des passionnés du multiculturalisme, des admirateurs des ONG ou des contempteurs de la globalisation, vous n’incarnez pas, vous les obsédés des l’antiaméricanisme, un nouveau conformisme. Nous pouvons vous rendre cette grâce : vous avez des quartiers de noblesse. Mais, hier présente dans le débat démocratique, votre opinion est devenue désormais irrésistible. C’est la lingua franca de toutes les élites. Et, d’ailleurs, ce qui constituait une exception française ne l’est plus. Vous avez des frères d’armes, non plus seulement dans le tiers-monde, mais dans tous les autres pays occidentaux et, au premier chef, en Allemagne. Certes, le 11 septembre vous a momentanément réduits au silence. Mais une fois passé le délai de décence, telle une corde trop longtemps tendue, vous vous êtes laissé aller avec une énergie et une violence décuplées. Pourquoi, me direz-vous, s’en prendre à une opinion ? Si vos thèses gagnent en influence, de quel droit leur jetterions-nous l’anathème ? Pour une raison et une seule que vous vous acharnez à nier : l’antiaméricanisme est le marqueur d’un inconscient antidémocratique. Vos victoires en mesurent l’avancée ; se soumettre à votre omniprésence, c’est accepter d’être gangrénés par un refus mezza voce de la démocratie.
Le raz de marée antiaméricain mesure, à sa manière, la persistance du pouvoir des élites traditionnelles — politiques, intellectuelles, journalistiques. Etonnant paradoxe. Vous entonnez souvent l’hymne du populisme ; vous jouez, au coeur du système, la comédie anti-élites. Or, vous vous livrez vis-à-vis de l’Amérique, à un tour de bonneteau : faire croire que vos positions ne font que traduire publiquement l’opinion du pays profond. Une étude détaillée, réalisée en mai 2000 à l’instigation de la Fondation franco-américaine, montre une réalité bien différente. 41% des Français déclarent éprouver de la sympathie pour les Etats-Unis, 9% seulement de l’antipathie et 50% s’affirment neutres. Poussés par des questions plus précises dans leur retranchement, les 9% d’antiaméricains ne font pas, eux, dans la nuance. Les seuls mots qu’ils emploient, à propos des Etats-Unis sont violence, inégalités, racisme et impérialisme ; ni liberté, ni jeunesse, ni dynamisme ne leur viennent par exemple à l’esprit. Ils ne reconnaissent aux Américains que deux supériorités : le maniement des nouvelles technologies et le fonctionnement des universités. Il s’agit sociologiquement de cadres moyens, de fonctionnaires, d’enseignants, donc d’une population de niveau universitaire élevé, sensible aux enjeux culturels et majoritairement de gauche : une parfaite caisse de résonance pour vous, les chefs du parti antiaméricain. Il existe, en revanche, une mouvance explicitement pro-américaine qui réunit 25% des Français : davantage de cadres supérieurs, d’individus ouverts aux vents du marché, votant plutôt à droite et tous pro-européens. Ainsi l’ouverture au monde ne connaît-elle pas de limite : dire oui à l’Europe, c’est aussi dire oui à l’Amérique. Ces Français-là sont extravertis : d’abord européens d’esprit, ensuite pro-occidentaux, enfin ouverts à la globalisation dans son ensemble. Si nous étions aussi militants que vous, aussi toniques, aussi inventifs, ils devraient être nos meilleurs soutiens, mais notre pusillanimité, notre démission nous empêchent de les mobiliser. Le succès de L’Obsession antiaméricaine (1) témoigne de leur attente : ils attendent de la franchise, du courage et du talent.
Quant au reste de la population, il se partage suivant les mots bizarres de l’enquête entre 50% d’"indifférents pragmatiques" et 15% de "rivaux sympathiques", c’est-à-dire d’individus ayant le sentiment que l’Europe est en concurrence avec les Etats-Unis mais regardant néanmoins ceux-ci avec bonhomie. Quant aux "indifférents pragmatiques", s’ils se sont sentis solidaires le 11 septembre des Américains, ils basculeront contre eux, à la moindre occasion. C’est, pour vous, une armée de réserve qu’une administration réactionnaire à Washington peut inconsciemment vous aider à mobiliser. Cette enquête sociologique n’est naturellement pas la vérité révélée, mais elle a le mérite de dessiner une France différente de l’image que vous réussissez à en projeter.
C’est donc, a contrario, la puissance du parti antiaméricain, c’est-à-dire la vôtre, qu’elle met en exergue. Vous vous êtes approprié le monopole de l’expression collective. Parmi les "fabricants de l’opinion publique" règne en effet un quasi-unanimisme dans l’antiaméricanisme, même si on y trouve un arc-en-ciel de nuances. Des plus violents qui voient dans Washington l’empire du mal, partageant sans l’avouer et à partir d’un itinéraire idéologique différent, les sentiments des mollahs de Téhéran, jusqu’aux modérés, respectueux des valeurs de la société américaine mais convaincus des effets nocifs de l’hyperpuissance, en passant par toutes les formes intermédiaires de réticences, les unes héritées du tiers-mondisme, les autres du gaullisme, les dernières d’une simple attitude réflexe. Novation majeure : les socialistes et les démocrates-chrétiens ne sont plus les têtes de pont du camp pro-américain, comme ils l’ont été pendant toute la guerre froide, de sorte que, sur l’échiquier politique, le rapport de forces a basculé sans conteste en faveur des antiaméricains. Encore votre emprise sur le monde politique est-elle plus faible que dans l’intelligentsia ou la classe journalistique : trouver désormais un intellectuel ou un journaliste qui affirme, perinde ac cadaver, sa solidarité avec les Américains relève de la gageure. En témoigne l’attitude, dans ces milieux-là, vis-à-vis de l’administration Bush. Lorsque les mêmes ou leurs prédécesseurs s’en prenaient, il y a vingt ans, au gouvernement Thatcher, ils ne tombaient naturellement pas dans l’anglophobie : bien au contraire, ils n’avaient de cesse de réaffirmer leur anglophilie. Vis-à-vis des Etats-Unis, le glissement est en revanche insidieux et permanent, comme si le gouvernement de Washington exprimait à lui l’identité politique du pays.
Nous ne nous sommes pas remis, nous Français, de la disparition de la rente que la guerre froide nous a offerte pendant un demi-siècle. La posture gaulliste — engranger les avantages de la garantie américaine, jouer la partition de l’indépendance — répondait à nos aspirations profondes et, hormis les communistes, les antiaméricains mettaient une sourdine à l’égard d’un pays dont les fusées intercontinentales nous protégeaient. Cette corde de rappel a disparu : nous pouvons vous imputer nos frustrations et les signes de notre mal-être. Or, ceux-ci ne datent pas d’hier ; ils plongent leurs racines dans notre histoire idéologique.
Il existe, depuis des lustres, autant de formes d’antiaméricanisme que de matrices culturelles (2). Vous pouvez donc jouer sur un spectre sans limite. Vous faut-il tabler sur l’antiaméricanisme de droite ? Vous trouverez maintes références à l’instar de celles, corsées, de Georges Duhamel : "Le machinisme américain... une civilisation d’insectes avec pour seul génie, celui de la ruche ou de la termitière... des créatures misérables, ahuries par leurs besognes ou leurs soucis...". Pour ceux-là, les Etats-Unis sont la négation d’une nation telle qu’ils la rêvent : homogène, identitaire, accrochée à ses racines, à une terre "qui, elle, ne ment pas".
Choisissez-vous la version libérale ? Il vous suffit de relire André Siegfried : "L’Amérique n’a rien à ménager, ni personne : elle peut, s’il lui plaît, se comporter arbitrairement : étrangler les gens et les gouvernements, les secourir à des conditions choisies par elle-même, les contrôler, enfin — chose qu’elle aime par-dessus tout — les juger du haut d’une supériorité morale et leur imposer ses leçons".
Voulez-vous la variante catholique ? A gauche, elle est frappée au coin de la haine de l’argent. Mounier n’y allait pas avec le dos de la cuiller : "le pays le plus immoral au monde, asservi au pouvoir de l’argent qui lui tient lieu d’âme... une barbarie qui menace toute civilisation humaine." A droite, elle préfère rejeter le modèle même de la civilisation américaine. Ainsi Georges Bernanos : "Nous comprenons de plus en plus clairement que la contre-civilisation [i.e. américaine], cette civilisation de masse, ne saurait poursuivre son évolution vers la servitude universelle sans d’abord achever de liquider l’Europe".
Préférez-vous l’antiaméricanisme d’extrême gauche ? Vous pouvez choisir la version classiquement anti-impérialiste, née aux côtés du communisme, passée par les couleurs multiples du tiers-mondisme, frappée à l’effigie de Guevara, de Nasser ou de Nehru, et désormais réinterprétée sur le seul thème du combat contre l’hyperpuissance. Mais il vous est aussi loisible de privilégier une approche plus culturelle qui mêlera le refus, au nom de notre propre "exception", de la civilisation Coca-Cola, de l’impérialisme d’Hollywood et d’un sabir qui ne saurait tenir lieu de langue. Toujours à l’extrême gauche, vous pouvez aussi entamer un hymne antimondialisation qui vous amènera naturellement à montrer du doigt le chef d’orchestre, c’est-à-dire le gouvernement de Washington, et ses fidèles choristes, les multinationales tout à sa dévotion.
La sophistication de la culture politique française vous offrira mille et une autre formes d’antiaméricanisme.Par exemple la filiation républicaine et nationaliste, modèle Régie Debray ou Max Gallo, fondée sur le postulat que la France ne peut affirmer son existence que sur le refus d’autrui ; or seuls les Etats-Unis peuvent jouer le rôle dévolu sous la IIIe République à l’Allemagne. Ou le rameau plus authentiquement xénophobe au sein de la même famille qui avait permis, en son temps, à Jean-Pierre Chevènement de transformer en injure l’expression de "gauche américaine". Ou encore la tradition gaulliste dure, forte du souvenir des avanies réservées par Roosevelt à de Gaulle, de la trop longue présence de l’amiral Leahy à Vichy et de la volonté d’imposer l’Amgot (3) à la France libérée. A moins de préférer l’héritage gaulliste "louis-philippard", tendance Pompidou, trouvant les Etats-Unis patauds ou encombrants. Il existe même une philosophie gaulliste pro-européenne, convaincue que l’Europe a besoin, pour se construire, d’un repoussoir et que l’Union soviétique disparue, les Etats-Unis remplissent heureusement le rôle de bouc émissaire.
Vue à cette aune-là, la scène idéologique n’offre aux pro-Américains que de rares interstices et encore les occupent-ils, chaque jour, avec une circonspection croissante. Ils ont certes assumé leurs choix sans état d’âme après le 11 septembre, mais leur position de force s’est dissoute au rythme des premières difficultés et maladresses de la campagne d’Afghanistan. Plus important : l’antiaméricanisme ne relève plus de la seule exception française. Sans doute nos voisins ne peuvent-ils pas offrir un kaléidoscope aussi large que le nôtre, mais quelques traditions sont d’ores et déjà à l’oeuvre en Allemagne, en Scandinavie, en Espagne ou en Italie : elles correspondent pour l’essentiel, aux ressorts de l’antiaméricanisme d’extrême gauche — anti-économie de marché, anti-impérialisme, antiprogrès économique, anti-multinationales —, ce qui met nos voisins à l’unisson des mouvements hostiles aux Etats-Unis, tels qu’ils se manifestent dans le tiers-monde et en particulier dans le monde arabe. Comment nous ferions vous grief de tirer argument d’un tel panorama ? La pensée unique n’est pas, une fois de plus, celle que certains de vos amis ont décrite : pro-libérale, pro-européenne, pro-américaine. Elle est, du moins chez les faiseurs d’opinion, anti-américaine. Or nos sociétés ne sont guère démocratiques sur le terrain idéologique : celui-ci est occupé par les élites et non par des mouvements souterrains de l’opinion publique. Votre avantage est donc incommensurable.
Que vos positions soient fondées sur une méconnaissance complète, consciente ou non, des Etats-Unis, nul n’en a cure et surtout pas vous. Peut-être protégez-vous, par prudence, votre ignorance car vous devinez que, mieux informés, vous auriez du mal à défendre des inepties comme autant de vérités révélées. Ainsi parlez-vous du monde américain comme d’un univers monolitique, à l’instar autrefois des observateurs des pays de l’Est décrivant l’Union soviétique. Vous pratiquez, de ce point de vue, le même aveuglement — peut-être n’est-ce pas un hasard — que les antisionistes à l’égard d’Israël : refusant de dissocier le gouvernement de Jérusalem et le pays, ils critiquent le second à la place du premier, ce qui les conduit à le délégitimer, donc à mettre en causse le principe de son existence. De votre côté, vous profitez de la présence à Washington de l’aile dure du camp républicain pour faire de sa politique le dessein historique, à vos yeux, des Etats-Unis.
C’est faire fi de la violence des clivages idéologiques : l’Amérique du Nord n’est pas, contrairement à la vulgate, une terre de consensus. Les différences entre les administrations Bush et Clinton sont infiniment plus fortes qu’entre Jospin et Raffarin, Schröder et Stoiber, Gonzales et Aznar. Pour la première, l’hyperpuissance crée des droits vis-à-vis du monde entier, pour la seconde des devoirs : la divergence n’est pas mince. Mais vous préférez faire fi de l’intensité des débats au sein de la société civile américaine dont le spectre politique va d’une extrême gauche, même si elle ne s’intitule pas de la sorte, plus radicale que la nôtre, à une extrême droite qui, elle, accepte de porter ce nom et qui est beaucoup plus réactionnaire et fascisante que Le Pen. N’oubliez pas que la victoire de George W. Bush résultait moins du décompte des voix en Floride que de la présence, dans la compétition, de Nader, ce Bové américain qui avait pris délibérément le risque de faire perdre Al Gore. C’est aussi faire abstraction d’un système de pouvoirs et de contre-pouvoirs qui interdit, presque par définition, tout unanimisme et va à rebours de la vision totalitaire avec laquelle vous jouez. C’est enfin ignorer une tradition historique qui a transformé les Etats-Unis en une puissance impériale, bien davantage qu’impérialiste. Impériale : la domination ne résulte pas d’un projet construit de longue main et élaboré à cette seule fin. Impérialisme : l’intention prime ; la volonté de puissance est constitutive du pouvoir.
Comment oublier, de ce point de vue, le concours de circonstances qui a conduit les Etats-Unis à intervenir en 1917 en Europe, la nécessité de Pearl Harbor qui a seule permis à Roosevelt d’entrer en 1941 dans la guerre, la manière dont le stalinisme a mis Washington en demeure de mener la guerre froide et de la gagner ? Bref, comment ignorer le sentiment d’agression que les Américains doivent ressentir avant de sortir de leur incoercible isolationnisme ? Mon propos n’est pas angélique ; il ne s’applique évidemment pas à l’arrière-cour d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, dans laquelle Washington s’est comporté, pendant des décennies, comme s’il voulait donner raison à vos pires critiques. Mais sur le reste de la scène internationale, la partie ne s’est pas jouée comme vous faites semblant de le croire avec des Etats-Unis omniprésents, manipulateurs et aux aguets. On pourrait presque les décrire au contraire comme systématiquement pusillanimes, patauds, empêtrés : Gulliver enchaîné. Ce n’est certes pas avec cette image-là que vous mobiliserez vos troupes. Vous vivez, pour les besoins de votre cause, avec une vision décalée du monde américain ; vous le croyez encore dominé par les "wasp", dirigé depuis la côté Est, religieusement mystique et tourné vers l’Occident. Vous passez par pertes et profits l’apparition d’élites noires, l’incroyable syncrétisme de cette société, son "asiatisation" sur la côte Ouest, son "hispanisation" dans les Etats du Sud, sa capacité d’absorber et d’ingurgiter des populations venues du monde entier. Vus sous cet angle-là, les Etats-Unis sont moins les maîtres du monde que leur image, leur préfiguration, voire leur caricature. Ce qui est possible outre-Atlantique l’est-il chez nous ? Non, car notre système, nos traditions, notre culture sont trop rigides : le communautarisme les ferait exploser.
Pratiquer dans ce contexte l’antiaméricanisme, c’est renouer avec la critique de la modernité, c’est retrouver le sillage d’Heidegger et comme lui dénoncer, à travers l’Amérique, "l’invasion du démoniaque au sens de la malveillance", l’univers de l’uniformité, la décadence de l’esprit, bref la dégénérescence de la civilisation. Cet antiaméricanisme-là, il est loisible de le combattre ou de l’accepter ; il a une vraie cohérence intellectuelle : nul n’est obligé de faire sienne l’évolution contemporaine. Mais la dialectique à mener, le jeu critique sont autrement plus complexes que la simple satanisation de l’adversaire. Le vrai débat est là : un modèle de société contre un autre. La place dévolue alors au manichéisme se restreint. Il existe dans votre coalition hétéroclite des intellectuels qui ont choisi cette posture, mais ils apparaissent bien minoritaires à côté des "antiaméricains primaires".
Le sociologue Richard Senett a donné une jolie définition, de ce point de vue, de l’antiaméricanisme : c’est mépriser les Américains plus qu’ils ne le méritent ! Car il n’y a pas pires critiques de l’american way of life que les intellectuels new-yorkais, plus méchants dénonciateurs de l’inculture américaine que les aristocrates de la New York Review of Books, plus sceptiques observateurs du cinéma d’Hollywood que les grands critiques spécialisés du New York Times ou du Los Angeles Times, plus violents analystes du théâtre politique washingtonien que les éditorialistes du Post, plus agressifs contempteurs du culte du profit que certains grands cénacles universitaires, plus lucides témoins de l’affirmative action que les meilleures écoles sociologiques du pays, plus virulents accusateurs de la raison d’Etat revue et corrigée sur le mode kissingérien que les innombrables chercheurs des think tanks stratégiques, plus combatifs adversaires du gouvernement en place qu’une presse ignorante des règles d’autocensure familières en Europe, plus décidés opposants aux multinationales que les mouvements consuméristes ou écologiques locaux...
Ne gommez pas cette réalité-là au nom de l’unanimisme apparu depuis le 11 septembre. Ce n’est pas aux Etats-Unis qu’a été inventé le mythe passe-partout de l’"union nationale". Les plus nationalistes de votre aréopage sont, sur ce terrain-là, les plus mal placés : n’ayant que cette idée-là à la bouche, ne rêvant que de fusion des classes sociales au service du mythe républicain, se rapassant tel un vieux film muet les émotions de la "levée en masse", ils ne peuvent condamner outre-atlantique ce qu’ils rêveraient d’accomplir de ce côté-ci de l’océan. N’oubliez pas que l’opinion publique américaine a obtenu la cessation des hostilités au Vietnam, le gouvernement n’ayant eu d’autre solution que de capituler devant elle, alors que la paix en Algérie a été un choix politique de de Gaulle, bien davantage que le résultat des irrésistibles mouvements de la société civile. Sortez des images d’Epinal.
Ne tirez pas, non plus, prétexte, à l’excès, des rodomontades de l’administration Bush. Que le retour d’un unilatéralisme arrogant, depuis le refus du protocole de Kyoto jusqu’à la mise en place retardée de la Cour pénale internationale soit insupportable, c’est une évidence. Que les antiennes sur l’"axe du Mal" — Irak - Iran - Corée — relèvent de raccourcis stratégiques étourdissants, c’est une réalité avec laquelle il nous faut malheureusement compter. Que certaines dispositions législatives votées au lendemain du 11 septembre bafouent la pratique la plus usuelle des droits de l’homme, c’est un fait regrettable. Que Washington utilise les ficelles politiciennes les plus éculées pour capitaliser l’émotion postérieure aux attentats, c’est une attitude qui ne doit guère surprendre. Que l’indifférence à l’Europe soit à la mesure de la sympathie éprouvée à l’égard de la Russie de Poutine, c’est une donnée géostratégique à laquelle nous devons nous habituer. Que l’administration américaine joue les prophètes en matière de libre-échange et, du même mouvement, prenne les mesures les plus banalement protectionnistes, c’est une hypocrisie dont nous sommes familiers. Mais ce ne sont que les erreurs et les ratés d’un médiocre gouvernement. Or, à vous entendre, on croirait que George W. Bush est un héritier de Gengis Khan mâtiné de Staline, Rumsfled une résurrection de Molotov, John Ashcroft, le fils adoptif de Beria. Et encore votre délire verbal n’est-il pas inspiré par la seule administration actuelle. Au moment du conflit du Kosovo, on croyait rêver en écoutant certains de vos amis, Régis Debray en tête, parler de l’administration Clinton et de son chef, ce baptiste plutôt bien intentionné, comme d’un aréopage monstrueux dirigé par un psychopathe.
L’antiaméricanisme suscite des bouffées de haine, des écarts de langage, une violence qui ne laissent pas de surprendre, venant d’esprits en principe sophistiqués. On peut comprendre la schizophrénie des jeunes, dans les rues du Caire : chaussés de Nike, une canette de Coca-Cola à la main, "accros" des séries télévisées importées à bas coûts des Etats-Unis et brûlant le drapeau américain. Mais ce genre d’attitude est plus étonnant de la part de Régis Debray, Max Gallo, Jean-François Kahn, Jean Baudrillard, Paul-Marie de la Gorce. Notre bonne vieille éducation enseigne en théorie la retenue et la mesure. Or leur antiaméricanisme est au moins aussi agressif que l’était l’anticommunisme dans les années cinquante, alors que — peut-être en conviendrez vous — le Washington d’aujourd’hui ne peut guère être comparé au Moscou d’alors. De même s’étonnerait-on, en relisant les textes antinazis des intellectuels français dans les années trente, de constater leur modération au regard des philippiques antiaméricaines publiées aujourd’hui à longueur de pages dans la presse française. L’enjeu n’était pourtant pas le même. Si la passion antiaméricaine n’est plus, je le redis, une exception française, ses manifestations idéologiques sont, à l’étranger, plus sereines : elles demeurent dans les proportions normales de la critique. Votre degré de haine est donc tellement excessif qu’il en devient troublant. Quel en est l’"impensé" ? L’hostilité vis-à-vis d’un pays qui s’identifie, de manière quasi ontologique, à la modernité et au progrès ? Le rejet d’une société métissée, aux ressorts si éloignés des nôtres ? La répulsion devant la toute-puissance culturelle et linguistique ? On pourrait aligner les explications rationnelles : même ajoutées les unes aux autres, elles ne répondent pas à la question. Reste l’énigme de cet "impensé" que vous illustrez.
Or la question est d’autant plus légitime qu’il existe une dimension de l’antiaméricanisme, toujours tue, mais essentielle. Elle témoigne d’un refus, explicite ou latent, de la démocratie. Formulons la chose autrement : aucun démocrate ne peut être viscéralement antiaméricain. Je n’en déduis pas, par un jeu de balancier, que tout antiaméricain serait viscéralement antidémocrate, mais vous entrez, de gré ou de force, dans une zone dangereuse. S’ajoute le fait que tous les antidémocrates affichés sont antiaméricains et il n’existe à cette règle-là aucune exception : ni à gauche, ni à droite, ni ailleurs... Les mots ne sont jamais gratuits : avec la distinction qu’il avait faite entre républicains et démocrates, Régis Debray tournait autour de cette réalité. Ses démocrates étaient pro-européens et pro-américains ; ses républicains tous antiaméricains ; ils n’étaient vaguement pro-européens qu’à la seule condition que leur Europe soit hostile aux Etats-Unis.
Vous allez vous insurger, protester de vos principes libéraux, refuser ce procès d’intention, y voir l’aveur de la mauvaise foi des pro-Américains, prétendre qu’un tel mode de raisonnement témoigne de notre part, d’une absence de réflexes démocratiques... Comment nier, certes, que l’écrasante majorité d’entre vous est, en période tranquille, banalement démocrae, c’est-à-dire qu’elle accepte la loi du suffrage universel ? Mais si la définition de la démocratie se veut plus ambitieuse, donc fondée sur un double critère — le suffrage universel et l’intensité des mécanismes de pouvoir et contre-pouvoirs —, le jeu se complique. Peu, au sein de votre hétéroclite coalition, ne font leur cette définition, voire peut-être aucun. La divergence est là éclatante. Si les Anglais ont inventé l’habeas corpus, les Américains ont, eux, créé les checks and balances. Rien n’est plus contemporain, de ce point de vue, que les débats constitutionnels entre les "pères fondateurs", Hamilton et Madison, Jefferson et Adams. Se ce genre de discussion échappe à votre entendement, si vous préférez côté gauche la filiation rousseauiste, côté droit, l’héritage de Joseph de Maistre ou Bonald, vous ne pouvez, sur les enjeux actuels, qu’être antiaméricains. Dis-moi qui tu révères, je te dirai qui tu es : ce vieux principe de la vie en société n’est pas mort.
Celui qui ne voit pas dans l’incessant perfectionnement des pouvoirs et des contre-pouvoirs la quintessence de la démocratie ne peut comprendre pourquoi un démocrate ne sera jamais antiaméricain. Je devine votre contre-attaque : si un démocrate, au sens où le mot vient d’être défini, ne peut céder aux pulsions de l’antiaméricanisme, de quel droit déduire qu’un antiaméricain risque de devenir un adversaire de la démocratie ? La vérité est autre : les pro-Américains ne se sont jamais compromis avec des ennemis de la démocratie, mais l’inverse n’est pas vrai : tout antiaméricain a flirté, au nom du combat anti-impérialiste, avec des individus ou des mouvements qui ont eu maille à partir avec les principes démocratiques. Inutile de mettre en avant le Chili, le Panama, les coups d’Etat fomentés par la CIA, les connivences passées avec des dictatures pitoyable, le soutien cynique de Washington à des régimes autoritaires : considérer que les Etats-Unis demeurent une démocratie exemplaire ne signifie pas soutenir leur gouvernement dans ses faux-pas, ses erreurs tragiques ou ses maladresses. Le système américain rime avec l’idée de démocratie et donc il sait, mieux que quiconque, qu’épouser ses principes philosophiques ne signifie pas endosser la politique du gouvernement en place.
Autorisez-moi enfin, au-delà de ces jeux d’escrime, un procès d’intention en bonne et due forme. Les membres de la tribu antiaméricaine sont des citoyens paisibles par temps calme, respectueux du suffrage universel et des libertés républicaines. J’ai la conviction — veuillez me le pardonner — que, par grosse tempête, nombre d’entre eux tomberaient du mauvais côté, car leur attachement aux principes démocratiques n’est pas ancré dans le culte des pouvoirs et contre-pouvoirs. Aussi s’accomoderaient-ils plus aisément de quelques entorses aux libertés fondamentales. Sans vouloir céder au goût dangereux des parallèles historiques, les pro-Américains n’avaient pas, en 1940, Vichy pour villégiature ; la grande majorité des anti-américains, eux, y résidaient. Rien de pareil ne nous menace heureusement, mais postuler la fin de l’Histoire, c’est-à-dire la quiétude universelle et l’absence de mauvaises surprises, y compris dans nos pays repus et douillets, me semble bien hasardeux. Cela donne le droit, face à tel ou tel adversaire, de se demander comment il tiendrait face à un orage historique. Les antiaméricains ne me paraissent pas offrir une assurance tous risques. Il y aurait, à coup sûr, parmi vous, des individus admirables et je veux, par politesse, supposer que tous mes adversaires idéologiques, ceux avec lesquels je ne cesse de rompre des lances, se comporteraient avec courage... Mais, comme corps constitué, vous m’inquiéteriez dans un contexte d’extrême tension. Voilà les choses dites : peut-être traduisent-elles, de ma part, préjugés et fantasmes. Je ne le crois pas. Si l’anticommunisme était, à en croire Sartre, le socialisme des imbéciles, l’antiaméricanisme est à la fois le gauchisme des crétins et le nationalisme des niais.
Notes
1 : Jean-François Revel, L’Obsession antiaméricaine : son fonctionnement, ses causes, ses inconséquences, Plon, 2002. Voir le long extrait que Catallaxia consacre à cet ouvrage.
2 : Philippe Roger, L’ennemi américain, Le Seuil, 2002.
3 : Administration américaine pour les territoires libérés que le gouvernement Roosevelt pensait mettre en place en France jusqu’aux élections, niant, de ce fait, la légitimité de De Gaulle pour gouverner.
 Contrepoints
Contrepoints