Accueil > Société > Collectivités locales et décentralisation > Centralisme et fédéralisme
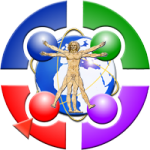 Centralisme et fédéralisme
Centralisme et fédéralisme
dimanche 18 avril 2004
Un retour aux grands Anciens s’avère nécessaire : Tocqueville disait, dans De la démocratie en Amérique, qu’il n’était pas sérieux de mettre sur le même plan la passion féroce, absolue, dévorante, de l’égalité, avec l’aspiration toujours essoufflée de la liberté qui, tel le coureur de fond, nécessite un combat de tous les instants pour être non pas améliorée, approfondie, mais simplement conservée en l’état où elle nous a été léguée.
L’égalité est une soif, un supplice de Tantale face auquel nul ne peut résister.
La liberté est une conquête, celle qui permet d’arracher les tentacules du pouvoir de coercition de la gorgone servitude, qui nous entravent et nous étranglent.
Par ailleurs, ajoute Tocqueville, la monarchie et plus encore la démocratie sont des vecteurs privilégiés du développement prodigieux de la notion d’égalité. Non que l’égalité entre les hommes doit être bafouée, bien au contraire, elle est non seulement nécessaire mais même évidente, condition incontournable à la constitution d’un homme libre, citoyen à part entière. Mais trop souvent l’égalité a cru au détriment de la liberté. Du temps de la monarchie déjà, les sociétés aristocratiques n’ont connu qu’une liberté incomplète, la « liberté privilège », or il n’est concevable de liberté qu’égale pour tous. Il faut toujours garder en mémoire que, dans notre pays, l’histoire du droit et de l’Etat, sous l’Ancien Régime avec la monarchie absolue, et après la Révolution française avec le transfert du pouvoir souverain du roi à la nation, est l’histoire de la centralisation, c’est-à-dire de la concentration monopolistique des pouvoirs administratifs et politiques par l’Etat.
Les temps démocratiques ont accentué cet effet puisque les hommes sont souvent prêts à sacrifier la liberté à leur passion dominante, l’égalité. Comme il aime les idées simples, l’homme démocratique est tout naturellement porté à concevoir un pouvoir unique et central, d’autant plus que la haine du privilégié le rend méfiant à l’égard des pouvoirs locaux, perçus comme autant de potentats bananiers, et que son individualisme l’éloigne de la participation aux affaires locales. La place prépondérante devient celle qu’occupe l’ingénieur social.
Ce dernier, adepte du planisme, de la centralisation administrative et de l’économie administrée, sera l’instrument d’un pouvoir de coercition étatique trop content de disposer en sa personne d’un séide aussi zélé. Il y a d’ailleurs une chose fort révélatrice : peu de planistes se contentent de dire que l’administration centralisée est désirable ; la plupart d’entre eux affirment que nous ne pouvons plus choisir, et que nous sommes contraints d’instituer ce planisme devenu, presque par un Deux ex Machina, inéluctable.
En vérité, il ne faut jamais méconnaître le fait que la centralisation administrative et son corollaire technique, le planisme, ne sont que le produit d’opinions nourries et propagées pendant un siècle et qui ont fini par dominer toute notre politique. Ce sont les opinions collectivistes et constructivistes qui ont milité en faveur de la centralisation, tant les opinions du socialisme bien sûr, que celles de l’absolutisme monarchique auparavant, comme l’a si bien rappelé Bertrand de Jouvenel dans son analyse du développement historique du Pouvoir totalitaire.
C’est pourquoi la nécessité d’une « coupure » du pouvoir, de son auto-limitation par un ou plusieurs autres pouvoirs de puissance égale, est évidente. C’est ce que développe Tocqueville, comme bien d’autres auteurs avant lui. C’est pourquoi la quasi-totalité des pays européens ont choisi cette voie, hormis le Royaume-Uni, l’Irlande, la Grèce et le Portugal, qui ont choisi de rester centralisés — et du même coup relativement bureaucratiques.
Dorénavant, d’aucuns comprennent enfin que la complexité croissante de la société condamne irrémédiablement un égalitarisme qui, dans les faits, compromet bien souvent la recherche de l’égalité : le législateur doit donc admettre qu’à des situations différentes doit répondre des règles « sur-mesure », dans le respect bien sûr de nos valeurs communes fondamentales.
C’est ainsi — souvenons-nous — qu’est né le revenu minimum d’insertion, mis en oeuvre au début des années 80 dans plusieurs grandes villes avant que le législateur ne décide sa généralisation.
Dès lors peu importe le vocabulaire que l’on emploie : « fédéralisme » ou « décentralisation », la réalité est la même, seul le degré change. Hans Kelsen a le premier posé ce problème. Si le fédéralisme est considéré comme une menace dans la vieille Europe, qui préfère organiser officiellement une décentralisation très poussée, c’est essentiellement à cause du spectre américain, qui fait sur la plupart de nos semblables l’effet d’une hydre de Lerne peu compréhensible pour tout individu doté d’un minimum de raison. Tout ce qui est libéral, et par conséquent américain, est ontologiquement mauvais, comme le rappelait déjà Pie IX dans l’encyclique Syllabus. Or le fédéralisme a été inventé aux États-Unis en 1787, lesquels sont parvenu, chemin faisant, à combiner la nécessité d’un pouvoir fort (centralisation politique) avec celle d’une décentralisation de l’exercice du pouvoir relativement poussée, favorisant la participation, la liberté, et son corollaire, la responsabilité. Le pouvoir américain a été distribué sur une assise territoriale, selon le modèle libéral des freins et des contrepoids.
Le seul le vrai problème du fédéralisme, c’est le risque d’exacerber des identités culturelles et linguistiques intransigeantes, de peur qu’elles ne débouchent sur une ethnicisation de l’état et finalement son éclatement dans la douleur, à l’instar de l’ex-Yougoslavie. Admettez avec moi que ni l’Allemagne, ni l’Espagne, ni l’Italie, cas pourtant les plus polémiques du fédéralisme velléitaire contemporain, ne semblent susceptibles de sombrer dans un tel écueil. Pourquoi la France en serait-elle victime ?
La vraie supériorité du modèle fédéral, c’est l’équilibre des pouvoirs qu’il provoque jusqu’au sommet de l’organisation institutionnelle : dans un système fédéral, les Eats fédérés ont formellement un pouvoir constituant, et peuvent du coup modifier une constitution fédérale par trop liberticide pour leur développement mutuel.
La décentralisation, c’est encore l’oukase imposée par la centralité suzeraine à ses vassaux tenus au collet ; le fédéralisme, c’est l’autogestion, l’autonomie de chaque membre de la famille, perçu comme un adulte responsable et non comme un enfant.
Le fédéralisme est vraisemblablement le secret de la Suisse, avec ses citoyens de langue française (19 %) allemande (64 %) et italienne (8 %), qui fait preuve de stabilité et de prospérité exceptionnelles. Les États-Unis, aussi stables, mobilisent les ressources de tout un sous-continent, tout en respectant les divergences régionales. Le Canada est un cas similaire.
Si ce dernier pays abandonnait son fédéralisme pour devenir un état unitaire, en supprimant le gouvernement québecois et le gouvernement fédéral, nul doute que les Franco-québécois se sentiraient moins en sécurité, au même titre d’ailleurs que les anglo-québécois. De plus, il pourrait en résulter dans les deux cas un gouvernement trop centralisé pour être efficace — les problèmes économiques en France et au Royaume-Uni étant souvent pires qu’en Amérique du Nord.
N’oublions pas Lord Acton, qui voyait dans l’État-nation centralisateur la garantie de l’intolérance et de la suppression des libertés individuelles au profit du groupe ethnique dominant ; alors que la coexistence de plusieurs nations dans un même Etat, objet ultime du fédéralisme, permet au contraire une saine émulation et un rayonnement bénéfique pour tous.
Le fédéralisme a ceci de roboratif qu’il permet de mesurer, comparer, hiérarchiser les entités les unes par rapport aux autres. D’aucuns invitent même à réflechir à un modèle fédéral a-territorial et de type fonctionnel (1).
Il nous faut convaincre du bien fondé d’une vision du pouvoir fondée non sur le dogme de l’unité et de l’indivisibilité de la République, de la souveraineté nationale, mais sur une logique "démocratique" selon laquelle l’Etat ne doit plus exercer sa puissance d’en haut, mais doit constituer plutôt l’un des éléments d’un système de pouvoirs et de représentation mettant en présence des autorités concurrentes.
A cette aune-là, la question fédérale interne rejoint la question fédérale externe, celle de la logique européenne. Faute de quoi notre centralisme sclérosé réalisera la tragique prophécie de Tocqueville, car, disait-il, "il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ne tyrannise point, il gêne, il comprime, il énèrve, il éteint, il hébète, et il réduit enfin chaque nation à n’être plus qu’un troupeau d’animaux timides et industrieux, dont le gouvernement est le berger".
 Contrepoints
Contrepoints