Accueil > Argumentaires > Édito > Le pouvoir inutile
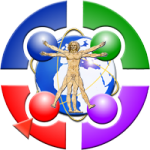 Le pouvoir inutile
Le pouvoir inutile
dimanche 18 avril 2004
Les Français ont choisi de voter. Et ce vote, contrairement à l’espoir pervers placé dans un mode de scrutin organisé pour être illisible, est limpide. La critique radicale du système politique que constitue le Front national continue à progresser. Jean-Pierre Raffarin, un gouvernement et ses ministres font l’objet d’un rejet définitif. L’échec de l’UMP est total, tant vis-à-vis d’une gauche redevenue majoritaire que face à une UDF qui retrouve son étiage traditionnel face au parti gaulliste.
Surtout, les Français ont pris acte de l’incapacité du président de la République à conduire la modernisation du pays et à enrayer la dynamique de la peur et de la haine sociales, exprimant leur révolte contre un quinquennat mort-né qui s’inscrit dans la continuité d’un septennat avorté.
En 1995, les Français élirent Jacques Chirac pour rompre avec l’ombre mortifère du second mandat de François Mitterrand. En guise de réduction de la fracture sociale, le gouvernement Juppé ajouta à la déflation monétaire un choc fiscal qui cassa la reprise ; en guise de restauration de l’Etat, la dissolution déboucha sur un quinquennat de cohabitation délétère ; en guise de modernisation, les fruits d’une croissance importée par une conjoncture mondiale exceptionnelle furent dilapidés en dépenses de redistribution au lieu d’être investis dans l’amélioration de la compétitivité du pays et la réduction du chômage structurel ; en guise de réhabilitation du rôle international de la France dans le monde, sa diplomatie ne cessa de s’isoler et de perdre en influence, notamment en Europe, tandis qu’était engagée à partir de 1995 une politique active de désarmement en complète contradiction avec le renouveau des menaces sur la sécurité des démocraties et avec les besoins supplémentaires nés de la professionnalisation des armées.
Le 21 avril 2002 ne fut donc en rien un coup de tonnerre dans un ciel serein, mais la conclusion logique d’un septennat stérile.
En 2002, l’euphorie et les illusions propres aux folles années 1990 avaient laissé la place au sentiment tragique d’une histoire de nouveau en marche, placée sous le signe du krach boursier, des attentats du 11 septembre 2001 et des scandales financiers en chaîne.
Aux angoisses d’une nation déclinante et inquiète s’ajoutèrent les incertitudes d’un monde chaotique, oscillant entre la dynamique de la mondialisation et la montée des tensions monétaires ou le renouveau des tentations protectionnistes, entre la démesure impériale et le sentiment de vulnérabilité d’une hyperpuissance déstabilisée, entre les jalons d’une société civile internationale et l’onde du choc des civilisations.
Le cri de détresse et d’alarme du 21 avril 2002 puis la dévolution de tous les pouvoirs au président, réélu par 82 % des voix, et à sa majorité, témoignaient sans ambiguïté d’une volonté de changement dirigée vers la réhabilitation des valeurs de la République, la recomposition d’une nation blessée et divisée, le rétablissement d’un ordre civil, la remise en marche d’une économie de la production et du travail nécessaire à la réduction du chômage et de l’exclusion, la réaffirmation d’une capacité d’action et de proposition sur la scène internationale.
Bref, face à une nouvelle grande transformation du monde et à ses risques, les Français attendaient ardemment que soit dessiné un projet politique d’adaptation du pays au XXIe siècle et engagée une thérapie de choc. En lieu et place, ce furent Jean-Pierre Raffarin et son gouvernement, pour lesquels le 21 mars 2004 sonne le glas. La politique de la France d’en bas vient en effet d’être condamnée comme la politique qui tire la France vers le bas. Avec un bilan qui se réduit à beaucoup de bruit pour rien, ou pour très peu de chose.
En deux ans, le gouvernement animé plus que dirigé par Jean-Pierre Raffarin a placé la France en situation de banqueroute économique et financière, mais plus encore politique et morale. Le refus de faire la vérité sur la situation de la France et d’assumer auprès des citoyens une stratégie de changement, pour privilégier des réformes honteuses, larvées et masquées, a logiquement tourné à la débâcle. Le pragmatisme revendiqué s’est révélé une perpétuelle indécision, le progressisme un manque chronique de courage, la volonté de dialogue une sujétion aux corporatismes. Les résultats sont à la hauteur.
Au crédit ne figurent que la reprise en main fragile de l’ordre public et une réforme tronquée des retraites qui ne couvre qu’un tiers du besoin de financement à l’horizon de 2020, laisse subsister des inégalités de traitement majeures à l’avantage du secteur public et exclut les régimes spéciaux, qui attribuent 5 % des pensions à 2 % des retraités.
L’ensemble des autres réformes urgentes ont été annulées ou reportées, de l’assurance-maladie au marché du travail en passant par la modernisation de l’Etat et la fiscalité, l’enseignement supérieur et la recherche, la refonte de la justice ou de la défense. Le débit est interminable. Des institutions perverties en un despotisme impotent, aussi prompt à servir ses clients qu’à mépriser l’intérêt général, joignant le népotisme à l’arbitraire. Une décentralisation présentée comme le grand œuvre du premier ministre puis abandonnée à une logique floue, organisant la confusion des compétences et des financements au risque de générer une explosion de la fiscalité locale. Une gesticulation législative subordonnée aux impératifs de communication, mêlant les textes de circonstance - telle la désastreuse loi dite du voile - aux textes d’exception, qui tendent à systématiser - depuis les avocats jusqu’aux travailleurs sociaux en passant par le statut de repenti - le soupçon et la délation au mépris des libertés.
Un Etat en faillite, dont les finances publiques sont les plus dégradées au sein de l’Europe des Quinze. Un engrenage de guerre civile froide avec la montée des tensions entre les statuts, les corporations, les générations, et plus encore les communautés. Une diplomatie sortie de tout contrôle ayant pour principale réalisation la désintégration de l’Europe communautaire, sous le triple effet de l’échec provoqué du processus constitutionnel, de l’éclatement revendiqué du pacte de stabilité associé au refus de toute forme de coordination et de responsabilité budgétaire, d’un élargissement non maîtrisé avec pour prochaine étape l’intégration de la Turquie.
La France présente aujourd’hui ce paradoxe scandaleux d’un pays qui décline, s’appauvrit et se déchire, en dépit de ses immenses atouts, du seul fait de règles absurdes et d’un manque criant de leadership politique. La France ne meurt pas d’un excès, mais d’un déficit de politique ou, plus exactement, de la cannibalisation du politique par une conception cynique du pouvoir qui en monopolise les avantages tout en en refusant les responsabilités, qui en dissout la dimension de projet et d’action pour n’en retenir que l’accaparement et la distribution des emplois et des fonds publics. Elle est le pays où le premier ministre se définit comme un fusible et un simple exécutant du président, tandis que le président ne se consacre qu’à sa propre réélection, se spécialisant dans les causes humanitaires pour mieux se dérober devant les choix politiques qu’imposent les intérêts supérieurs de la nation.
Mais le pouvoir use et s’use, même si l’on ne s’en sert pas. L’insoutenable inconséquence d’un pouvoir intermittent qui ne se mobilise que par éclipses, à l’approche des élections ou sous la pression des corporatismes, a pour pendant l’irresponsabilité et le nihilisme des citoyens, qui instrumentalisent jusqu’au vote extrémiste pour préempter les dépouilles d’un Etat-providence en état de cessation de paiements.
Dès lors que l’Etat, à travers son chef, moque ouvertement l’intérêt général en affichant qu’on ne fait jamais trop de démagogie, tout est permis aux individus. Et, dès lors que tout est permis, chacun se découvre prêt à faire n’importe quoi, ce qui est le début de la fin de la démocratie : ainsi la prime des buralistes appelle-t-elle le déconventionnement sauvage des médecins spécialistes ; ainsi la manne offerte aux bistros enflamme-t-elle les labos.
Aujourd’hui se présente une nouvelle heure de vérité pour le pays et pour Jacques Chirac. D’abord au plan intérieur, parce que trop de démagogie tue la démagogie, comme le montre le fait que même le monde agricole n’accorde plus aucun crédit à la parole du chef de l’Etat, et que la machine à générer du vote extrémiste continue à fonctionner à plein régime : sauf tournant radical, Jacques Chirac s’apprête à finir son quinquennat comme François Mitterrand son second septennat, en entraînant son pays, son parti et son entourage dans la honte et le mépris.
Ensuite, et surtout, parce que les démocraties se trouvent à nouveau confrontées à un moment critique de l’histoire. De l’élection contestée de George Bush en 2002 au renversement du résultat des élections législatives espagnoles du 14 mars dernier sous la pression terroriste en passant par les attentats du 11 septembre 2001, le court-circuit de tous les contre-pouvoirs propres à la vie politique américaine, les conditions plus que douteuses de l’intervention en Irak, qui constitue la plus grave erreur depuis l’engagement au Vietnam, les nations libres sont entrées dans une phase de turbulences aiguës. Elles sont prises en tenaille entre la dynamique du chaos planétaire sur fond de terrorisme de masse et de prolifération des armes de destruction massive et la contamination du repli et de la peur qui gagne les citoyens et qui s’accompagne d’une volatilité croissante des opinions publiques, promptes à laisser les passions l’emporter sur la raison.
D’où la nécessité croissante de la politique face aux chocs et aux risques du XXIe siècle, mais d’une politique qui doit se fixer pour premier objectif de réintroduire du sens, de la cohérence et de la cohésion tant au sein de chaque société qu’entre les grandes démocraties, afin d’enrayer l’ascension aux extrêmes d’une violence dont la nature est indissociablement interne et extérieure.
Sous le désaveu du 21 mars 2004, réplique du séisme du 21 avril 2002, pointe donc la question fondamentale que se posent les Français : trois années supplémentaires données à Jacques Chirac, pour quoi faire ? Pour continuer à être l’homme d’un clan de gérontes et d’affidés, continuant imperturbablement à présider à l’effondrement de la Ve République et de la nation ? Ou bien pour reconquérir une certaine distance vis-à-vis de sa faction et tenter de devenir l’homme de la nation et de temps difficiles.
Le général de Gaulle rappelait que, pour faire de la politique à la hauteur de l’histoire, "il faut accepter de tout perdre. Sinon quoi ? Le risque ne se divise pas".
Pour rendre l’espoir à la France et aux Français, il faut aujourd’hui prendre le risque de leur dire la vérité, de leur proposer une vision politique de leur avenir et de celui de l’Europe, de tracer un projet national de modernisation du pays dans l’histoire tumultueuse du XXIe siècle.
A Jacques Chirac, au terme de neuf années d’occupation plus que d’exercice du pouvoir suprême, de donner tort à l’immense majorité de ses concitoyens qui pensent et expriment sans ambiguïté qu’il ne serait pas Jacques Chirac s’il en était capable. Qu’il est une partie majeure du problème français, mais qu’il est étranger à sa solution.
 Contrepoints
Contrepoints