Accueil > Philosophie > Philosophie générale > L’invention de l’Etat > L’invention de l’Etat - les outils de l’économiste
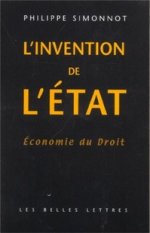 L’invention de l’Etat - les outils de l’économiste
L’invention de l’Etat - les outils de l’économiste
Un article du blog de Copeau
samedi 30 avril 2005
Philippe Simonnot passe du coq à l’âne dans cet ouvrage si bizarrement construit ; ici, une série de dix chapitres reprennent, de façon un peu fainéante, quelques-uns des principaux chapitres des 39 leçons. Ce qui est relativement choquant, dans la mesure où cette pirouette permet de gonfler considérablement la pagination du livre 1er, de façon largement artificielle. On aurait préféré que Philippe se contentât de renvoyer le lecteur à chacun des chapitres concernés des 39 leçons. Ou qu’il dispense de leur lecture les gens qui connaissent déjà cet ouvrage. A noter toutefois la présence de quelques nouveautés, concernant l’efficience ou le théorème de Coase, ainsi que la notion de coût de transaction.
La rationalité économique
L’assertion selon laquelle l’homme est un animal économiquement rationnel est source de nombreux malentendus. Mises a montré mieux que tout autre, dans L’Action humaine, que la praxéologie, la science de l’action, est dénuée de tout fondement moral. Elle est wertfrei, comme le dit Max Weber. Elle n’étudie pas la légitimité des fins, mais la concordance des moyens avec les fins. Agir, c’est agir consciemment. On écarte donc les réactions et réflexes involontaires. L’homme qui agit désire fermement substituer un état à un autre, dans l’espoir d’améliorer sa situation. Comment mesurer cette amélioration ? il n’y aucune autre façon, répond Mises, que de se baser sur les jugements de valeur de l’individu agissant, lesquels varient selon les individus, et, pour un même individu, d’un moment à l’autre.
L’homme choisit toujours, mais n’est pas toujours raisonnable. Simplement, son action est raisonnée. Ce qui signifie que, même lorsqu’il cède à une impulsion illégale, ou qui lui causera du tort, l’homme choisit encore : il choisit de céder à son désir.
Bien sûr Mises n’est pas naïf : il sait que l’homme ordinaire, vous et moi, sommes déterminés par notre culture, nos habitus. Mais si nous nous en remettons à l’autorité d’autrui, si nous adoptons des comportements moutonniers, nous choisissons encore : nous choisissons d’adopter des schémas traditionnels, car nous en espérons une amélioration de notre situation.
Mises a donc inventé un concept majeur, fondamental même : la rationalité qui est capable de tout absorber, même l’irrationnel ! En effet, je peux me tromper. Mais mon action reste rationnelle. Je peux même délibérément risquer de me tromper ; je n’en suis pas moins encore rationnel. Quand j’achète un pot de yaourt dans un supermarché, il est rationnel que je ne cherche pas à tout savoir de ce pot, même si le risque l’empoisonnement n’est pas tout à fait nul. C’est ce que Herbert Simon a baptisé la « rationalité limitée », qui ne remet pas en cause la praxéologie, mais qui au contraire la conforte.
Si on traite telle action d’irrationnelle, il ne peut s’agir que d’un jugement de valeur arbitraire. Comme le dit Philippe,
Même si pour démontrer la fausseté de la théorie de l’action rationnelle, on s’efforçait de faire un acte purement irrationnel, cet acte serait encore rationnel puisqu’il serait mis au service d’une fin, la démonstration en question ! En un mot comme en cent : il est absolument impossible de sortir de la rationalité !
Pour Rothbard, cette incertitude consubstantielle à la science économique ne la met pas en péril. Au contraire, c’est la preuve que le critère de scientificité de Popper (un loi scientifique doit être falsifiable, de sorte que l’on puisse vérifier si elle est fausse ou vraie) ne s’applique tout simplement pas à l’économie.
Becker et Stigler ne partagent pas cet avis. Ils pensent que l’économiste doit étudier les goûts des individus, et ne pas botter en touche. Pour ce faire, Becker invente la notion de capital humain. Qu’est-ce ? un exemple. L’accoutumance à la musique classique ne vient pas d’un changement de goût du sujet, mais du fait que consommer ce genre de produit agit sur un élément du capital humain. Cette modification du capital humain augmente la satisfaction tirée de la musique classique conduisant à un changement du comportement du sujet, qui passe de plus en plus de temps à écouter ce genre de musique.
Comment expliquer que certains comportements restent stables, alors que les prix changent ? Si on ne veut pas sombrer dans la tautologie de Mises (le sujet ne peut agir que rationnellement), il faut là encore faire appel à la notion de capital humain : la prise de décision est coûteuse. Pour un sujet qui se trouve face à un changement qu’il perçoit comme temporaire, il est donc rationnel de ne pas réinvestir le capital humain incarné dans du savoir ou dans un métier, et de le ré-investir dans de nouvelles connaissances. D’autant que la recherche d’informations n’est pas gratuite ; elle a un coût. Il en est de même de la publicité ou de la mode.
Pour Mises en revanche, les choses sont plus simples : si l’homme n’agissait pas rationnellement, alors son comportement serait totalement imprévisible, ce qui le plus souvent n’est pas réaliste. Dans la vie quotidienne, la rationalité économique permet de prévoir grosso modo ce qui va se passer, à condition de ne pas trop demander de précisions chiffrées ni quant au fait ni quant à la date. Comme le disent justement les économistes autrichiens, l’acteur irrationnel ne peut faire long feu, ou ne peut rester longtemps irrationnel, car la faillite ou la famine l’attend. Mais la science économique n’en reste pas moins une science, car cette dernière ne se définit pas ontologiquement par sa capacité prédictive. La science économique n’a même aucune capacité prédictive, si l’on en croit Rothbard : ses lois sont par nature « qualitatives ». Elles ne peuvent être quantitatives car il est impossible de ne rien tenir comme constant. La formule « toutes choses égales par ailleurs » est un pis-aller qui ne change rien à la nature de la science économique.
Allons un peu plus loin : Guido Hülsmann considère que l’économie est contre-factuelle. Ce qui signifie que les lois économiques concernent non les relations entre des comportements humains et tel ou tel événement observé, mais à l’intérieur même de l’action humaine, entre les parts visibles et invisibles de cette action. Les lois nous permettent donc d’expliquer ce qui existe dans les termes de ce qui aurait pu exister. Cette vision des choses est radicalement nouvelle, et grosse de fructueux développements. Dans des mots plus profanes, on peut dire que l’économie permet aux acteurs de ne pas naviguer complètement à l’aveuglette. En économie tout particulièrement, la rationalité praxéologique est possible. Pour trois raisons :
![]() la plupart des décisions que l’on prend dans le champ économique sont fréquentes et routinières. Si je fais une erreur, je peux donc la corriger très rapidement.
la plupart des décisions que l’on prend dans le champ économique sont fréquentes et routinières. Si je fais une erreur, je peux donc la corriger très rapidement.
![]() en économie, on se sert d’un étalon de mesure, la monnaie, ce qui facilite les comparaisons entre plusieurs produits concurrents, et donc aide à prendre des décisions économiquement rationnelles. Si tout s’échange en monnaie, tout est susceptible d’avoir une sorte de contre-valeur en monnaie. On voit par exemple, que le prix de la vie d’une star de cinéma n’a pas la même valeur que le prix de la vie d’un clochard, malgré les valeurs égalitaires de nos sociétés.
en économie, on se sert d’un étalon de mesure, la monnaie, ce qui facilite les comparaisons entre plusieurs produits concurrents, et donc aide à prendre des décisions économiquement rationnelles. Si tout s’échange en monnaie, tout est susceptible d’avoir une sorte de contre-valeur en monnaie. On voit par exemple, que le prix de la vie d’une star de cinéma n’a pas la même valeur que le prix de la vie d’un clochard, malgré les valeurs égalitaires de nos sociétés.
![]() Enfin, en économie, les décisions prises sont d’une relative simplicité. Au moins en ce qui concerne la vie quotidienne.
Enfin, en économie, les décisions prises sont d’une relative simplicité. Au moins en ce qui concerne la vie quotidienne.
On pourrait penser qu’à l’opposé de l’économie, et de la rationalité économique, se trouvent le droit, et la logique justicière du droit et des juristes.
Or Philippe montre qu’il n’en est rien, et que l’un des domaines dans lesquels la rationalité trouve à s’appliquer au quotidien, c’est le droit. En effet, beaucoup de décisions sont prises comme si elles tenaient compte de l’existence d’un marché et de prix implicites sur ce marché. C’est le cas des sanctions monétaires infligées à ceux qui violent la propriété d’autrui, c’est le cas du traitement des handicapés mentaux, dont le traitement par la société devient autrement moins intégrateur que celui des handicapés physiques, pour la raison que ces derniers sont à présent employables, compte tenu des progrès technologiques, tandis que les premiers ne le sont toujours pas. Enfin, face à la chaîne infinie des causes et des effets d’un litige, le juriste tranche, arrête le contentieux. Quitte à ne pas continuer le jeu sans fin des renvois de notes entre les parties. Ce faisant, comme l’économiste, le juriste est un « ignorant rationnel ».
La demande et l’offre
Dans plusieurs des chapitres suivants, Philippe détaille quelques grands concepts économiques, et répète ses écrits des 39 leçons. Le lien avec la suite de l’ouvrage ne saute pas toujours aux yeux, ce qui rend la lecture de ces chapitres très fastidieuse.
Il détaille le point d’équilibre entre l’offre et la demande, le surplus dégagé par le consommateur, et celui du producteur. Ces points d’équilibre ne sont que des photographies, si bien que les prix varient, bien évidemment, en permanence. La tentation est alors grande de réguler les prix, en les fixant administrativement. On connaît bien les effets pervers de ceci : le SMIC, fixé au-dessus du prix d’équilibre sur le marché du travail, crée le chômage ; les loyers immobiliers, fixés au-dessous du prix d’équilibre sur le marché du logement, crée la pénurie de logements. Dans les deux cas, l’Etat, censé agir pour le bénéfice des plus démunis, agit en réalité très exactement contre eux.
L’Etat [1] n’en est pas à un argument près : si celui de la protection des faibles est contré, il trouve celui de la protection de l’intérêt général. On veut créer des autorités de régulation pour lutter contre l’instabilité du marché. Or il y a un hic : c’est précisément l’Etat qui crée cette instabilité, et le marché qui est régulateur ! un exemple : la spéculation. On la traite de tous les maux, de tous les vices. Or, il est de l’intérêt du spéculateur de vendre au plus haut, d’acheter au plus bas. Il stabilise donc les marchés. Par ailleurs, sur le marché des futures, des ventes et achats à terme, les options réalisées ont un effet stabilisateur indéniable, même si elles ne suppriment pas toute fluctuation – qui rendrait le marché inutile, du reste.
A contrario, une stabilisation autoritaire des prix supposerait que l’on connaisse à l’avance quel est le « vrai » prix du marché, et que celui-ci ne changera pas. Or c’est complètement loufoque : ces deux hypothèses ne sont jamais réunies !
Si on joue sur la quantité plutôt que sur les prix, le résultat est sensiblement identique.
S’ajoute une reprise de la bien connue théorie de l’impôt. En résumé : sans impôts, le surplus des consommateurs et des vendeurs est maximal. Avec impôts, leur surplus est considérablement réduit, mais l’Etat ne le récupère pas en totalité. Il y a une perte sèche de bien être, que la société tout entière accuse. En un mot comme en cent : ce sont toujours les choix issus du libre-jeu des forces du marché qui sont optimales ; toutes les autres solutions (intervention de l’Etat sur les prix, sur les quantités, impôt) se caractérisent par une perte de bien-être collectif.
Le dilemme du prisonnier
Reportez-vous au chapitre … des 39 leçons. Le dilemme de Tucker est vu comme l’une des plus fortes critiques de la main invisible. Philippe note toutefois, à juste titre, que tout altruisme fait sombrer cette belle mécanique, qui montre que si l’on impose pas la coopération entre des suspects de meurtre, on arrive à une solution sous-optimale. Evidemment, cette coopération devrait être imposée par une entité extérieure. Laquelle ? Ben l’Etat, voyons ! D’ailleurs, on peut mettre ce dilemme à toutes les sauces, et ainsi étendre indéfiniment l’Etat ! on peut l’appliquer à la justice, à la police, à la monnaie, à la redistribution des richesses, à la lutte contre le chômage, à la culture des haricots, …
D’autre part, dans son montage, Tucker n’offre aux joueurs qu’un seul coup. Dans la vraie vie, il n’en est jamais ainsi. En réalité, comme la théorie des jeux nous l’apprend, pour qu’il y ait coopération, il faut que le nombre de coups soit sinon infini, du moins indéfini à l’avance.
Philippe montre aisément que même dans les pires moments, dans les guerres les plus sanglantes, on n’est jamais dans l’état de nature de Hobbes ou de Tucker. Il cite l’exemple parlant de la Première guerre mondiale, où, d’une tranchée à l’autre, on se tirait le soir des coups de canon pour marquer sa présence, mais sans intention de tuer. Il y a de nombreux moyens de contourner la règle mathématique de Tucker, et Philippe s’y emploie de manière convaincante. D’ailleurs, le commensal, le cavalier libre, n’est qu’un « prisonnier » particulier. Rawls est bien obligé de justifier de façon quasi religieuse la légitimité de l’Etat à percevoir l’impôt, car sinon rien ne lui reste. L’impôt, c’est la dîme religieuse. Ce qui signifie que l’Etat est une pseudo-église, que le bien public est le salut éternel.
L’efficience
Si on pense que l’échange est toujours bénéfique aux deux parties qui échangent, il faut que l’on puisse comparer les utilités, et que l’instrument de mesure ait lui-même la même utilité pour les deux échangeurs. Autant le dire tout de suite : ce chapitre est le plus important, et de loin, du livre 1er. Il explique en quoi l’utilitarisme, à la Bentham ou à la Marshall, n’est pas aussi roboratif que le calcul de l’efficience. Et en quoi le droit naturel n’est pas la bonne solution.
Ce qu’on observe, c’est que dans tous les cas de figure, et quel que soit le prix auquel se fait l’échange, le transfert améliore la situation d’au moins un des partenaires, la situation de l’autre restant identique. Comme on ne se situe jamais, dans la vraie vie, dans ce cas-limite, il est probable que chaque partie gagnera un peu à l’échange.
Ce raisonnement est à la base de l’utilitarisme, qui a connu trois auteurs principaux. Son fondateur, Bentham, puis Marshall, qui le premier a étudié l’économie du droit, et enfin Pareto, qui remet en cause le calcul marshallien des utilités.
Bentham, tout d’abord, pense que nous sommes gouvernés par la peine et par le plaisir. Lesquels sont mesurables, et donc comparables. Le droit naturel est une erreur. Le principe d’utilité, c’est une loi psychologique universelle qui affirme que l’égoïsme opère partout, et que l’amour de soi est universel. Cette vision des choses n’est pas exempte de critiques. Tout d’abord, on sait depuis Leibniz que la maximisation de deux fonctions mathématiques à la fois est une impossibilité logique. Ensuite, on sait que le maximum de population, si tant est qu’on puisse définir la population concernée, ne maximise pas le bien-être. On ne peut donc pas, biologiquement parlant, atteindre les deux maxima en même temps.
Pareto estime qu’il est impossible de mesurer l’utilité et donc de la comparer à celle d’un autre, car elle est subjective. Par conséquent, un progrès de bien-être ne peut être accompli que si au moins l’une des personnes y trouve son compte et si tous les autres n’y perdent pas. Dans un monde parétien, la distribution opérée par l’impôt sur le revenu ne peut avoir d’effets positifs, puisque le bien-être des personnes imposées diminue et que cette diminution ne peut être compensée par l’amélioration du bien-être des personnes qui bénéficient de transferts. Mais ce monde parétien est un monde bloqué. Il faut en effet recueillir l’accord unanime des personnes concernées, personne ne devant se sentir lésé. Rothbard montrera l’indigence d’une telle position.
On est donc obligé de se rabattre sur la vision marshallienne, qui pense qu’on peut additionner les utilités, positives ou négatives, des différents acteurs. Même si ce calcul est imparfait. Cet utilitarisme a été beaucoup critiqué par les « progressistes », à commencer par Sen. Toutefois, ces derniers oublient qu’ils n’hésitent pas à utiliser ce calcul utilitariste pour justifier l’impôt sur le revenu ! Puisque, chez Marshall, la distribution est utile au bien commun si la somme des gains et des pertes est positive, sa vision est conforme à la démocratie, à la différence de Pareto.
Toutefois, de quelque version de l’utilitarisme que l’on se place, cette doctrine présente un certain nombre de points aveugles. Surtout dans sa version marshallienne, si on se conforme à la loi de la majorité, on peut aboutir à des monstruosités. L’infanticide est utile, en ce qu’il améliore le bien-être des survivants. La torture d’un suspect de meurtre de masse pourrait être justifiée sur des critères utilitaristes implicites, tout comme la pratique des otages. Mais d’un autre côté, refuser la possibilité de la comparaison conduit aux impasses parétiennes rappelées ci-dessus. Comment sortir de ce dilemme ?
Posner nous apporte la réponse : par le calcul de la maximisation, non de l’utilité, mais de la richesse. C’est ce qu’on appelle communément « l’efficience ». Qu’est-ce que la richesse d’une société ? c’est non seulement la valeur totale des biens et services produits, disons pour faire simple le PIB, mais c’est aussi le total des surplus des consommateurs et des producteurs générés par ces biens et services. Ce dernier point n’est jamais pris en compte, jamais mesuré. Donc la richesse d’une société est la somme des satisfactions des préférences qui ont été formulées avec de l’argent et ratifiées sur un marché. Ce marché n’a même pas besoin d’être explicite : une grande part de la vie économique passe en effet encore par le troc : le marché du mariage, l’élevage des enfants, les service qu’on rend à des amis.
Ce qui distingue la maximisation de la richesse de la maximisation de l’utilité, c’est que la première implique un plus grand respect des choix individuels que la seconde. Par exemple, l’utilitarisme ne sait pas dire si l’achat est moralement supérieur au vol. Supposons que le plaisir que le voleur tire de l’objet volé soit supérieur à la douleur que cause sa perte pour son propriétaire, alors l’utilitarisme estime que ce vol améliore le bien-être de la société. L’efficience, elle, sait répondre à cette question. En effet, la position de l’acheteur est moralement supérieure à celle du voleur parce que l’acheteur cherche à accroître son bien-être en conférant un bénéfice à une autre personne, le propriétaire du bien. Au contraire, le voleur, lui, n’apporte par définition rien du tout au propriétaire, ni à personne d’autre. Le « droit » qu’il prétend exercer est fondé sur son seul plaisir.
Parfois, a contrario, le vol peut être efficient, si quelqu’un vole de la nourriture pour ne pas mourir de faim. Il est clair que la nourriture a plus de valeur, au sens économique, pour le voleur que pour son propriétaire. En droit, on parle de circonstance atténuante ou de force majeure.
La loi elle-même peut être définie par l’efficience. Rawls – qu’on peut qualifier d’ennemi de l’utilitarisme – pense que la loi n’est pas seulement un commandement soutenu par le pouvoir coercitif de l’Etat. Mais qu’elle a sa logique propre. On ne peut en effet pas donner n’importe quel ordre à des personnes qu’on est censé gouverner. On traite de manière semblable les cas semblables. On rend les lois connues et comprises, pour pouvoir les appliquer, et on proscrit la rétroactivité. Voici bien des critères exactement identiques à ceux de l’efficience.
En résumé, le paradoxe de l’utilitarisme, lorsqu’il prétend être la doctrine du bien-être social, c’est qu’il est logiquement obligé de valoriser toutes sortes de passions asociales, comme la cruauté ou l’envie, parce qu’elles sont communément répandues et donc sources d’utilité. Au contraire, l’efficience enseigne que l’échange volontaire est, par lui-même, source de richesse. Un exemple : la persécution ne peut en aucun cas augmenter la richesse. Le massacre des Juifs par les nazis, que l’utilitarisme peut logiquement justifier [2] devient radicalement impossible avec l’efficience.
Le taux d’intérêt
Le taux d’intérêt signifie tout simplement qu’un bien que l’on tient présentement a plus de valeur que la promesse d’un bien dans le futur. A contrario, un bien futur a moins de valeur que son équivalent dans le présent, parce que le futur est incertain. C’est ce qu’on appelle la préférence pour le présent. L’éloignement dans le temps est comparable avec l’éloignement dans l’espace. L’un comme l’autre ont un coût. Le taux d’intérêt permet de remplacer l’inégalité de la préférence pour le présent, ou de la dépréciation du futur, par une égalité. L’intérêt devient une sorte de coût du transport dans le temps. Il permet de voyager dans le temps.
Dans les sociétés primitives, on échange des dons et des contre-dons, comme Levy-Strauss l’a montré. Or il n’y a jamais égalité parfaite dans les échanges. On troque des choses de plus ou moins même valeur. On est donc incapable de se libérer de sa dette.
C’est cela la révolution culturelle du taux d’intérêt : il ne peut exister que dans un environnement culturel tel que la dette peut être remboursable, et donc qu’elle peut être calculée. Le taux d’intérêt consacre l’exactitude des comptes du débiteur et du créancier. Il fait véritablement advenir l’universalité de l’instrument monétaire.
La baisse du taux d’intérêt fait monter la valeur du capital, et inversement. Par ailleurs, un bas niveau de taux d’intérêt n’encourage pas les gens à investir, parce qu’ils s’attendent à une remontée des taux et donc à une baisse de la valeur du capital. L’argent que le gouvernement déverse sur le marché pour faire baisser les taux ne sert donc à rien, il tombe dans la « trappe à liquidités ». Il est comme de l’eau versée sur du sable. Un taux d’intérêt nul est encore plus absurde : l’économie ne saura pas choisir les bons investissements, tout en ayant tendance à surinvestir. Cette tendance au surinvestissement persiste même avec un taux d’intérêt positif, tant que ce taux reste inférieur au taux qui résulterait du libre jeu de l’offre et de la demande.
Les personnes ont une perception différente des taux d’intérêt : il y a des personnes à taux bas, qui ont confiance en l’avenir, et les personnes à taux haut, qui ont moins confiance. Les gens honnêtes se rangent plutôt dans la première catégorie, les délinquants et les criminels plutôt dans la deuxième. Les capitalistes plutôt dans la première, les salariés plutôt dans la deuxième. Sans compter que le taux d’intérêt varie avec l’âge. Hans-Hermann Hoppe [3] reconstitue toute l’histoire de l’humanité, par le taux d’intérêt. Dans l’état de nature hobbésien, le taux de préférence pour le présent est très élevé, et donc le taux d’intérêt. Toute épargne est impossible, on a intérêt à tout consommer. La civilisation commence à se développer quand on peut commencer à épargner. Mais cela n’est possible que lorsqu’on est assuré de récolter les fruits de l’investissement, c’est-à-dire si les droits de propriété sont respectés et garantis. Les taux d’intérêt peuvent alors baisser. Cette baisse peut être interrompue par deux facteurs extérieurs : des activités criminelles ou des interventions de l’Etat. Les activités criminelles détruisent des biens existants et donc accroissent la préférence pour le présent. On peut créer des mesures défendant la propriété des gens, et le développement de la civilisation peut reprendre. En revanche, on ne peut rien faire pour juguler l’intervention gouvernementale. La fiscalité est tout autant que le vol une violation des droits de propriété. Elle a les mêmes effets négatifs sur l’évolution des taux d’intérêt. Mais cette fois, il s’agit d’une violation dite « légitime », et la victime ne peut s’en plaindre, ni s’en défendre. En monarchie, le Prince aura tout de même intérêt à ménager ses sujets-contribuables, car il doit laisser un héritage au moins intact à ses enfants. La fiscalité sera donc faible. Il a intérêt à faire respecter les droits de propriété, car il faut que lui-même ne soit pas menacé dans ses propriétés et ses revenus. Tout atteinte aux droits de propriété sera donc sévèrement punie, car qualifiée de criminelle.
Les choses s’aggravent encore en démocratie : n’importe qui peut accéder au pouvoir. Or, ceux qui gouvernent ne sont pas les propriétaires du territoire qu’ils gouvernent, mais seulement ses locataires. Leur vision est beaucoup plus courte. Ils vont chercher à maximiser le revenu gouvernemental qu’ils peuvent tirer, sans se soucier du capital dont ce revenu est tiré. Il en résulte une croissance irrépressible du fardeau fiscal et de la dette publique, et par conséquent une augmentation de la préférence pour le présent et des taux d’intérêt. D’autant que les lois démocratiques sont imprévisibles et changeantes, ce qui accroît encore l’incertitude du futur, et donc les taux d’intérêt.
Le coût d’opportunité
C’est la valeur de la chose à laquelle on doit renoncer lorsqu’on fait un choix. En effet, il est parfois difficile de donner une valeur marchande à ce qui ne passe pas par le marché. Par exemple, il est difficile de donner une valeur marchande au temps passé à être oisif, sinon en se disant : qu’aurais-je gagné durant une heure de loisir, si j’avais travaillé ? D’où ce célèbre paradoxe : plus vous gagnez en travaillant, plus votre loisir vous coûte cher. A contrario, si tant de mères de famille préfèrent rester à la maison plutôt que de travailler, c’est que le coût d’opportunité, c’est-à-dire le salaire qu’elles ne touchent pas, est dissuasif, du fait de tous les coûts générés par un enfant (éducation, temps passé par les parents à s’occuper d’eux, etc).
Le monopole
Toute la réflexion trouve son fondement dans la loi des rendements non proportionnels, qui impose que toute activité humaine passe par une phase de rendements décroissants puis croissants. Philippe montre, de manière roborative, que l’axiome de la concurrence pure et parfaite mène à l’étatisation. En effet, en cas de monopole, celui-ci engrange un superbénéfice, ce qui légitime l’intervention de l’Etat, soit pour empêcher que de telles situations surviennent (lois anti-trust), soit pour y remédier (démantèlement, nationalisations, surfiscalité des superprofits, etc). A fortiori, en cas de monopole naturel (rendements toujours croissants), l’intervention de l’Etat est encore plus justifiée (une seule centrale nucléaire n’est viable sur un territoire donné, par exemple).
Or la réalité ne ressemble pas du tout à la concurrence pure et parfaite. Une entreprise cherchera toujours à se différencier de ses concurrents en différenciant ses produits par toutes sortes de procédés (emballage, publicité, …). Par ailleurs, il y a souvent asymétrie d’information entre acheteur et vendeur, soit au profit de l’acheteur (souscription d’un contrat d’assurance), soit au profit du vendeur (d’automobile, d’ordinateur, etc). Il n’existe d’ailleurs pas deux biens parfaitement identiques, ils auront forcément, du point de vue du consommateur, une valeur et une qualité différentes.
La théorie de la concurrence pure et parfaite arrive à cette conclusion : tout profit durable est suspect. Mais s’il y a de tels profits durables, pourquoi d’autres entreprises ne sont-elles pas attirées par ces gains potentiels ? Parce qu’ « on » les empêche d’entrer sur le marché. Qui est ce « on » ? C’est l’Etat. Un monopole ne peut rester monopole qu’avec l’aide de l’Etat. C’est lui qui va décréter que telle entreprise est la seule habilitée à produire tel bien. C’est l’Etat qui a accordé à la Banque de France le monopole de l’émission des billets, à la SNCF celui du ferroviaire.
Le monopole décrit par la concurrence pure et parfaite ne peut donc jamais exister. Bien sûr, l’objectif de tous les agents est d’avoir un monopole. Mais c’est en prenant des risques, dans un monde incertain – chose que la théorie de la concurrence pure et parfaite ignore superbement. Autrement dit, le superprofit, de Microsoft ou de Polaroïd, est la récompense du risque qu’ils ont pris. Il n’est d’ailleurs jamais illimité : windows est en concurrence avec Linux, Mac OS, …
Il est par conséquent complètement vain de vouloir faire respecter les règles de la concurrence, car les calculs en parts de marché n’ont aucun sens. Ce qu’on ne comprend pas, c’est que, pour qu’il y ait concurrence, il faut simplement que l’entrée sur le marché soit libre. Si un « monopole » s’est institué en l’absence d’intervention étatique, ce n’est pas un monopole au sens de la théorie, car il est plongé dans un milieu concurrentiel et il doit tenir compte de ce milieu, et par conséquent baisser ses prix et son profit jusqu’au niveau où d’autres ne sont plus intéressés à entrer sur ce marché. Il se peut qu’un fonctionnaire juge tout de même que ses prix sont trop élevés – par rapport à quelle norme ? Alors, il va ordonner de baisser les prix sous prétexte de rétablir les conditions de la concurrence pure et parfaite, et il aboutira à rendre cette activité non rentable, qui devra être, de ce fait, abandonnée par le secteur privé et confiée à un organe étatique. Cet organe, pouvant être en déficit grâce aux deniers publics, sera en mesure d’échapper aux règles de l’offre et de la demande. Ce même fonctionnaire aurait pu se demander, face à ce qu’il appelle un monopole, pourquoi d’autres entrepreneurs ne sont pas entrés sur ce marché, alors que l’entrée était libre : parce que le risque était trop élevé ? Les profits attendus pas assez attirants ? Parce qu’il manquaient d’imagination ?
Il n’y a pas de monopole en l’absence d’intervention étatique.
La théorie du monopole et son double, celle de la concurrence pure et parfaite, sont incapables de concevoir et de comprendre le profit. Pour elles, l’entrepreneur est une sorte d’ingénieur dirigeant une économie socialiste planifiée, un technicien du Gosplan. Il en est de même des cartels et des ententes, qui ne peuvent empêcher la venue d’un nouveau concurrent. Sauf lorsque les membres du cartel sont des monopoles publics et que le marché est fermé. C’est le cas de la monnaie.
Le coût de transaction
Sraffa, dans les années 30, a tenu des propos déconcertants : il disait qu’une entreprise fonctionne normalement à coûts décroissants et à rendements croissants. Or, ceci a pour conséquence automatique que l’entreprise, à mesure qu’elle grandit, va absorber toutes ses concurrentes jusqu’à devenir un monopole. Ceci est donc un excellent argument pour l’Etat, qui en profitera pour intervenir à coup de subventions, histoire de financer le fait que cette entreprise, devenue monopolistique, devra fonctionner à perte.
Joan Robinson lui répondit prestement : pour elle, la loi des rendements décroissants découle du fait ou reflète simplement le fait que l’élasticité de substitution des facteurs n’est pas infinie. En termes moins savants, ça veut dire qu’en présence de facteurs fixes (par exemple, un terrain) et des facteurs variables (les matériaux, la main d’œuvre, bref tout le reste), à un moment donné, à mesure que l’on monte un immeuble, les étages deviennent de plus en plus coûteux et de moins en moins rentables. Jusqu’au moment où il faudra bien s’arrêter. A contrario, insiste Joan, si tous les facteurs de production étaient indéfiniment divisibles, chaque individu serait à lui seul une entreprise. Ce qui ne correspond pas à la réalité.
Chamberlin s’est alors opposé à Robinson : pour lui, même si tous les facteurs de production étaient divisibles à l’infini, l’entreprise existerait tout de même pour mettre à profit les économies d’échelle tirées de sa dimension. Hicks ajoute même que si l’entreprise a une raison d’être, c’est parce que le cerveau du manager ne peut être partout, ce qui limite la taille critique d’une entreprise donnée.
Puis vint Coase. En 1937, dans un article passé inaperçu, il pose cette question métaphysique : pourquoi y a-t-il une entreprise plutôt que rien ?
C’est, selon lui, parce que le recours au marché occasionne des coûts, et que les entreprises existent pour réduire ces coûts. Ça peut sembler tout bête, c’était pourtant révolutionnaire. Quand on parle de coûts, il ne s’agit pas seulement des coûts de vente, mais aussi des coûts de transaction, qui sont tous ceux occasionnés par la recherche d’un partenaire sur le marché, par la négociation et la signature d’un contrat, etc. Les entreprises réduisent les coûts de transaction en substituant l’ordre hiérarchique à la loi de l’offre et de la demande. Exemple : au lieu de négocier chaque jour l’embauche de main d’œuvre, elle a sous contrat des salariés qui doivent obéir aux ordres qui leur sont donnés.
Bien évidemment, l’organisation hiérarchique a ses propres défauts, et l’on voit souvent la firme recourir à des processus inverses de désintégration pour retrouver de la compétitivité grâce à l’aiguillon de la concurrence.
Coase souligne par ailleurs l’importance de l’information. Elle se paie. Elle accapare des ressources. Il arrive un moment où la quête d’information coûte plus cher qu’elle ne rapporte. A ce moment-là, il vaut mieux renoncer. Mais cela ne signifie pas que mon comportement est irrationnel, bien au contraire, comme je l’expliquais plus haut. J’accepte mon ignorance relative, en connaissance de cause. Le coût de l’information est une donnée fondamentale, l’œuf de Colomb de Coase : car si l’information était gratuite et parfaite, elle serait disponible partout, et toute incertitude aurait disparu. Ce faisant, les entreprises n’auraient plus lieu d’être, et la planification centralisée serait possible. Heureusement, tel n’est jamais le cas.
Les institutions ne tombent donc pas du ciel, elles sont produites par l’économie ou répondent à des nécessités économiques. Car en effet, aux côtés des coûts de transaction du marché (confiance en la robe d’un avocat, négociation et application des contrats), il y a des coûts de transaction managériaux (établissement, maintien ou changement de l’organisation de l’entreprise, fonctionnement, etc) et aussi des coûts de transaction politique (liés au maintien ou au changement de l’entité politique, au fonctionnement de celle-ci également, c’est-à-dire les dépenses courantes des fonctions régaliennes de l’Etat).
Le bien collectif
Je ne respecte pas ici l’ordre des chapitres de Simonnot, mais la compréhension du texte me semble facilitée de la sorte. Un bien collectif, c’est un bien qui génère des externalités (positives ou négatives). Il a deux caractéristiques : la non-rivalité, qui signifie que le fait qu’un individu supplémentaire profite de ses avantages n’en réduit pas le montant disponible pour tous ceux qui en jouissaient déjà. La non-excluabilité, qui signifie qu’il n’existe pas, dans l’état des techniques actuelles, de moyen imaginable d’empêcher quelqu’un de le consommer une fois qu’il est produit. Le parfum de mes roses embaume le voisinage, sans que je puisse l’empêcher (à un coût raisonnable).
Philippe ne s’est pas spécialement foulé en faisant un copier-coller des 39 leçons ici. Par nature, un bien non-excluable incite les gens à adopter un comportement opportuniste, à être un free rider, un commensal, un passager clandestin (ces termes sont synonymes). Par ailleurs, la consommation du commensal (j’utilise ce terme, car je le trouve très joli), ne passant pas par le système de prix, est donc gratuite, et ne révèle pas ses préférences. Si on laisse les utilisateurs libres de payer ou non le financement d’un tel bien, alors ce financement est impossible et le bien en question ne sera pas produit. Le bien doit être financé par l’impôt.
Il ne faut pas oublier qu’un bien n’est pas excluable en fonction de la technique du moment. Une émission de télé semblait non-excluable jusqu’au jour où on a inventé un système de cryptage performant.
En général, les biens individuels sont plus facilement excluables que les biens collectifs (le chauffage de ma maison, un concert dans la rue). Mais c’est une erreur car il est aisé de trouver des biens collectifs excluables. Un concert dans un lieu fermé est excluable. Il faut donc, pour réfléchir aux mesures destinées à rendre un bien excluable, se poser la question du coût de production de la technique d’excluabilité, et du coût de propriété. Il faut que ceux-ci ne dépassent pas le revenu que l’on attend de ce bien.
Un bien non-excluable doit-il forcément être financé par l’impôt ? Cela revient à imposer les préférences des gens qui sont au pouvoir : l’Etat est censé mieux connaître les véritables intérêts des individus que les individus eux-mêmes !
C’est ici que Coase apporte une solution révolutionnaire : le contrat conditionnel. J’en reparlerai plus loin. En gros, il consiste à attribuer des droits de propriété à tous les acteurs, qui n’en avaient pas auparavant. La solution, issue de la libre négociation des parties, est alors efficiente. La moralité de tout cela, c’est qu’il n’y a pas de définition objective du bien public ou du service public. Le bien ou le service public, c’est celui que l’Etat reconnaît comme tel. Léon Duguit ne disait pas autre chose. C’est parce qu’il bien est produit par l’Etat en grande quantité qu’il devient, à terme, public.
En appliquant ces réflexions, Mancur Olson en vient à dire que loin de refléter un soi-disant « intérêt général », le bien commun ou l’interaction de tous les groupes d’intérêt, ou même seulement la volonté de la majorité, les décisions sont prises en réalité en fonction des catégories d’intérêts qui parviennent à s’organiser parce qu’ils concernent un petit nombre de gens. Les subventions, payées par un grand nombre de gens, ne sont en réalité versées qu’à quelques personnes. Celles-ci sont organisées, à la différence des contribuables, qui sont incapables de protester.
Le théorème de Coase
Avec Coase, se pose la question de la définition et du coût des droits de propriété. Jusqu’alors, on appliquait aveuglément le principe polleur-payeur de Pigou. Le « coût social » d’une pollution étant supérieur au « coût privé » pour l’entreprise, il faut donc taxer (ou subventionner dans le cas inverse). L’intervention de l’Etat est donc toujours de mise.
Or on sait bien à présent que l’Etat ne peut pas ne pas substituer ses propres préférences à celles des particuliers. Et bien sûr, parler des « préférences de l’Etat » ne veut rien dire. C’est une expression qui anthropomorphise l’Etat. L’Etat, en lui-même, ne peut avoir de préférence. Les hommes qui composent cet Etat, eux seuls, peuvent en avoir. Ce que Coase montre, c’est qu’il est plus efficient de laisser pollué et pollueur négocier entre eux. Et peu importe quelle est la répartition initiale des droits de propriété. Par exemple, si une usine a un droit de propriété sur l’air environnant, qui lui permette de polluer librement, les propriétaires du camping voisin vont le transformer en champ de carottes. Si tous, et donc y compris les propriétaires dudit camping, ont un droit sur l’air environnant, qu’ils peuvent vouloir pollué ou non pollué, ils vont s’entendre avec l’usine pour qu’elle leur achète leur droit, de telle sorte qu’elle puisse continuer à polluer comme bon lui semble. Quelle que soit l’attribution au départ des droits, si on laisse les parties négocier librement, la solution choisie est la même et elle est efficiente. Les droits se déplacent vers ceux pour qui ils ont la plus grande valeur, et ce déplacement est efficient.
Mais il faut pour cela que les coûts de transaction soient nuls. S’ils ne le sont pas, les négociations entre les propriétaires du camping et l’usine peuvent être longues et difficiles. C’est dans ce cas qu’une intervention extérieure est nécessaire. Les institutions existent non pas seulement pour réduire les coûts de transaction ; elles existent parce que les coûts de transaction ne sont pas nuls.
La taxation peut alors éloigner de l’efficience. Si, en s’équipant en filtres, une usine échappe à la taxe, la solution n’est pas efficiente : l’efficience, c’est la pollution. Car le coût des filtres est plus élevé que le coût de la transformation du camping en champ de carottes.
Le théorème de Coase est un formidable défi aux juristes. Si la propriété peut être définie comme le droit d’exclure autrui d’un bien, alors elle a un caractère absolu. Ce qui signifie qu’autrui ne peut empiéter sur ma propriété en faisant appel à l’intérêt général, ou à quoi que ce soit. Le fait que le droit de propriété ne peut être déduit ou transféré que par le consentement du propriétaire en fait un droit absolu.
Posner ajoute que l’efficience justifie le caractère absolu du droit de propriété, dans le cas où les coûts de transaction sont faibles. S’ils sont élevés, la reconnaissance de droits absolus est inefficiente. Par exemple, je ne puis avoir un droit de propriété absolu sur les ondes, car je ne puis empêcher celles-ci de pénétrer dans ma maison. Des mécanismes alternatifs doivent être mis en place : règles de responsabilité, instauration d’un domaine éminent, zoning. Autrement dit, dès que les coûts de transaction empêchent les droits de propriété d’être achetés sur le marché par ceux qui les valorisent le plus, ces droits doivent être définis à l’avance le mieux possible de manière autoritaire ; ensuite, on laisse jouer le mécanisme des responsabilités et/ou on réglemente.
Philippe insiste enfin sur l’alternative, la summa diviso, opposant la règle de responsabilité et le droit de propriété.
![]() la règle de responsabilité : elle relève du tribunal civil, le niveau de preuves requis est faible car le procès se terminera (éventuellement) par le dédommagement du demandeur par le défendeur. La « peine » est donc un simple transfert d’une personne à une autre. L’auteur du dommage a droit à une compensation ; le dédommagement doit être égal au dommage.
la règle de responsabilité : elle relève du tribunal civil, le niveau de preuves requis est faible car le procès se terminera (éventuellement) par le dédommagement du demandeur par le défendeur. La « peine » est donc un simple transfert d’une personne à une autre. L’auteur du dommage a droit à une compensation ; le dédommagement doit être égal au dommage.
![]() le droit de propriété : il relève du juge pénal. Le niveau de preuves requis est plus élevé, car l’accusé risque la prison, voire, dans certains pays, la peine capitale. La peine est ici une diminution de bien-être pour le prisonnier – et pour la société qui doit assurer son entretien. Le voleur sera puni de telle façon qu’il n’est pas dans son intérêt de voler. La punition est donc dissuasive.
le droit de propriété : il relève du juge pénal. Le niveau de preuves requis est plus élevé, car l’accusé risque la prison, voire, dans certains pays, la peine capitale. La peine est ici une diminution de bien-être pour le prisonnier – et pour la société qui doit assurer son entretien. Le voleur sera puni de telle façon qu’il n’est pas dans son intérêt de voler. La punition est donc dissuasive.
Pourquoi la protection de la propriété relève du pénal, et non du civil ? Parce que le dédommagement est difficile et coûteux à calculer, et il ne satisfait jamais la victime complètement. Protéger la propriété uniquement avec des règles de responsabilité pourrait donc aboutir à des résultats inefficients. La meilleure méthode, c’est d’appliquer dans ce cas un droit de propriété, relevant du pénal. C’est uniquement lorsque les coûts de transaction sont plus élevés que les frais de procédure, qu’il vaut mieux se fier au droit de la responsabilité.
Cette explication un peu fumeuse de Philippe me laisse, pour l’instant, sur ma faim.
Voir en ligne : Premi
![]() Article paru initialement sur le blog de Copeau
Article paru initialement sur le blog de Copeau
[1] c’est à dire les hommes de l’Etat, car l’ « Etat » n’en pas une entité réifiée, mais le jouet entre les mains des puissants
[2] C’est Nelson qui fera cette provocante remarque, dans Economics as Religion, from Samuelson to Chicago and Beyond, Pennsylvania University Press, 2001.
[3] H-H Hoppe, Democracy – The God that Failed, The Economics and Politics of Monarchy, Democracy and Natural Order, Transaction Publisher, 2002.
 Contrepoints
Contrepoints