Accueil > International > Affaires étrangères > L’Amérique et le Moyen-Orient sans sentiment
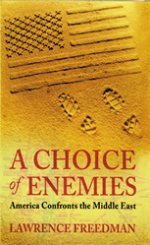 L’Amérique et le Moyen-Orient sans sentiment
L’Amérique et le Moyen-Orient sans sentiment
lundi 27 avril 2009
Beaucoup de gens au Moyen-Orient n’ont pas besoin de ce livre pour savoir parfaitement pourquoi les Etats-Unis sont au Moyen-Orient : pour lui voler son pétrole et protéger Israël, qui n’est rien d’autre qu’un instrument de la politique étrangère américaine. Sauf que ceux qui ont eu la chance de lire des oeuvres européennes sur le sujet, notamment Mein Kampf, best-seller permanent dans les pays arabes, soutiennent que ce sont les Etats-Unis qui sont l’instrument des Juifs, tandis que d’autres encore trouvent le moyen de soutenir ces deux idées à la fois.
Il est certain qu’il y a beaucoup de gens, en dehors du Moyen-Orient, qui s’accrochent eux aussi à la définition simple des motifs américains, et pas seulement en terre musulmane ou dans des épicentres où l’on théorise la conspiration comme en Grèce, c’est le cas même en Europe occidentale à en juger par sa presse, telles les chroniques de Sergio Romano dans le respectable Corriere della Sera italien, pour ne citer qu’un seul exemple.
Mais, dans beaucoup de cas, ce genre d’idées doivent peu, voire rien, à l’anti-américanisme, ou même à l’antisémitisme. Des gens raisonnables et pragmatiques, n’ayant pas ce genre de préjugés, mais qui croient à tort que des gouvernements entiers sont aussi pragmatiques qu’eux, trouvent raisonnable et, d’une certaine manière, réconfortant, d’invoquer le pétrole pour expliquer l’empressement des Américains à gaspiller des sommes folles et des vies humaines au Moyen-Orient. Ce fut en grande partie le cas de la guerre britannique des Malouines en 1982. Pour expliquer pourquoi les Britanniques montaient une expédition de reconquête qui comportait des risques terrifiants, ne serait-ce qu’en raison des distances extravagantes, les commentateurs étrangers citaient systématiquement la présence de vastes réserves de pétrole off-shore autour des îles ténébreuses. Pour beaucoup de gens, en Europe notamment, c’était une explication rationnelle rassurante, qu’ils pouvaient comprendre et pour laquelle ils pouvaient avoir de la sympathie. Ils la préféraient à l’idée d’une Grande-Bretagne esclave d’une conception ancienne de l’honneur national, obsédée par des images martiales d’elle-même, méprisant totalement les latinos en armes et surtout incurablement belliqueuse, au point que son Premier ministre gagna une grande popularité, malgré des pertes qui auraient fait tomber n’importe quel gouvernement sur le continent.
On n’a jamais trouvé ni pétrole ni gaz aux Malouines, alors qu’en Irak, les deux gisent en énormes quantités. A lui seul, le gigantesque champ pétrolifère de Kirkuk (le feu éternel, alimenté par les émissions de gaz, de Baba Gurgur est mentionné par Hérodote) produit un million de barils par jour ; il contient dix autres milliards de barils et ce n’est que l’une des principales structures d’Irak déjà en production, d’autres étant prêtes à être développées. Mais, si l’on s’en tient à ces deux théories sur les réserves de pétrole, il n’y a pas de différence entre les deux cas puisque les Etats-Unis n’ont rien fait pour accaparer le pétrole irakien. Par ailleurs, ils n’ont pas fait grand chose pour empêcher le pillage et le sabotage des champs ou des pipelines, si bien que l’Irak produit beaucoup moins qu’il pourrait, ce qui est très fâcheux car deux millions de barils par jour en plus feraient un peu baisser les prix du pétrole (il est vrai que c’est le point de départ d’une autre théorie de la conspiration, mais elles sont sans fin). En même temps, dans le monde réel, l’administration Bush est fortement critiquée par la campagne d’Obama pour ne pas avoir réclamé à l’Irak le remboursement d’une partie du coût de la guerre à l’aide de ses importants revenus pétroliers. En outre, les compagnies américaines se plaignent plus discrètement que le gouvernement irakien soit plus pressé de signer des accords de partage de production avec les Chinois qu’avec eux.
En bref, il ne s’est rien passé depuis l’invasion de 2007 - même la célèbre loi pétrolière de l’an dernier, censée avoir été imposée aux Irakiens qui n’en voulaient pas, mais qui est en fait conforme aux normes - qui vienne à l’appui de la théorie des réserves de pétrole. Alors que cette théorie est largement contredite par ce qui est advenu ou ce qui n’est pas advenu, elle continue pourtant à courir chez des gens bien informés. Ils ont des sourires entendus en citant le précédent poste du vice-Président Cheney à Halliburton ou les amis de George W. Bush dans le pétrole, à l’époque où il était un spéculateur plutôt raté, pour expliquer pourquoi les Etats-Unis sont allés en Irak. En fait, ce sont eux les innocents, ne serait-ce que pour penser que des Américains comme Bush ou Cheney font du sentiment à l’égard d’anciens employeurs ou d’amis dans le commerce.
Du fantasme à l’hypothèse
Reste à expliquer l’invasion de l’Irak en 2003, et la théorie du « pétrole plus Israël » est bien plus facile à avaler que l’enchevêtrement de raisons qui se sont combinées pour persuader le Président Bush de déclencher la guerre qui se poursuit encore. Le motif le plus difficile à accepter est précisément celui qui paraissait le plus déterminant à cet observateur qui connaît les protagonistes depuis très longtemps : le désir de combattre l’extrémisme et le terrorisme islamistes en amenant la démocratie aux Arabes à travers l’exemple d’un Irak démocratique et prospère, obtenu en éliminant la dictature de Saddam Hussein. En fait, cette séquence reposait sur des théories politiques et culturelles successives qui étaient extrêmement contestables, la toute première était même absolument invraisemblable. Il s’agit de l’hypothèse que les populations d’Irak se mettraient spontanément à agir de manière démocratique dès qu’elles seraient libérées de l’oppression, à la manière de l’administration démocratique du Danemark en 1945, ou du moins le lendemain matin, compte tenu de la joie enivrante de l’événement. Dans son très substantiel essai explicatif, Lawrence Freeman montre, parmi beaucoup d’autres choses, comment ce genre de fantasme est devenu une hypothèse politique. Il ne s’agit pas d’un énième ennuyeux ouvrage polémique sur « ce qui a échoué » au Moyen-Orient, ni une simple étude des événements récents ou une oeuvre détaillée d’historiographie à la manière de l’histoire officielle, très admirée par l’auteur, de la guerre des Malouines.
Je peux ajouter au récit que fait Freedman dans A Choice of Enemies une simple anecdote sur la raison pour laquelle des hypothèses idiotes ont résisté à l’examen. Lorsque, dans une réunion militaire préparatoire à l’invasion, j’ai affirmé que les Irakiens seraient incapables de faire fonctionner un gouvernement démocratique, le représentant du Pentagone, venu présenter la politique de guerre aux officiers qui dirigeraient la campagne, a catégoriquement rejeté la possibilité que la population d’un pays ne soit pas prête pour la démocratie et a poursuivi en soutenant que les Irakiens étaient « très éduqués », voire « immensément compétents ». Plus tard, pendant la même réunion, j’ai soutenu un officier supérieur qui réclamait des troupes supplémentaires spécifiquement destinées à contenir le pillage. J’ai, pour cela, cité l’explosion de vandalisme et de vols en 1991, à la fois dans les classes inférieures urbaines chiites et chez les bédouins sédentarisés, qui s’en étaient même pris aux cliniques et aux écoles que fréquentaient leurs propres familles. Le même représentant de la politique du Pentagone a contesté l’idée qu’il fallait des troupes supplémentaires, qui auraient retardé l’invasion, et a qualifié mes remarques de racistes. Pour lui, il n’y avait pas de différence entre les Danois et les Irakiens. Si bien que, par exemple, le musée archéologique de Bagdad n’aurait pas besoin de plus de protection que le Nationalmuseet de Copenhague ou, dans le même domaine, les très nombreux musées italiens qui sont restés intacts entre le repli des Allemands et l’avancée des Alliés, protégés seulement par le civisme des citoyens locaux. Tous ceux qui ont blâmé les Américains pour les vols du musée de Bagdad doivent donc être des racistes eux aussi, puisqu’ils ont supposé qu’il fallait des soldats étrangers pour protéger des trésors nationaux.
Les imbéciles et les sages
L’analyse succincte, mais complète, des motifs possibles et probables de l’invasion de 2003 intervient dans le dix-huitième chapitre de Freedman, « Regime Change ». Il ne commence pas par Abraham ou par les premiers engagements américains dans la région avec le bey de Tunis, pirate, mais sympathique, et le non moins pirate, mais antipathique, bey de Tripoli. Freedman préfère commencer par deux prologues jumeaux sur la première réaction de l’équipe Bush au 11-septembre et sur ce qu’il appelle la première « vague raciale » au Moyen-Orient, c’est-à-dire l’essor et la chute du nassérisme qui, dans la période postérieure à Nasser, eut pour conséquence de déclencher la guerre de 1973 dans le contexte de la guerre froide. Les cessez-le-feu qui suivirent, où Henry Kissinger en personne servit de médiateur, marquèrent en fait le début du processus de paix israélo-arabe. L’essentiel du texte de Freedman commence après cela, les administrations présidentielles successives lui servant de thème organisateur. Ce qui signifie que son livre commence avec l’infortuné Jimmy Carter et ses illusions de compétence et avec les savants imbéciles autour de lui qui furent de faibles substituts de Kissinger.
Mais dans les affaires humaines, dans lesquelles absolument tout est possible, les imbéciles réussissent parfois mieux que les sages, fût-ce par inadvertance. Le 1er octobre 1977, l’administration Carter dévoila sa brillante idée en lançant des invitations à une conférence de paix totalement co-organisée avec l’Union soviétique. Le nouveau Premier ministre israélien, Menachem Begin, avait bien appris le russe pendant ses interrogatoires nocturnes, lors de sa détention en Sibérie pour sionisme, mais, de manière assez étrange, le condominium de Moscou ne l’enthousiasmait pas, peut-être parce que l’Union soviétique avait rompu ses relations diplomatiques avec Israël en 1967, et avait depuis monté une campagne de propagande internationale d’une implacable hostilité et qu’elle armait abondamment tous les ennemis d’Israël.
Quant à Anouar el-Sadate, il avait expulsé d’Égypte les conseillers soviétiques en 1972, suscitant ainsi l’extrême hostilité de Moscou, et avait volontiers collaboré aux efforts de Kissinger pour évincer l’Union soviétique du Moyen-Orient. Confronté au plan inexplicable de Carter consistant à le remettre sous la tutelle de Moscou, Sadate créa sa propre réalité en annonçant son intention de se rendre à Jérusalem pour parler à la Knesset. Je me rappelle encore la réaction comique de Zbigniew Brzezinski : il était vexé que Sadate ait gâché les plans soigneusement préparés qui prévoyaient une progression pas à pas vers des pourparlers indirects, puis peut-être directs, sous contrôle américain, en faisant tout cela d’un coup et d’un seul. Le public égyptien regarda à la télévision, sans y croire, la chaleureuse réception réservée à Sadate par les figures mythiques qu’ils pouvaient facilement reconnaître - Moshe Dayan le borgne, Ariel Sharon à la carrure d’ours, Golda Meir - et ils répondirent en accueillant avec enthousiasme le cortège de Sadate à son retour.
Carter et l’Iran
Il s’avéra qu’il n’y avait pas lieu de se sentir déçu et que ce capiteux enthousiasme du début présageait vraiment l’avenir : la restitution par Israël de toute la péninsule du Sinaï en échange d’un traité de paix avec l’Égypte fut suivie au fil des ans par la débellicisation progressive des relations entre les États arabes et Israël. La Syrie est le seul État arabe qui soit en théorie encore en guerre contre Israël ; la plupart des autres États arabes ont à présent des relations officielles, semi-officielles ou non officielles avec lui. Cela ne se serait pas produit sans la brillante idée de Jimmy Carter et de ses hommes.
Il est bien triste qu’il n’y ait pas eu de deus ex machina comme Sadate pour sauver le monde de leur brillante idée suivante, celle qu’il fallait s’accommoder de l’opposition au régime du Shah plutôt que de l’écraser résolument avec autant de force que nécessaire. Bien trop faible en esprit et en volonté pour agir de lui-même, le Shah attendit en vain des ordres de Washington, pendant que le clergé extrémiste de l’ayatollah Khomeyni et tous ceux qu’ils mettrait ensuite hors la loi et persécuterait se rassemblaient pour démanteler le régime. Lorsque, ensuite, le personnel de l’ambassade américaine à Téhéran fut capturé et maintenu prisonnier (otage était un terme impropre), Carter négligea de faire observer l’ancien impératif de l’immunité diplomatique que même Attila, le Hun, avait explicitement respecté, en envoyant des bombardiers du commandement aérien stratégique infliger une punition bien méritée. Il préféra utiliser sa dernière réunion avec les commandants de la tentative malheureuse de sauvetage pour les exhorter à éviter une « tuerie gratuite », car il était extrêmement inquiet à l’idée que le soutien aérien qui accompagnait la force de sauvetage puisse être utilisée pour régler leur compte aux Iraniens. Ce fut en définitive l’élection de Ronald Reagan qui permit la libération des diplomates au bout de 444 jours. Khomeyni et ses hommes les relâchèrent en effet le jour de l’inauguration pour humilier davantage Carter et éviter le châtiment que Reagan n’aurait pas tardé à leur infliger. Ce qui, en un sens, était malheureux car les successeurs de Khomeyni continuent à se pavaner comme s’ils avaient gagné de nombreuses guerres bien qu’ils n’en aient livré qu’une seule, avec l’Irak, et qu’ils l’aient perdue.
Même si l’objectif de Freedman reste d’étudier les politiques et les actions américaines ainsi que les perceptions qui les mettaient en mouvement, ses analyses de la révolution en Iran, de la première aventure du processus de paix entre l’Égypte et Israël et de l’invasion russe en Afghanistan, dans les chapitres consacrés à Jimmy Carter, décrivent les conditions sur le terrain avec suffisamment de détails et de pénétration pour nous instruire sur ces événements. Les chapitres magistraux sur Carter sont suivis par ceux consacrés à Reagan, qui sont tout aussi efficaces : sur la résistance en Afghanistan (dans laquelle j’ai eu une petite part, que je ne regrette pas, car battre l’Union soviétique valait tout ce qui en est résulté), sur la guerre entre l’Irak et l’Iran, sur l’imbroglio Iran-Contra et sur la guerre aujourd’hui oubliée, dans tankers - qui, en ces jours de menaces iraniennes en l’air, reste très pertinente.
La force de Reagan
Freedman reconnaît la force essentielle de la clique de Reagan - elle savait récompenser les amis et blesser les ennemis -, sans pour autant négliger les erreurs et les absurdités qui résultaient de trop de controverse sur la politique (George Schultz au département d’Etat et Caspar Weinberger à la Défense, deux ex-cadres de Bechtel que de doux rêveurs accusaient d’infléchir la politique américaine en faveur de Bechtel alors qu’ils étaient en désaccord sur absolument tout), ou le manque d’examen critique de la politique, comme dans l’affaire Iran-Contra, où l’on ne parvint pas à arrêter les aventuriers.
En 1982, Israël mena sa guerre du Liban sous la surveillance de Reagan pour abattre l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) d’Arafat, qui était en train de constituer une véritable armée, complétée par des tanks soviétiques pourvus d’équipages entraînés par les Soviétiques. A l’époque, c’était la principale menace, même si son élimination en a fait naître d’autres, bien que moindres, dont, bien sûr, le Hezbollah actuel au Liban qui, à son tour, simule la force militaire avec des poses théâtrales à la Mussolini.
Bush sénior
Les combats de 1982, qui eurent Beyrouth pour théâtre, firent beaucoup pour réduire l’affection de Reagan pour Israël et accrurent l’hostilité, qu’éprouvait déjà auparavant son vice-président et successeur, George H. W. Bush. C’est pourquoi la toute première directive sur le Moyen-Orient du Conseil national de sécurité de la première administration Bush prescrivait à la fois de réduire les relations avec Israël et d’augmenter les relations avec l’Irak. Cela aurait pu se produire si Saddam Hussein avait su qu’il avait de bons amis à Washington ; mais il préféra envahir le Koweit, en août 1990, à un moment où l’effondrement de l’Union soviétique venait de supprimer la plus grande limite à l’usage de la force militaire américaine. Il ne fait pas de doute qu’être un dictateur sanguinaire a des compensations, mais cela rend très difficile d’éviter les bévues politiques, parce qu’autour de vous, tout le monde applaudit servilement ce qu’il faudrait critiquer. En ne se retirant pas du Koweit lorsqu’il pouvait encore le faire en toute impunité, Saddam Hussein permit à l’administration Bush de réunir une grande coalition contre lui et de mener la guerre avec un succès complet. Car on réussit à libérer entièrement le Koweit alors que la destruction du régime de Saddam Hussein n’était qu’un espoir et non un objectif politique à poursuivre par les armes. A l’époque, je travaillais au Pentagone et je me souviens distinctement qu’aucune personnalité importante n’appelait à marcher sur Badgad, y compris certains qui par la suite prétendirent l’avoir fait. Il était en effet trop évident qu’éliminer le pouvoir de Saddam Hussein exigerait de transformer l’Irak en garnison contre l’Iran et de convertir des divisions entières de l’armée américaine en force de police mésopotamienne. Le triomphe personnel de Bush senior ne fut gâché que par la nécessité, imposée par la guerre, de revaloriser les relations avec Israël à son grand regret, et par la conséquence inattendue de ces victoires générales. Les Américains n’avaient plus besoin de lui pour résister à Saddam Hussein, qui avait été battu, ou à l’Union soviétique, qui s’effondrait. Cela permit la victoire de Clinton, qui était largement due à sa promesse de ne pas faire sérieusement de politique étrangère, ce à quoi il parvint presque en ne faisant pas de politique étrangère sérieusement.
Entre des entreprises bien plus sérieuses au Moyen-Orient, chaque administration américaine successive s’est engagée dans un futile processus de paix israélo-palestinien dont les échecs contrastent fortement avec les progrès cumulatifs des relations entre Israël et les États arabes.
Mais même des tentatives ratées, comme les accords d’Oslo, ont contribué à permettre à Israël de célébrer son soixantième anniversaire avec une population qui a été multipliée par 10 et rendue prospère par une économie multipliée par 90 (comme si la population du Royaume-Uni était passée à 400 millions d’habitants et avait l’économie de loin la plus importante du monde) ; il est regrettable, bien sûr, qu’en poursuivant d’autres priorités, leurs dirigeants successifs aient en revanche appauvri de nombreux Palestiniens, mais ils sont les seuls à pouvoir remplacer leurs chefs par des personnalités plus sérieuses. Ainsi Clinton n’a pas réussi à conclure d’accord avec Arafat de même que George W. Bush n’est pas parvenu à conclure d’accord avec Abbas, mais, bien sûr, Bush, sinon Clinton, a entrepris beaucoup plus au Moyen-Orient, dont l’invasion de l’Irak, qui s’achèvera peut-être par une victoire, à la surprise générale (y compris à la mienne), et le combat global contre l’extrémisme islamique violent auquel Freedman reconnaît à juste titre un succès plus certain, tout en notant la fâcheuse situation afghane et la fragilité du Pakistan. Du Maroc à l’Indonésie, les djihadistes, autrefois entourés par les acclamations publiques, se cachent à présent de leurs coreligionnaires qui les pourchassent, ce qui n’est pas un mauvais résultat. Il serait fastidieux de noter des désaccords de moindre importance avec un excellent livre, extrêmement bien écrit, qui donne envie de lire la prochaine édition qui comprendra un nouveau chapitre consacré au nouveau Président des États-Unis.
![]() Article paru dans Commentaire, printemps 2009.
Article paru dans Commentaire, printemps 2009.
 Contrepoints
Contrepoints
Messages
1. L’Am, 11 juin 2009, 14:27, par DELPY
Que d’ang