Accueil > Politique > Actualité politique > Sur la transparence du politique
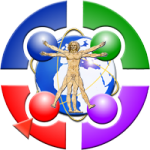 Sur la transparence du politique
Sur la transparence du politique
Voici un très beau texte humaniste, qui répond avec brio à la tentation de l’universalisation de l’homme contemporain. La pensée politique, et pas seulement politique d’ailleurs, n’existe qu’en tant qu’elle s’enracine dans du particulier. C’est ce que ce site s’efforce de montrer, à défaut de le démontrer. Voici pourquoi au concept fumeux de commune appartenance à l’espèce humaine (ce qui est l’évidence et n’apporte rien à la réflexion) il faut lui préférer l’homo politicus. C’est la condition indépassable de notre liberté.
mardi 13 novembre 2007
La communauté stoïque
Le monde dont nous avons aujourd’hui le souci n’est plus formé de peuples, de nations ou d’empires, il est le Monde que le regard embrasse d’un seul coup d’œil. La question politique acquerrait ainsi une transparence inédite. Partout on pourrait en effet détecter l’universalité d’un même lien social, partout on pourrait s’en remettre à l’homogénéité de la communauté humaine débarrassée de l’entrave des nations et de toute autre forme intermédiaire. Pourtant la célébration du Monde comme totalité réconciliée ne s’accompagne d’aucune sérénité. A l’opposé, elle génère une violence presque inédite dans la pensée politique contemporaine, à savoir la violence avec laquelle l’opinion dominante détecte en toutes formes intermédiaires – au premier rang desquelles la nation – la survivance d’un arbitraire, d’une entrave à la sociabilité humaine. Sous couvert de la célébration d’une communauté humaine pacifiée opère ce qu’il n’est pas exagéré de qualifier de régression de la pensée de l’institution. La pensée assurée d’avoir l’humanité pour objet abolit le monde comme monde institué, c’est-à-dire comme le résultat d’un travail conscient, volontaire d’éloignement du monde tel qu’il est donné pour faire exister un corps politique. [3] La dimension instituée du monde est occultée voire dénoncée au nom d’une double critique de l’institution, celle-ci se trouvant simultanément accusée de déposséder l’individu de lui-même et d’enfreindre de sa particularité la cohérence du tissu de l’humanité. L’institution est simultanément le symbole de la totalité aliénante et de la particularisation arbitraire, dans tous les cas un obstacle sur le trajet de l’effectuation de l’individu autant que sur celui de l’avènement de l’humanité. L’institution est à la fois au-delà et en deçà du véritable sujet du politique : le genre humain, l’humanité.
Le concept de genre humain nous laisse croire en la possibilité d’une description continue du monde social. Où que nous soyons nous éprouvons toujours le fait d’une même texture. Le lien social existe lorsque le sujet a reconnu en son semblable un autre lui-même, " un autre exemplaire de l’espèce humaine [4] ". Or l’espèce humaine nous lie selon la généralité d’une détermination indifférente aux déterminations du monde social. Une fois la signification du semblable ramenée à ce degré de généralité, " le problème de l’inégalité ne se pose pas, car il n’y a pas de plus ou de moins dans l’appartenance à une espèce [5] ". Je suis lié à autrui parce que nous sommes, l’un comme l’autre, deux êtres humains. Le sujet pur que désigne le concept de genre humain est un sujet universel, un sujet abstrait. Il est l’homme tel qu’il existe au cœur de la forêt équatoriale ou bien habitant d’une mégalopole ou encore l’homme d’il y a cent mille ans. [6] Plus encore, le concept de genre humain, d’espèce humaine n’exige pas ces précisions. L’homme considéré comme membre de l’espèce humaine est " universel par état [7] ". Infiniment éloigné dans le temps ou dans l’espace, l’homme est toujours l’homme compris dans la plus générale des déterminations qui pèsent sur lui : la détermination de l’espèce. Rien, jamais, ne nous pousse à nous demander si un certain contexte modifie l’existence sociale de l’acteur, " nous sommes alors non seulement hors de la société, mais hors du monde empirique, dans la sphère de l’extra-mondain " [8].
L’humanité dont il est ici question est une humanité nécessairement réconciliée, sorte de sujet universel qui " n’exige qu’une égalité cosmopolitique, au sens des stoïciens [9] ". Le concept de genre humain décrit nécessairement un consensualisme, à savoir le principe d’une humanité universelle qui trouve confirmation de son image en chacun de ses sujets. Quelles que soient les latitudes, l’homme est l’homme, l’exemplaire d’une même espèce dans laquelle il serait aussi absurde que criminel d’introduire des hiérarchies. En quelque sorte, suivant en cela Mary McCarthy " Inside, we are all alike ". Or cette remarque ne saurait constituer une thèse politique, elle n’est qu’un constat anthropologique. Cadre neutre, la notion de genre humain en vient à masquer la diversité des contraintes réelles qui pèsent sur l’action politique. Rapportés au plan abstrait du genre humain, les hommes ne souffrent pas, ils ne subissent aucun joug : " le sujet pur [...] est invulnérable, il n’offre pas de prise au malheur, il est donc étranger aux soucis politiques ordinaires [10] ". Le genre humain ne connaît que des égaux. Le plan de l’anthropologie avec lequel il se confond semble alors décrire une sorte d’humanité formelle – tous les hommes du fait de leur commune appartenance à l’espèce humaine participent à former l’humanité dans laquelle ils sont tous une subdivision, un segment de sa chair – recouvrant de sa trame sans déchirure le fait de l’humanité réelle où prévalent les inégalités, les subordinations de fait, les rivalités, celle où l’accord ne résulte pas de la seule concordance de nos gènes mais du conflit, où mieux de la discussion sur le bien-fondé, l’orientation bonne ou mauvaise des institutions, des régimes qui lient les hommes.
Une fois le plan politique absorbé dans ce constat anthropologique, c’est la légitimité du conflit politique qui disparaît, tout élément de discorde revenant alors à mettre en cause le fait de cette appartenance générale de chacun à l’espèce humaine, contestation nécessairement absurde et immédiatement suspectée de vouloir nier le principe de cette fraternité universelle. Nous sommes comme sortis du politique. L’abolition du conflit abolit le politique, la prétention à un écart avec le fait de notre appartenance à l’espèce humaine, la prétention à un logos qui délivre des déterminations de l’espèce. Le lien social se trouve posé comme fait accompli. Chacun se sait citoyen du monde, chacun n’a partout sur terre que des " semblables ". Chacun participe alors d’une communauté universelle et apolitique, communauté stoïque où l’universalité du lien humain se justifie à l’aune de l’universalité du fait humain. Ce qui est commun nous est donné, attribué par la nature, nous dispensant ainsi de le chercher, d’en débattre et plus encore d’en juger. Le concept de genre humain nous mène en amont du politique, tenant a priori pour acquis le fait de ce monde commun que le débat politique avait pour vocation d’instituer. Selon cette perspective, " ce qui est commun, c’est l’humanité même, le fait d’être homme, et en laissant ce fait-là dans sa féconde indétermination. C’est en effet une voie tentante car elle contourne l’obligation de rechercher difficultueusement ce qui est commun " [11].
La déchéance du politique
L’énigme politique est alors une énigme déjà tranchée. Le fait politique ou ce qu’il en reste se confond avec une sorte de métapolitique qui ordonne le fait humain selon le dénominateur commun de l’espèce, selon le principe de la coïncidence immédiate et jamais dépassée de la condition humaine avec elle-même. Jamais l’idée de genre humain ne donne prise aux déchirements du conflit, jamais le fait de notre appartenance à l’espèce humaine ne sera objet de débat. La parole humaine est rendue caduque. Communauté silencieuse, le genre humain tient pour un fait accompli la coprésence des sujets en une même trame ; est ainsi reconduit le principe d’une pure immanence de la société à elle-même. Où que nous soyons, " nous sommes tous des hommes " et ce constat abolit la pesanteur des circonstances, abolit tout ce par quoi l’homme se dévoile et affronte, en affrontant le monde, l’indétermination attachée à son être. A cette indétermination succède la pesanteur d’une nature déjà fixée qui rejette hors de nous tout ce par quoi notre humanité est susceptible d’advenir.
Le politique cesse d’apparaître comme le grand domaine de la vie humaine pour ne plus être qu’une pratique détachée de notre condition, il cesse d’être " la plus grande de toutes les réflexions sur la nature humaine [12] " dès lors que cette nature est irréductible à la capacité de l’homme à en débattre. Ainsi détaché de notre nature, il faut se garder du politique puisque le politique n’est rien d’autre qu’une tentative pour mettre en commun ce qui a déjà été donné comme commun, sorte de redoublement stérile de la réalité. Le propre de cette métapolitique est de souligner la fausseté du politique, à savoir l’impuissance des institutions humaines à faire exister un " commun " plus convaincant que le commun imposé par notre commune appartenance à l’espèce humaine. En peu de mots, l’écart entre l’homme et le citoyen est l’écart d’une trahison, d’un mensonge, le politique consacrant finalement non l’accomplissement de l’homme mais au contraire l’altération de la condition de l’homme dans celle du citoyen. Si une science politique demeure, elle ne peut être que la science de la sortie du politique, laissant de côté le monde tel que la parole peut s’en saisir, c’est-à-dire selon les limites, la particularité que les formes instituées imposent, niant la dimension logique, articulée de la vie humaine pour n’en retenir que la seule dimension incarnée. L’idéal universaliste du genre humain correspond à l’idéal d’un monde qui transcende la contingence des institutions et nie tout ce par quoi l’homme établir avec les autres hommes un lien irréductible au fait de la seule reconnaissance de l’espèce, un lien qui fait appel à ce qu’il y a en lui de spécifiquement humain.
Il y a dans l’idée d’humanité ainsi posée le principe d’une dépossession de l’homme de sa propre humanité. Nous sommes à proprement parler hors de l’humain et de son domaine. Le genre humain ne sait rien des hiérarchies proprement humaines, de l’amitié ou de la haine, de la proximité ou de la distance que respectivement elles introduisent entre les sujets. L’autre est toujours l’élémentaire du genre humain, qu’il s’agisse de mon contemporain anonyme, de mon meilleur ami ou bien qu’il s’agisse de mon pire ennemi comme l’ennemi de l’humanité entière. Sans critère du bien et du mal, c’est bien la même humanité qui unit Molotov et Ribbentrop lors de la signature du pacte germano-soviétique et de Gaulle et Adenauer lors de la réconciliation franco-allemande, humanité qui a pour étalon non pas l’humanité de l’homme, mais le nombre humain, l’humanité en étendue.
Le concept de genre humain projette toute réflexion dans le non-lieu et le non-instant, l’illocalité et l’intemporalité. Il abolit la capacité de chaque homme à se saisir de son monde, afin d’en débattre au nom de l’invocation purement nominale d’un " monde " qui nous précède, d’une espèce qui nous englobe, bref, d’une condition sur laquelle nous n’avons pas prise. Le sujet de cette humanité subit sa condition, il s’est comme rendu inaccessible à la discussion sur le bien et le mal, le juste et l’injuste dès lors qu’il n’est rien d’autre que la monade élémentaire d’un tout auquel il donne forme autant qu’il s’y trouve inclus. Une telle pensée qui célèbre l’avènement du genre humain est naturellement convaincue de laisser derrière elle le spectre de l’incorporation. C’est pourtant bien le principe d’une nouvelle incorporation qui prévaut à mesure que l’humanité se trouve célébrée comme un principe d’essence supérieure qui réunit la personne individuelle et la personne collective, corps commun homothétique [13] au corps de chaque individu qui les rassemble et les subsume à la fois. Cette représentation de lien humain prétendument délivrée des formes incorporatrices de la cité, de la nation, finit par rendre à l’observateur l’assurance d’une structure organique du monde social, l’assurance d’une essence commune actualisée en essence du commun.
Néanmoins, autant l’esprit est voué à retrouver dans cette " libération " la figure incorporatrice de l’Un, autant il ne peut se dégager de la figure d’une multiplicité qu’il ne parvient pas à ordonner. Dès lors que l’attention de l’observateur porte exclusivement sur la trame de cette commune humanité qui nous lie tous en elle, celui-ci ne peut surmonter l’obstacle du relativisme. Comparant les différents types de structures sociales, il ne saurait admettre l’existence d’un clivage entre les formes de sociétés politiques, il demeure indifférent à la notion de régime quand bien même elle permettrait d’opposer la démocratie moderne et le totalitarisme. Rassurée par la certitude d’une vérité unique, cette pensée échoue doublement en se montrant doublement inhumaine. Célébrant l’homme au singulier, à savoir l’espèce et ses représentants, elle peint un " monde qui n’est pas de notre monde " dans lequel l’individu perdrait dans le corps commun de l’humanité jusqu’au symbole éminent de sa propre individualité alors même que rien dans cette humanité ne lierait suffisamment pour l’ouvrir à autre chose que lui-même.
Le lien politique
Tout se passe comme si la science politique pensait à la fois en deçà et au-delà de son objet, célébrant soit un nominalisme infra-politique – l’individu comme exemplaire de l’espèce – soit un organicisme supra-politique s’incarnant dans la figure de l’humanité considérée dans son universalité naturelle. La générosité mondialiste fait ici l’épreuve de la duplicité attachée à la figure de l’Un. Que l’on se réfère ici à la critique du " communisme " de la République de Platon par Aristote. Le désir de ne faire qu’un, de lier tous les hommes au corps d’un même tout, condamne la cité à la régression vers l’individu délié : " Si elle devient trop une, de cité elle retourne à l’état de famille, et de famille à celui d’individu [14] ". La figure de l’Un ne donne forme à aucun lien, elle consacre en fait " l’invasion d’une universalité abstraite, laquelle finit par réduire l’homme au dénominateur commun de l’intérêt individuel [15] ".
Le lien politique est étranger à la figure de l’Un qui en mettant le sujet immédiatement en présence du tout humain le laisse en fait demeurer dans sa solitude. La condition politique exige de rompre cette dualité, de se défaire de l’abstraction d’une commune appartenance au genre humain pour se référer au sujet comme un être socialement situé, objet de déterminations. La condition politique exige de rompre la trame régulière d’une humanité abstraite pour faire exister entre les individus des distances, des écarts, des vides qui scindent, distinguent nos situations, nos conditions et ainsi les rend visibles, interprétables, contestables, c’est-à-dire objet de parole. Nous touchons ici au paradoxe d’une déliaison qui se donne comme la condition préalable à l’apparition d’un monde en commun. C’est en effet au travers de ces déterminations sociales, politiques, que les sujets se voient, se comparent et se nomment comme acteurs d’un même monde, acteurs conscients d’une humanité qu’ils cessent de subir. C’est par ces écarts que l’homme échappe à la solitude et nourrit sur sa condition une discussion qui fait exister un lien entre lui et ses semblables.
Le lien politique suppose l’expérience de la discontinuité, la prise en compte de la partialité des situations particulières d’où chacun annonce " ce qui lui semble vérité [...] créant de ce fait ces distances entre les hommes qui, ensemble, constituent un monde [16] ". L’inter de l’interresse politique est celui d’une cassure, d’une mésentente [17] d’où le monde peut advenir comme objet commun, objet de discours. Le monde " ne se forme que dans l’intervalle entre les hommes dans leur pluralité [18] ". Chaque opinion particulière cherche à faire prévaloir sa vision du tout et toutes le manquent. Aucune n’a la vision complète du monde humain parce que toutes ne sont que des compréhensions partielles du monde humain, des compréhensions conditionnelles. L’homme n’est pas immédiatement rendu présent à l’image du tout-humain, de la société juste qui réalise l’harmonie entre les sujets. Entre lui et la société juste, il y a l’opacité du débat civique, la discussion sur la bonne forme de la société qui exige une vision partielle du bien commun, la partialité contenue dans la conscience d’un écart, d’un espace entre soi et autrui. C’est cette partialité qui relance la conversation civique, c’est parce qu’il ne coïncide pas avec la figure englobante d’une vérité unique que l’homme parle, qu’il définit sa conception des choses et se rend sensible à lui-même comme participant de ce tout. Nous désirons l’image de la société juste et nous n’y avons pas accès, nous pensons la saisir et un autre point de vue vient en corriger les contours. Il n’y a de lien politique que dans cette faillibilité de l’image de la société juste, dans notre incapacité à en avoir une image complète qui octroie à un autre que nous la possibilité de prendre part à sa genèse. Il y a dans cette faiblesse de notre condition l’essence de notre liberté, à savoir le manque qui nous voue au débat, imperfection à notre image et que nul ne peut prétendre dépasser " tant que la raison de l’homme sera faillible et qu’il aura la liberté de l’exercer [19] ". Faillibilité de la raison associée à la liberté de son exercice, c’est notre impuissance à donner une solution au problème politique qui nous oblige à le reposer sans cesse, inaugurant une discussion sans fin, désignant entre cet homme-là et celui-là, un objet commun, quelque chose qui les inter-esse. L’ébauche du tout que contient l’opinion particulière sur le tout contient une relation vécue au tout, une relation réelle avec lui. C’est cette ébauche perpétuelle, cette opacité de l’image du tout qui fait exister un monde, " espace à plusieurs voix ", où l’accord demeure à jamais retardé, où le conflit n’est jamais résolu mais éternellement dénoué.
Aussi vaste soit le monde, le monde humain réside là où se noue la discussion. Aussi vaste soit l’humanité, le lien politique nous ramène toujours vers le même lieu du litige qui introduit entre les acteurs l’écart du débat, qui délimite l’espace du conflit. En ce sens, " il n’y a pas de politique mondiale. Le " monde " peut s’élargir. L’universel de la politique, lui, ne s’élargit pas. Il reste l’universalité de la construction singulière des litiges [20] ". Le " monde " n’est pas, tel quel, le sujet du politique, il ne fait exister un lien que selon la multiplicité des constructions singulières qui abritent la discussion et rendent possible pour tous la visée d’un même monde.
Philosophie de la rupture
La communauté politique ne se révèle pas dans ce qui est donné comme commun. Elle est mise en commun, mouvement conscient qui exige de comprendre le monde humain comme " une communauté d’interruptions, de fractures, ponctuelles et locales [...], communauté de mondes de communauté qui sont des intervalles de subjectivation : intervalles construits entre des identités, entre des lieux et des places [21] ". C’est au travers de ces formes, dans la conscience de la pluralité infinie des situations possibles, des places qu’il peut occuper que le sujet advient et entame avec ses semblables une discussion qui ne se rapporte ni exclusivement à lui-même ni à une humanité générique mais aux hommes dans leur relations avec le même monde, à leurs positions, à leurs opinions. Un exemple frappant est fourni par cet article que Jean-Paul Sartre publia en août 1944 [22] dans lequel il énumérait les souffrances endurées par les Juifs. Sartre eut la surprise de recevoir des lettres de remerciements de déportés lui manifestant leur gratitude d’avoir osé réintroduire une détermination qui distinguait les Juifs du sujet abstrait de la pure humanité, rendant de ce fait une signification politique aux souffrances qu’ils venaient d’endurer. Sartre dépassait ainsi l’abstraction du sujet pur de l’humanité qui englobe autant la victime que le bourreau dans la commune détermination de l’espèce, pour, en distinguant à nouveau les Juifs de la totalité impersonnelle de la pure humanité, " rendre leur nom aux rescapés [23] ", à savoir distinguer à nouveau les bourreaux des victimes. De la même manière, Hannah Arendt rappelle que pendant de nombreuses années " la seule réponse adéquate à la question : " qui êtes-vous ? " était : " une juive " [24]. Réintroduisant une détermination dans la trame abstraite de la pure humanité, Hannah Arendt refusait la généralité englobante de l’humanité abstraite pour à nouveau " donner voix " à un peuple, faire intervenir une communauté dans le débat politique. " En disant : " une juive ", je ne faisais même pas référence à une réalité chargée ou mise en avant par l’histoire. Je ne faisais plutôt que reconnaître un présent politique [25] ". S’attachant à l’abstraction de la pure humanité, Arendt lui restituait ainsi son sens de séjour humain travaillé par des identités particulières, traversé par des conflits qui tous attestent que les hommes ont prise sur leur monde. Sans ces déterminations, il n’y aurait plus que des " hommes ", monades abstraites d’une humanité abstraite. Prévaudrait alors le renoncement au monde tel que les hommes l’habitent et participent à lui donner forme. " Ceux qui rejettent de telles identifications opérées par un monde hostile peuvent bien se sentir magnifiquement supérieurs au monde, mais leur supériorité n’est alors en vérité plus de ce monde ; c’est la supériorité d’un " Coucouville les Nuées " plus ou moins bien échafaudé " [26].
Le simple sentiment de partager la même condition humaine ne crée pas de politique dès lors qu’il fonde dans la généralité d’une même humanité tous les espaces, toutes les formes, où opère la " subjectivation politique [27] ", la particularisation a l’aune de laquelle nous comprenons notre situation et à partir de laquelle nous sommes capables d’élaborer un discours qui nous lie à autrui. Aussi, remarque Jacques Rancière, " le simple sentiment de l’essence commune et du tort qui lui est fait ne crée pas de politique [...] Il y manque encore la construction du tort comme lien de communauté avec ceux qui n’appartiennent pas au même commun " [28]. Pas même la souffrance ne serait susceptible d’attester de la concrétude de l’humanité, de lui donner un sens politique, si n’opérait pas " la construction du tort " qui limite l’espace dans lequel la souffrance devient une réalité politique vécue, qui de l’abstraction d’une souffrance commune ressentie en tout point de l’humanité établit que c’est ce peuple qui a subi le joug imposé par cet autre peuple au nom de cette idéologie. C’est rapportée à ces déterminations locales, singulières, que la souffrance acquiert un sens politique, que le crime atteint sa signification universelle en attestant d’une commune humanité bafouée.
Le lien politique exige qu’un ordre de déterminations vienne s’ajouter au simple fait d’être homme, il exige que le sujet s’élève au-dessus des déterminations de la vie pour faire exister un monde commun. C’est dans cet abri de formes particulières, au cœur de ces constructions que paraît le sens du lien qui unit les sujets. C’est dans la constitution et la reconnaissance de " figures politiques de l’altérité [29] " que se dévoile une commune humanité. Evoquant la possibilité d’une amitié entre un Allemand et un Juif dans les sombres temps du Troisième Reich, Hannah Arendt oppose le cas où ceux-ci auraient donné à leur relation le fondement d’une commune appartenance à l’espèce humaine – Ne sommes-nous pas tous deux des hommes ? – et le cas où, dépassant cette détermination biologique, une même amitié se serait tissée entre les deux hommes, dans la pleine conscience des circonstances et de leur identité respective. Le premier cas ne peut être " qu’une simple évasion hors du réel et hors du monde commun à tous deux à cette époque, nullement une prise de position contre le monde tel qu’il était [30] ", il ne peut reposer que sur la célébration d’une communauté abstraite fondée sur le déni de ce qui sous Troisième Reich distingue un Juif d’un Allemand et donc sur l’indifférence à la valeur exceptionnelle de cette amitié. L’autre cas suppose l’épreuve d’une détermination comprise, intériorisée. C’est cet homme-là et celui-là qui sont amis, tous deux conscients de ce qui les distingue. Ce sont les limites, les clôtures de ces identités particulières qui protègent l’espace dans lequel l’humanité n’est pas un concept mais une réalité politique vivante. C’est précisément parce qu’elle ne vise pas l’humanité dans son extension infinie qu’elle ne s’en remet pas à l’irréalité d’un " Tous " mais maintient une différence entre les sujets, un écart, que, partout où elle fut maintenue, une telle amitié fut réellement vécue, et par là même est réellement parvenue à accomplir une parcelle d’humanité.
Le particulier et l’universel
L’humanité n’est rien d’autre qu’une abstraction sans la médiation de formes particulières dans lesquelles l’universel humain n’est pas un concept mais une réalité politique vivante. La relation politique est ce qui ouvre, ce qui conditionne l’apparition d’une " chose commune ". Elle est simultanément ce qui ferme, ce qui entérine l’existence de ruptures, de limites, au sein desquelles l’expérience de l’autre prend forme. Aussi l’avènement de l’humanité s’alimente à " la conviction que le multiple fait signe vers une unité que la diversité cache et révèle en même temps [31] ".
L’individu se connaît et reconnaît en l’autre son semblable dès lors qu’il se donne le repère de quelque chose qui fait sens pour lui, de quelque chose de délimité qui lui renvoie l’image de sa particularité, de sa place dans le monde. C’est du fait de la délimitation de son champ d’expérience que l’individu peut y saisir un certain nombre de comportements concordants avec les siens et y trouver les indices de la présence d’autres qu’il peut identifier comme ses semblables. A l’opposé, la constitution d’une communauté sans borne censée rassembler la totalité du " fait humain " ne ferait qu’abandonner les individus au principe d’une totalité qui les dépasse, qui, en projetant sa propre image en chacun d’eux, annulerait en chacun le sentiment de sa propre individualité, abolissant du même coup la signification de l’autre comme semblable. Chateaubriand donne a ce constat toute sa mesure :
" La folie du moment est d’arriver à l’unité des peuples et de ne faire qu’un seul homme de l’espèce entière, soit ; mais en acquérant des facultés générales, toute une série de sentiments privés ne périra-t-elle pas ? Adieu les douceurs du foyer ; adieu les charmes de la famille ; parmi tous ces êtres blancs, jaunes, noirs, réputés vos compatriotes, vous ne pourriez vous jeter au cou d’un frère [32] ".
Fondée sur le principe d’une ouverture infinie, sans limite de son champ d’expérience, une telle " communauté universelle " priverait chaque sujet du repère d’une univers familier, elle contraindrait chaque individu à ne rencontrer que des différences dans le monde, en d’autres termes à n’avoir rien de commun avec les autres hommes. Ne pouvant ainsi mettre en évidence le moindre comportement concordant avec le sien, le sujet ne saurait percevoir l’humanité que comme un fourmillement d’êtres indéterminés sans que jamais il puisse reconnaître un semblable dans cette confusion d’êtres singuliers, " sans pareils ". Sous couvert de libérer les hommes des " ténèbres " de leur identité particulière, de la délivrer de la " caverne " de la cité ou de la nation où jusque là ils ont vécu, une telle communauté universelle ne ferait que les abandonner à l’immensité d’un monde sans repère, elle ne ferait que les éblouir dans la lumière d’un monde sans forme intermédiaire dans lequel rien ne les instruirait de ce qu’ils sont et de qui sont ces autres autour d’eux.
Il ne saurait y avoir d’expérience de l’humanité qui soit fondée sur une expérience de l’uniformité, sur le déni des formes intermédiaires de l’existence humaine à commencer par la nation. En effet, remarque Arendt, " tout comme l’homme et la femme ne peuvent être mêmes, à savoir humains, qu’en étant absolument différents l’un de l’autre, ainsi, le national de chaque pays ne peut entrer dans cette histoire universelle de l’humanité qu’en restant ce qu’il est et en s’y tenant obstinément " [33]. Aucune forme politique, cité, nation, ne se pose comme une entité distincte de nos existences particulières. En chaque forme politique se donne à lire le fait d’une mise en commun. Chaque forme particulière renouvelle et approfondit en elle l’expérience de l’altérité. Chacune abolit l’immédiateté de notre expérience de l’humanité mais, en retardant son avènement, chacune de ces formes respecte les distances dans lesquelles cette expérience a des chances de s’atteindre comme expérience humaine. Chacune de ces formes est l’espace dans lequel l’individu est compromis par l’autre, dans lequel il se trouve contredit dans l’illusion de sa complétude et par là se découvre humain, c’est-à-dire voué à l’autre. Dès lors, rien n’est plus éloigné de la nation que le nationalisme qui est l’affirmation de l’Un aux dépens de l’individu esseulé. La nation approfondit le sens de la sociabilité humaine alors que le nationalisme pose les bornes d’une totalité abstraite destinée à contenir des sujets désocialisés. Aussi " le nationalisme [...] est pour un peuple ce que l’égoïsme est à l’individu " [34], l’illusion d’être à soi-même ce tout indépassable qu’aucune rupture, aucun écart n’initie à la présence des autres.
La cité, la nation impliquent l’approbation d’une rupture, d’une limite instituant le lieu qui, en nous particularisant sur le fond indifférencié et continu de l’humanité entendue comme simple fait en extension, nous ouvrent à la signification de notre propre humanité, à l’humanité en compréhension. Seule la particularité de la cité ou de la nation peut, en donnant à chaque sujet le repère de quelque chose qui fait sens pour lui, apparaître comme le support, le mètre par lequel le sujet est capable, depuis sa position particulière, d’exprimer, de faire entrer dans le langage se propre expérience du monde et ainsi, au-delà de son irréductible singularité, d’atteindre à l’universel humain, à un ensemble d’expériences qui, bien que vécues de façon toujours singulière, valent pour tous en tout lieu et en tout temps [35].
La cité, la nation sont les témoins particuliers, l’abri, d’une même expérience de l’autre comme " semblable ", qui ne saurait se réduire à aucune de ces formes particulières. Chaque forme politique reconduit en elle le fait de cette reconnaissance de l’un par l’autre qui de proche en proche nous relie à l’humanité entière. C’est parce que la signification du semblable a cessé d’être une abstraction dans l’espace limité de la nation qu’elle peut ensuite se concrétiser dans l’espace sans limite de l’humanité. L’humanité universelle se constitue à partir d’une expérience chaque fois particulière de l’autre comme semblable. Chaque forme particulière atteint à l’universel, elle le montre, elle le réfléchit. Le sentiment de solidarité individuellement ressenti fait entrevoir une unité humaine. Une telle unité se donne dans le prolongement d’une expérience du semblable incluant l’expérience du conflit. " Comme dans toutes les choses humaines, l’unité, quand elle est authentique, n’apparaît qu’après une première diversité, parfois une contradiction [36] ", ce n’est pas l’Un qui est premier mais bel et bien la discontinuité et le divers se donnant non pas comme obstacle à l’avènement d’une communauté plus vaste mais comme le lieu d’où cette nouvelle unité peut être postulée et anticipée. Le particulier n’est pas le contraire de l’universel, mais le point d’où l’universel nous est réellement accessible. La nation ne contredit pas l’universel, elle n’offense pas l’humanité de sa particularité. Elle est, au contraire, ouverture sur l’universel, proposition d’une particularité qui y a rapport, qui le touche et le reflète. La nation est l’abri de l’universel [37], elle est ce lieu d’où tombe " du génie de l’homme quelques-unes de ces pensées qui deviennent le patrimoine de l’univers " [38].
La particularité de la nation donne forme à l’universel, elle permet de le faire entrer dans le langage, de le laisser paraître dans la particularité de chaque langue [39]. Chaque langue, chaque poésie implique le rapport à l’universel qui nous la rend accessible, qui nous rend sensible le même souci d’une " verticalité " dans le langage, l’idéal d’un même effort vers le haut qui détache la parole humaine du fond indifférencié de la langue [40]. L’oubli du particulier se traduit par l’abandon de cette verticalité de la langue pour lui substituer l’idéal de la communication, l’idéal d’un échange qui, s’efforçant de fondre chaque particularité en une image générale de l’ensemble humain, se fait négateur de l’universel auquel chaque langue, depuis sa particularité, est capable de nous donner accès. La communication ne dévoile pas l’universel à l’œuvre dans chaque idiome particulier. Elle le laisse demeurer dans sa particularité, se contentant de mettre en rapport chaque communauté avec les autres, de les lier extérieurement.
" De la fusion des sociétés résultera-t-il un idiome universel, ou bien y aura-t-il un dialecte de transaction servant à l’usage journalier, tandis que chaque nation parlerait sa propre langue, ou bien les langues diverses seraient-elles entendues de tous ? " [41]
L’universel n’est pas hors ou au-delà du particulier, mais dans le rapport avec le particulier. " Le génie, tout en étant fils d’une nation, appartient à l’humanité [42] ", la particularité, plutôt que de ne renvoyer qu’à elle-même, ouvre sur l’universel dont elle se veut le reflet, la formulation particulière ici et maintenant. En ce sens, la logique de la nation est de préparer son propre dépassement, d’être l’accès à une universalité qu’elle ne saurait prétendre contenir dans ses propres limites. La nation n’est donc pas une forme ultime, " et comme aucune culture ne peut revendiquer pour ses œuvres le monopole de la prétention à la validité universelle, la signification imaginaire " nation " ne peut que perdre son importance cardinale " [43].
Ecarter la nation au nom du rétablissement de la communauté universelle qu’elle est censée occulter revient à vider l’idéal universaliste de son sens en le vidant le tout contenu. Ecarter l’idéal universaliste d’une communauté humaine réconciliée au nom de la complétude que la nation serait censée incarner revient à vider la nation de sa vocation à être, ici et maintenant, une image concrète du genre humain. C’est dans l’espace limité de la nation, qu’un peuple donne un contenu concret à l’abstraction démocratique de la souveraineté du peuple et de la volonté générale. C’est ce peuple qui désire se gouverner lui-même et être représenté par un Parlement élu par les citoyens. L’universel n’est pensable qu’en résonance avec le particulier, l’universel commence et prend forme par une revendication, une injonction du particulier. Que l’on s’attarde sur les premiers mots de la Déclaration d’indépendance américaine : " Nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes que tous les hommes naissent égaux [44]… " Le sujet de l’universel n’est pas ici l’homme dans son abstraction, l’homme proclamé au nom du règne humain, il est l’homme qu’un " Nous " particularise et situe dans une communauté particulière, qu’un " Nous " lie à l’ancrage d’un Peuple particulier. La liberté n’est pas ici l’attribut proclamé d’une humanité abstraite mais la condition fondamentale du citoyen de ce peuple, à savoir la liberté dont l’exercice vécu fait exister une parcelle d’humanité.
Frédéric Tellier
In Commentaire 88, hiver 1999-2000.
[1] Alain Finkielkraut, L’Ingratitude. Conversation sur notre temps, Gallimard, NRF, 1999, p. 145.
[2] Hannah Arendt, Vies politiques, Gallimard, coll. " Tel ", 1986, p.27.
[3] Philippe Raynaud constate ce rejet contemporain de l’artificialisme : " Je conçois le corps politique comme artificiel [...] Il y a un élément de puissance artificielle qui était tout à fait central dans la formation de la philosophie politique moderne et qui est de moins en moins présent aujourd’hui dans la philosophie politique contemporaine, y compris chez ses représentants les plus éminents et les plus intéressants " (Philippe Raynaud, " Problèmes actuels de la citoyenneté ", in L’Action politique aujourd’hui, Association freudienne internationale, 1994).
[4] Vincent Descombes, " Universalisme, égalité, singularité ", in La Pensée politique, n°III, p. 335.
[5] Ibid.
[6] Nous pourrions dire à cet égard universalité synchronique et universalité diachronique (NdC)
[7] V. Descombes, ibid.
[8] Ibid.
[9] Ibid.
[10] Ibid, p. 331.
[11] Pierre Manent, " Note sur l’individualisme moderne ", Commentaire, n° 70, été 1995, Plon, p.264.
[12] Madison, The Federalist, n° 51, ed. Jacob E. Cooke, Meridian, 1961.
[13] Par principe homothétique, il faut entendre, dans la sociologie de D. Schnapper comme dans celle de P. Bourdieu, le principe d’organisation sociale qui, identique à la société, lui permet d’économiser le plus de ressources possibles (NdC).
[14] Aristote, Les Politiques, trad. P. Pellegrin, Livre II, 2, 1261-a 20, GF, 1993. Cf. également le manuel d’histoire des idées politiques de Philippe Némo (PUF, 1998) - NdC.
[15] Allan Bloom, " Rousseau, l’art, la modernité ", Commentaire, n° 76, hiver 1996-97, Plon, p.816.
[16] Hannah Arendt, Vies politiques, op. Cit., p.41.
[17] Jacques Rancière, La Mésentente. Politique et Philosophie, Galilée, 1995.
[18] H. Arendt, Vies politiques, op. cit., p.41.
[19] Madison, The Federalist, op. cit.
[20] J. Rancière, La Mésentente, op. cit., p.188.
[21] Ibid, p. 186.
[22] J-P Sartre, Réflexions sur la question juive, Gallimard, Folio Essais, 1986, p.87.
[23] Alain Finkielkraut, L’Ingratitude, op. cit., p.144.
[24] Hannah Arendt, Vies politiques, op. cit., p.27.
[25] Ibid.
[26] Ibid., p.28.
[27] Jacques Rancière, La Mésentente, op. cit., p.187.
[28] Ibid.
[29] Ibid.
[30] Hannah Arendt, Vies politiques, op. cit., p.33.
[31] Ibid., p.104.
[32] François-René de Chateaubriand, Mémoires d’Outre-tombe, Pléiade, Gallimard, 1969, p.923.
[33] H. Arendt, Vies politiques, op. cit., p.103.
[34] Paul Claudel, Journal, t.I, Gallimard, 1968, p.645. Claudel recopie ici une formule de Soloviev tirée de La Justification du Bien.
[35] Cf. la remarque bien connue de Chateaubriand : " Quelle serait une société universelle qui n’aurait point de pays particulier, qui serait ni française, ni anglaise, ni allemande, ni espagnole, ni portugaise, ni italienne, ni russe, ni tartare, ni turque, ni persane, ni indienne, ni chinoise, ni américaine, ou plutôt qui serait à la fois toutes ces sociétés ? Qu’en résulterait-il pour ses moeurs, ses arts ; sa poésie ? Comment s’exprimeraient des passions ressenties à la fois à la manière des différents peuples dans les différents climats ? Comment entrerait dans le langage cette confusion de besoins et d’images produits dans divers soleils qui auraient éclairé une jeunesse, une virilité et une vieillesse communes ? " in Mémoires d’outre-tombe, op. cit., p.924.
[36] Philippe Ariès, Le Temps de l’histoire, coll. " L’Univers historique ", Seuil, 1986, p.244.
[37] Sur l’idée de la nation comme articulation du particulier et de l’universel, voir le magnifique ouvrage de Daniel J. Mahoney, De Gaulle, Statesmanship, Grandeur, and Modern Democracy, Praeger, Westport, Connecticut, London, 1996. Voir en particulier le chapitre 7 : " The Unity of Europe and the greatness of France : de Gaulle’s vision of a Europe of nations ".
[38] François-René de Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, op. cit., p.917.
[39] Hannah Arendt, constatant le possible rejet des traditions nationales, observait : " Sa conséquence serait une superficialité qui transformerait l’homme que nous avons connu au cours de cinq mille ans d’histoire attestée au point de le rendre méconnaissable. Ce serait plus qu’une simple superficialité ; ce serait comme si la dimension de la profondeur tout entière […] disparaissait purement et simplement " (Arendt, Vies politiques, op. cit., p.101).
[40] Cf. Cornélius Castoriadis, Les Carrefours du labyrinthe. La montée de l’insignifiance, vol. IV, coll. " La Couleur des idées ", Seuil, 1996, p.75 : " Or, si la nation ne doit pas être définie par le " droit du sang " (ce qui nous conduit directement au racisme), il n’y a qu’une seule base sur laquelle elle peut être raisonnablement défendue : comme collectivité qui a créé des œuvres pouvant prétendre à une validité universelle ".
[41] Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, op. cit., p.924.
[42] Léo Strauss, Qu’est-ce que la philosophie politique ?, coll. " Léviathan ", PUF, 1992, p.231.
[43] C. Castoriadis, Les Carrefours du labyrinthe, op. cit.
[44] Carl L. Becker, The Declaration of Independence, Vintages Books, New York, 1970.
 Contrepoints
Contrepoints