Accueil > Argumentaires > Édito > L’américanisation de la gauche européenne
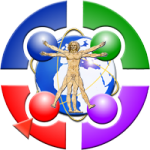 L’américanisation de la gauche européenne
L’américanisation de la gauche européenne
lundi 7 avril 2008
Dans un livre publié en 1998, un brillant sociologue affirmait : « il n’y a plus aucune alternative au capitalisme. Le débat ne porte plus que sur la question de savoir jusqu’où et par quels moyens on doit régir et réguler le capitalisme. » Ces paroles sont tout particulièrement remarquables parce que l’homme qui les a écrites, Anthony Giddens, était aussi célèbre pour être le gourou intellectuel du Premier Ministre britannique et chef du Parti travailliste, Tony Blair. En se convertissant à la troisième voie (The Third Way, titre du livre de Giddens), qu’il faut clairement comprendre comme la voie médiane évitant à la fois l’anticapitalisme de gauche et le conservatisme de droite, Blair a contribué à mettre fin à une période d’un siècle pendant laquelle la gauche européenne a été dominée par les socialistes. En agissant ainsi, lui et ses homologues du continent ont également facilité un processus qui a eu pour effet de rapprocher davantage les divisions entre les partis politiques européens de celles existant aux États-Unis où le socialisme n’a jamais vraiment pris pied.
Une Amérique sans socialisme
Les théoriciens socialistes de la fin du XIXe siècle ont été tourmentés par la question de savoir pourquoi, seuls parmi les sociétés industrielles, les États-Unis n’avaient pas de mouvement socialiste ou de parti travailliste important. Friedrich Engels essaya d’y répondre dans la dernière décennie de sa vie. En 1906, le sociologue allemand Werner Sombart publia un livre essentiel sur ce sujet, Pourquoi n’y a-t-il pas de socialisme aux États-Unis ? La même année, le fabien H.G. Wells posa lui aussi la question dans The Future in America. Lénine et Trotski étaient tous deux très préoccupés par ce phénomène car il remettait en question la logique interne du matérialisme historique marxiste, telle que Marx l’avait formulée lui-même dans Das Kapital, où il affirmait que « le pays le plus développé [économiquement] montre l’image de leur avenir aux moins développés (1) ». Les États-Unis sont ce pays depuis le dernier quart du XIXe siècle.
Compte tenu de l’affirmation de Marx, les dirigeants marxistes d’avant la Première Guerre mondiale croyaient que le pays capitaliste le plus industrialisé mènerait le monde vers le socialisme. Cela devint une position retranchée du marxisme. Un marxiste orthodoxe (avant qu’il ne devienne le révisionniste des idées marxistes qui eut le plus d’influence), Edouard Bernstein, remarquait encore : « Nous voyons le socialisme moderne entrer aux États-Unis et y prendre racine en relation directe avec l’extension du capitalisme et l’apparition d’un prolétariat moderne ». En 1902, Karl Kautsky, considéré comme le théoricien en chef du parti social-démocrate allemand, écrivait : « l’Amérique nous montre notre avenir, si tant est qu’un seul pays puisse le révéler à un autre ». Il élabora cette idée en 1910 parce qu’il s’attendait à ce que « l’aggravation prévisible du conflit de classes » se développe « plus fortement » en Amérique qu’ailleurs. August Bebel, chef politique des sociaux-démocrates allemands, déclara nettement en 1907 : « Les Américains seront les premiers à inaugurer une république socialiste (2) ». A une époque où ce parti allemand était déjà un mouvement de masse qui comptait de nombreux élus au Reichstag, alors que le parti socialiste américain obtenait moins de 2% des votes, cette conviction reposait sur le fait que le développement industriel des États-Unis était bien plus avancé que celui de l’Allemagne.
L’incapacité permanente des socialistes à créer un mouvement viable aux États-Unis était une source de grand embarras pour les théoriciens marxistes car ils supposaient que la « superstructure » d’une société qui détermine le comportement politique dépend des systèmes économique et technique sous-jacents. Max Beer, qui, en cinquante ans de carrière dans le socialisme international, a été membre des partis autrichien, allemand et britannique et qui a travaillé pour l’Internationale socialiste, a décrit l’anxiété que les chefs marxistes européens exprimaient dans leurs discussions privées à propos de la faiblesse du socialisme en Amérique. Ils savaient que c’était une « contradiction vivante de [...] la théorie marxiste » et que cela soulevait des questions sur la validité du marxisme lui-même (3) ».
En 1939, dans une publication destinée à un public américain populaire, Léon Trotski ne reprit la phrase du Capital citée ci-dessus que pour l’écarter avec ce commentaire : « en aucun cas, il ne faut [...] prendre ceci au pied de la lettre (4) ». Trotski connaissait bien sûr son marxisme et était parfaitement conscient que la théorie exigeait que les États-Unis soient les premiers sur la voie du socialisme. Son commentaire suggère que la contradiction le préoccupait beaucoup. Son effort pour la transformer en affirmation métaphorique montre qu’il n’avait pas de réponse à l’énigme qu’elle posait.
Cependant, malgré le piteux record du socialisme organisé en Amérique, on peut soutenir que, en un sens, Karl Marx avait raison de dire que le pays le plus développé « montre l’image de leur avenir aux moins développés ». Telle qu’elle s’est développée dans la réalité, et non comme l’espéraient les marxistes, la culture politique américaine reflète la logique d’une société avancée sur le plan économique et technique. Les États-Unis, qui n’ont jamais connu le régime féodal, ont été le prototype de la société bourgeoise. Comme Max Weber l’avait compris, les États-Unis pouvaient devenir l’économie la plus productive du monde précisément parce que leur culture renferme entièrement les valeurs capitalistes. L’homme capitaliste idéal pouvant servir de référence était un Américain : Benjamin Franklin. Pour Weber, c’est dans les écrits des Pennsylvaniens que « l’esprit du capitalisme » a été le mieux exprimé (5).
En 1940, l’idée que la politique non socialiste américaine s’avérerait un modèle pour la gauche européenne fut présentée dans tout son éclat par Lewis Corey (Louis Freina), ancien chef du parti communiste américain, dans une série d’articles parus dans l’organe des Lovestoneites, Workers Age. Harvey Klehr résume ainsi l’intuition de Corey :
« Loin d’être une exception, l’Amérique était en fait le modèle des pays capitalistes. On s’était contenté de changer les positions dans la course ; les socialistes européens pouvaient voir dans l’Amérique l’image de l’avenir infortuné qui les attendait. Loin d’être un cas unique ou même un cas vaguement différent, l’Amérique était le prototype du capitalisme. Dans un curieux renversement des rôles, c’étaient désormais les socialistes européens qui, en regardant par-delà l’océan, pouvaient voir l’avenir de leur propre mouvement. Le développement américain n’était pas différent de celui de l’Europe : il était seulement à un stade plus avancé (6) ».
Changements sociaux et changements politiques
Comme Corey l’avait prévu, dans les autres démocraties occidentales, la gauche s’est mise de plus en plus à ressembler à la gauche non socialiste américaine. A un degré plus ou moins élevé, tous les grands partis de gauche rejettent à présent l’économie étatiste et voient dans le concurrence du marché le moyen de parvenir à la croissance économique et d’augmenter le niveau de vie. Les partis sociaux-démocrates et travaillistes sont à présent socialement et idéologiquement pluralistes. L’Internationale socialiste a effectivement été refondue en un nouveau regroupement de partis progressistes, elle a adoubé la « troisième voie » au sein de laquelle le parti démocrate représente les États-Unis.
Ce changement de caractère des partis européens reflète une transformation des structures économiques et de classe qui les a rapprochées de celles des États-Unis. On met beaucoup moins l’accent sur la pétrification des classes sociales, clairement hiérarchisées et issues d’un passé féodal et monarchique. La croissance des économies européennes, de même que l’augmentation des biens de consommation qui en est résultée et la répartition plus équitable de l’éducation ont considérablement réduit les différences de mode de vie entre les classes sociales, y compris en ce qui concerne les accents et l’habillement. La distribution des revenus et des compétences professionnelles a perdu la forme pyramidale qui caractérisait la fin du XIXe siècle et le début du Xxe siècle, pour prendre celle d’un diamant bombé au milieu.
A présent, les partis politiques de gauche cherchent plus à séduire la classe moyenne en augmentation que les ouvriers de l’industrie et les indigents qui constituent une part décroissante de la population. Aux États-Unis, prototype des sociétés industrialisées, la proportion des gens employés à des activités non manuelles est passée de 43% en 1960 à 58% à la fin du siècle, alors que la proportion des ouvriers employés dans l’industrie tombait de 26 à 16%. Au Royaume-Uni, ce chiffre est tombé de 36% à 19% ; en Suède de 32% à 19% ; aux Pays-Bas de 30% à 19% ; et en Australie de 26 à 13,5%. Cette diminution a été moins marquante, quoique également marquée, en France (28 à 20%) et en Allemagne (34 à 29%).
L’Amérique a toujours accordé moins d’importance à la conscience de classe et à l’organisation en classes sociales que les sociétés européennes : en tout état de cause, toutes deux sont en déclin de chaque côté de l’Atlantique. L’adhésion à un syndicat, base principale des partis de gauche, est tombée dans les mêmes proportions dans quatre cinquièmes des quatre-vingt douze pays étudiés par l’Organisation internationale du Travail. Entre 1985 et 1995, le taux d’adhésion syndical a baissé de 21% aux États-Unis. En 2000, seuls 13,5% des ouvriers américains – et moins de 10% de ceux ayant un emploi privé – sont membres de syndicats. Ces réductions ont même été plus importantes en France et en Grande-Bretagne (respectivement 37 et 28%) alors qu’elles atteignaient près de 18% en Allemagne (7). Comme les Démocrates aux États-Unis, les partis sociaux-démocrates européens et d’Asie du Sud se sont diversifiés socialement en termes d’adhésion et de soutien. Les corrélations entre la classe et le vote, qui sont plus faibles aux États-Unis que partout ailleurs dans le monde industrialisé, ont chuté dans la plupart des nations développées au cours des dernières décennies, tandis que la distribution des classes économiques et les niveaux de consommation changeaient.
Certaines des forces sous-jacentes à l’origine de ces évolutions ont été identifiées par un certain nombre de chercheurs en sciences sociales néo-marxistes dans leurs débats sur l’émergence de la « société postindustrielle », du « postmatérialisme » et de la « révolution scientifique et technologique ». Daniel Bell, social-démocrate de toujours, a joué un rôle central dans la conceptualisation de ces changements en Occident. Radovon Richta et ses compagnons de l’Académie des sciences de Tchécoslovaquie ont extrapolé des évolutions similaires en Europe de l’Est et en Union soviétique. (8)
L’imitation du modèle américain
Les transformations qui en sont résultées dans les relations de classe et les relations politiques au sein des sociétés industrielles développées, comme celles intervenues dans la politique de gauche aux États-Unis et en Europe, peuvent être analysées dans le cadre d’un marxisme « apolitique », c’est-à-dire en acceptant la thèse que les avancées techniques et la répartition des classes économiques déterminent les « superstructures » politiques et culturelles, sans pour autant supposer que le socialisme succédera au capitalisme. Nombre des évolutions annoncées par Marx – croissance des usines, forte augmentation du prolétariat industriel, réduction du nombre des non-salariés – n’ont plus cours. Le nombre de gens employés dans des activités tertiaires, techniques et de services s’est plutôt accru rapidement. Le nombre de diplômés de l’université et d’étudiants dans l’enseignement supérieur a brusquement augmenté. Alain Touraine, important sociologue français et intellectuel de gauche, suggère que ces évolutions ont eu pour effet de changer la base du pouvoir : « Si la propriété était le critère d’appartenance à la précédente classe dominante, la nouvelle classe dominante se définit par le savoir et un certain niveau d’éducation (9) ».
Les néo-marxistes et les déterministes de la technique ont souligné combien le savoir théorique et scientifique est devenu la principale source du changement social et économique, modifiant les structures sociales, les valeurs et les mœurs, au point de donner un prestige et un pouvoir considérables aux élites scientifiques et technologiques. Les couches émergentes du postindustrialisme, qui ont leurs racines à l’université, dans les domaines scientifique et technique, les industries produites par l’informatique, le secteur public et les professions libérales, ont développé leurs propres valeurs.
Ronald Inglehart, le plus important analyste empirique du postindustrialisme, fait observer que les changements de valeurs « postmatérialistes » et la diminution des conflits de classe dépendent aussi du développement d’une atmosphère d’abondance à la fin de ce demi-siècle. Les générations qui ont atteint leur majorité au cours de la seconde moitié du Xxe siècle ont des valeurs différentes de celles de leurs prédécesseurs qui ont été élevés dans un climat de pénurie économique et ont connu de graves dépressions économiques. Les données d’étude rassemblées par Inglehart sur le dernier quart de siècle font apparaître une nette action générationnelle et l’existence de liens avec l’augmentation des réalisations en matière d’enseignement qui ont rendu possible l’expansion de la recherche scientifique et de haute technologie (10).
Ces évolutions ont profondément affecté le monde politique des sociétés industrielles avancées. La croissance du pouvoir du marché dans l’arène économique a entraîné un déclin du conflit idéologique sur le rôle de l’État dans la politique postindustrielle. Mieux éduqués, les citoyens se sont de plus en plus intéressés à des sujets non économiques ou sociaux : l’environnement, la santé, la qualité de l’éducation, la culture, une plus grande égalité pour les femmes et les minorités, l’extension de la démocratisation et de la liberté chez eux et à l’étranger, et (enfin et plus encore) les questions de morale personnelle, notamment lorsqu’elles concernent les problèmes familiaux et le comportement sexuel. Dans certains régimes, y compris en France et en Allemagne, les réformateurs écologistes ont pris les devants en créant de nouveaux partis verts, généralement alliés aux nouveaux sociaux-démocrates au sein d’une coalition.
De même que les États-Unis ont servi de modèle à des régimes moins étatistes et plus axés sur le marché, ils se sont trouvés tout récemment en première ligne de la « nouvelle politique » postmatérialiste qui a, pour ainsi dire, fait le trajet de Berkeley et Madison à Paris et Berlin. Au début des années 70, l’analyste politique français Jean-François Revel notait que les formes les plus récentes du mouvement de contestation, que ce soit en Europe ou ailleurs, étaient « des imitations du prototype américain » (11).
Si beaucoup d’analystes politiques admettent les importantes reformulations opérées par la gauche dans leurs propres pays, ils ne se rendent pas compte combien ces changements reflètent des évolutions communes à l’ensemble des démocraties économiquement avancées. Pour faire ressortir l’ampleur et la coïncidence de ces événements, je résumerai les moyens par lesquels, pays après pays, la politique de gauche a pris un tour « américain ». Cela ne veut évidemment pas dire que les partis et les idéologies soient les mêmes à travers les nations. Il y a d’importantes variations qui reflètent les divers contextes historiques, la nature variée des clivages politiques et les modèles structurels et démographiques sous-jacents. Cependant, il existe d’importantes similitudes entre ces politiques. Comme Tony Blair l’a souligné, « il est parfaitement sain de se rendre compte qu’il y a des évolutions communes au monde entier (12) ».
Les nouveaux sociaux-démocrates
A la suite d’une réunion des responsables des sociaux-démocrates européens avec Bill Clinton le 24 septembre 1998, Tony Blair proclama leur nouvelle doctrine de la « troisième voie » :
« Dans l’économie, notre approche n’est ni le laissez-faire ni l’ingérence de l’Etat. Le rôle du gouvernement consiste à promouvoir la stabilité macroéconomique ; à mettre en place des politiques fiscales et sociales qui encouragent l’indépendance et non la dépendance ; à préparer les gens au travail en améliorant le système éducatif et les infrastructures ; et à promouvoir l’entreprise. Nous sommes fiers d’être soutenus par les dirigeants du monde des affaires comme par les syndicats [...] En matière de politique sociale et de l’emploi, la troisième voie implique une réforme du système social afin qu’il débouche sur le travail là où c’est possible. Elle encourage l’introduction de normes équitables au travail tout en rendant celui-ci rentable par la réduction des taxes et des sanctions qui découragent le travail et la création d’emplois (13) ».
Les élections britanniques de 1997, gagnées par le parti travailliste à une écrasante majorité une fois qu’il eut cessé de mettre l’accent sur la propriété publique comme il le faisait depuis le début de son histoire, mirent fin à un siècle d’efforts socialistes pour réduire la place de la propriété privée ou l’éliminer complètement. Tony Blair prit soin de souligner qu’il était d’accord avec la politique de liberté du marché et de réduction de la taille du gouvernement menée par Bill Clinton. Avant Clinton, Blair avait déclaré que l’ère des gouvernements massifs était terminée et avait promis de gouverner au centre. Blair recomposa l’image de son parti en en faisant le New Labour, un parti non socialiste qui n’est pas tenu de travailler avec les syndicats. Il souligna qu’il voulait que les syndicats coopèrent « avec les directeurs d’entreprise britannique ». Peter Mendelson, qui était alors l’idéologue des blairistes, affirma fièrement que les travaillistes étaient à présent « un parti du marché capitaliste (14) ».
Plus remarquable encore était le conseil donné par Blair aux organisations travaillistes dans un article paru en 1994 dans le New Statesman ; il y disait qu’ « il est tout à fait dans l’intérêt des syndicats de ne pas être associés à un seul parti politique ». Blair soutenait que les syndicats « devaient être capables de réussir, qu’il y ait ou non un changement de gouvernement ». Cette réflexion émanait du chef d’un parti fondé dans une large mesure par les syndicats et subventionné par eux pendant toute son histoire. Pendant la campagne de 1997, le parti travailliste rendit public un manifeste spécial, destiné aux milieux d’affaires ; il promettait que le gouvernement de Blair conserverait les « principaux éléments » des limitations apportées par Margaret Thatcher aux syndicats et résisterait aux revendications économiquement injustifiées. Dans une interview, Blair indiqua que son administration « ne modifierait pas la loi britannique [sur le travail] qui est la plus restrictive du monde occidental à l’égard du syndicalisme (15) ».
Le manifeste du parti proclamait : « on remplacera les impôts et les dépenses par des économies et des investissements ». Sa plate-forme électorale ne se contentait pas d’affirmer que « des profits sains sont un moteur essentiel d’une économie de marché dynamique », mais soulignait aussi que l’objectif d’une inflation faible impliquait qu’on maintienne le niveau des gains salariaux. Il n’est pas surprenant qu’au début de la campagne de 1997, Thatcher ait dit : « la Grande-Bretagne sera en sécurité entre les mains de M. Blair ». Au cours d’une réunion de l’Internationale socialiste, Blair lui retourna le compliment en disant : « sur certaines choses, les années 80 étaient dans le vrai – un accent mis sur l’entreprise, des marchés du travail plus flexibles ». L’un de ses premiers gestes après avoir pris ses fonctions fut de transférer le pouvoir de contrôler la politique monétaire et les taux d’intérêt du ministère des Finances à la Banque d’Angleterre. Un autre geste pris après sa première rencontre avec Bill Clinton le 31 mai 1997, fut de lancer une réforme du système social destinée à réduire le nombre de personnes à la charge de l’assistance publique en poussant les mères célibataires à prendre des emplois rémunérés. Au cours de cette réunion, Clinton et Blair avaient affirmé que « les partis progressistes d’aujourd’hui sont les partis de la responsabilité fiscale et de la prudence ». (16)
Le même modèle se retrouve dans le monde entier. Dans les années 80, les gouvernements travaillistes d’Australie et de Nouvelle-Zélande réduisirent les impôts sur le revenu, poursuivirent la dérégulation économique et privatisèrent diverses industries. Le parti travailliste australien parvint à un « accord » avec les syndicats qui aboutissait à réduire les salaires réels d’au moins 1% chacune des huit années où le premier mininstre Robert Hawke dirigea le gouvernement. Même histoire en Nouvelle-Zélande où, durant les années 1984-1990, le parti travailliste mit fin à « la tradition d’imposer en fonction des capacités de paiement », démantela le système social et privatisa de nombreuses entreprises étatiques. D’après un compte rendu paru dans un magazine social-démocrate, le Premier ministre David Langue soutenait que « les sociaux-démocrates doivent accepter l’existence de l’inégalité économique parce qu’elle est le moteur de l’économie (17) ».
Le même modèle s’applique aussi aux partis de gauche du monde non anglophone. Les sociaux-démocrates suédois modifièrent complètement leurs précédentes orientations en matière de croissance des salaires, d’impôt sur les hauts revenus et de maintien d’un état social solide pour s’engager eux aussi dans plusieurs mesures de privatisation. Le dernier dirigeant socialiste américain, Michael Harrington, déclara de manière critique que le gouvernement du Premier ministre Olof Palme augmentait le chômage en réduisant le revenu réel de ceux qui avaient un emploi (18).
En Espagne, le Premier ministre socialiste Felipe Gonzalez, qui gouverna trois mandats, transforma son parti, marxiste dans sa phase initiale postfranquiste, en défenseur de la privatisation, de la liberté du marché et de l’OTAN. Il remarqua un jour, en employant une formule presque à la Churchill, qu’une économie de marché concurrentielle est marquée par la cupidité, la corruption et l’exploitation du faible par le fort, mais que « le capitalisme est le système économique le moins mauvais qui soit ». The Economist estima que sa politique économique faisait paraître son gouvernement « un peu à la droite de celui de Mrs Thatcher (19) ».
Le plus ancien des grands partis marxistes, celui des sociaux-démocrates allemands (SPD), rejeta le marxisme à leur congrès de Bad-Godesberg en 1959. Russel Dalton, spécialiste américain de sciences poltiques, commenta par la suite leur programme : « Karl Marx aurait été surpris [...] d’apprendre que la libre concurrence économique était l’une des conditions essentielles d’une politique économique social-démocrate ». En 1976, le Chancelier social-démocrate Helmut Schmidt soutint que les intérêts des travailleurs exigeaient que les profits augmentent, notant que « les profits que font les entreprises aujourd’hui sont les investissements de demain, et les investissements de demain sont les emplois d’après-demain ». En 1990, le programme du SPD remarquait, à la mode libérale classique, qu’à l’intérieur d’un « système établi démocratiquement, le marché et la concurrence sont indispensables ». En 1995, Rudolf Scharping, qui était alors le candidat SPD à la Chancellerie et qui est aujourd’hui ministre de la Défense, souligna que les hypothèses soutenues jadis par son parti s’étaient révélées fausses et affirma : « Nous, sociaux-démocrates, avons créé un Etat social trop réglementé, trop bureaucratique et trop professionnalisé (20) ».
Le Chancelier élu en 1998, Gerhard Schröder, poursuit cette tradition. In ne voit pas le SPD comme une partie de la gauche, mais comme occupant un « nouveau centre », lieu où, comme l’écrit John Vinocur, « des mots tels que « risque », « esprit d’entreprise » et « marchés du travail flexibles » coexistent avec des expressions d’allégeance à la justice sociale et à une juste distribution des revenus ». Schröder a promis d’améliorer l’économie allemande et de réduire son taux élevé de chômage en baissant ses « coûts prohibitifs du travail » et « en mettant en place des incitations à de nouveaux investissements en capital ». Il remarque que le SPD est en train de « rompre avec [...] les attitudes étatiques de la démocratie sociale [... Nous] avons compris que l’Etat tout-puissant et interventionniste n’a pas sa place dans les circonstances actuelles (21) ».
Dans son discours inaugural après son installation comme Chancelier, le 10 novembre 1998, Schröder souligna la continuité avec le gouvernement sortant, celui du chrétien-démocrate Helmut Kohl, en disant : « Nous ne voulons pas faire quelque chose de différent, mais faire mieux beaucoup de choses. » Pour contribuer à la réduction du chômage, il a fait passer à 35% les charges sociales qui avaient atteint le taux minimum de 47% sous Kohl et a appelé les milieux d’affaires et les syndicats à coopérer dans une solennelle « alliance pour l’emploi ». Il a aussi proposé de développer les systèmes privés de retraite, d’encourager la responsabilité personnelle et de concentrer les subventions et les dépenses de l’Etat sur ce qui est « vraiment nécessaire », tout en liant « la politique fiscale à des mesures complémentaires incluant la dérégulation et l’ouverture des marchés », selon la formule du Financial Times (22).
Par le passé, les partis socialistes créaient de vastes Etats sociaux qui nécessitaient qu’une part toujours croissante du PNB (parfois plus de la moitié) aille au gouvernement. Aujourd’hui, cependant, ces mêmes partis admettent qu’ils ne peuvent pas soutenir la concurrence sur le marché mondial sans réduire les dépenses du gouvernement. Leur situation électorale les oblige à essayer de séduire la classe moyenne et les riches ouvriers spécialisés et employés travaillant dans la haute technologie. C’est pourquoi, comme Blair, Clinton et Schröder, ils cherchent à baisser les impôts, à réduire les droits sociaux et à équilibrer leurs budgets, mais ils insistent aussi sur la nécessité de réformes postmatérialistes destinées à nettoyer l’environnement naturel, social et économique. Même la Suède, qui est le prototype du régime social-démocrate, a accru ses efforts pour renforcer son économie en privatisant vingt-cinq nouvelles entreprises en 1999. La Finlande et le Danemark ont mené des politiques identiques sous une direction social-démocrate.
Les exceptions
Seuls les partis socialistes de Norvège et, dans une certaine mesure, de France, n’ont pas pris leurs distances à l’égard de l’intervention de l’Etat ; tous deux continuent à préférer de vastes politiques sociales (mais non, il faut le noter, la nationalisation de l’industrie). La Norvège peut encore croire au « socialisme à l’ancienne mode » à cause de ses importantes ressources en pétrole qui financent son Etat social. La gauche française opère au sein d’une société où le dirigisme faisait autant partie de la culture nationale que l’antiétatisme en Amérique. En France, la droite comme la gauche ont approuvé l’existence d’un Etat puissant, situation qui remonte à l’Empire, à la Révolution et à la monarchie. Le journaliste Roger Cohen a remarqué que « l’attachement gaulliste à l’Etat et le rejet d’une réforme du marché ont encouragé les socialistes à rester à gauche pour se distinguer ». Comme le souligne Ezra Suleiman, qui fait autorité parmi les universitaires sur la politique française : « la droite ne peut pas lâcher l’Etat, la gauche reste donc à gauche (23) ». Il n’est donc pas surprenant que les socialistes aient fait campagne et gagné les élections en 1997 en promettant de mettre en place un vaste programme de création d’emplois parrainé par le gouvernement et de protéger l’Etat social contre les restrictions budgétaires.
Cependant, dans une interview au Nouvel Observateur, le Premier ministre socialiste Lionel Jospin ressemble aux autres socialistes européens en se disant favorable à une prise de distance avec « l’étatisme », à une augmentation de la décentralisation et à l’accroissement de l’initiative individuelle (24). Il a fait l’éloge des importantes mesures de privatisation menées à bien par François Mitterrand durant sa deuxième présidence. Jospin a aussi parlé de la nécessité pour la France d’imiter l’économie américaine. En 1998, il critiqua le mépris de la gauche à l’égard du niveau de croissance de l’emploi américain en disant : « Contrairement à ce que nous avons prétendu et même cru, les emplois en cours de création aux Etats-Unis ne sont pas seulement, ni même surtout, mal payés et sans avenir, mais ce sont des emplois qualifiés dans les industries de service et de haute technologie. » D’après The Economist, Jospin a souligné que la France « pouvait apprendre beaucoup du dynamisme économique de l’Amérique, de la vitalité de sa recherche et de son innovation, de son esprit de concurrence et de sa capacité à se renouveler (25) ».
Le modèle néerlandais
Curieusement, le pays modèle de la fin des années 90 que les sociaux-démocrates européens et les autres citent fréquemment en tant que tel est les Pays-Bas avec un taux de chômage de 6,5% en 1997 (très en-dessous de celui des grandes économies du continent) et un taux de croissance supérieur à ceux de la Grande-Bretagne, de la France ou de l’Allemagne. Sous un gouvernement dirigé par l’ancien chef syndical Win Kok du parti travailliste, les Néerlandais ont maintenu le niveau « des salaires, de l’inflation et des taux d’intérêt, et [... simplifié] les règles d’embauche, de licenciement et d’ouverture des entreprises nouvelles ». Les allocations chômage ont été réduites tandis que les règles relatives aux indemnités pour maladie et incapacité étaient renforcées. Thomas Friedman du New York Times décrit cette politique comme « la méthode américaine de réduction, de privatisation et de relâchement de la réglementation du travail (26) ».
Dans un « pacte social » négocié entre les syndicats, alors dirigés par Kok, et les employeurs, les travaillistes ont accepté de limiter les augmentations de salaires à 2% par an. Que ce soit dû ou non à ces politiques, l’économie du quasi plein emploi qui en est résulté a conduit à une augmentation de l’inégalité des revenus, très comparable à celle des Etats-Unis et des autres pays industrialisés. Dans les économies de haute technologie, les personnes les mieux formées et très spécialisées sont beaucoup plus recherchées que les ouvriers de l’industrie et les personnes ayant une faible formation et sont donc relativement mieux payés.
Ce ne sont pas les Etats-Unis qui sont politiquement « à contre-courant » dans le sillage d’une Europe plus « progressiste », c’est la gauche du Vieux Monde qui ressemble de plus en plus à la gauche américaine, comme l’avait prévu Lewis Corey. On peut donc même dire qu’en termes politiques ce sont les Etats-Unis qui ont montré à l’Europe l’image de son avenir. Au fur et à mesure que les pays européens atteignaient de nouveaux sommets d’abondance et de consommation de masse, ils se sont mis, comme l’avait prévu Antonio Gramsci, à ressembler aux Etats-Unis en ayant des sociétés moins stratifiées, moins limitées par des statuts et bien mieux éduquées. En conséquence, leurs couches les moins privilégiées ont une bien moins grande conscience de classe qu’autrefois. Aujourd’hui, les partis « progressistes » européens, désormais non socialistes, cherchent, comme le remarque Adam Przeworski, à rendre le capitalisme plus humain et plus efficace. Selon la formule de Régis Debray, l’ancien conseiller de François Mitterrand, l’objectif des dirigeants socialistes européens est « de mettre en oeuvre la politique de la droite, mais plus intelligemment et d’une manière plus rationnelle (27) ».
Termes anciens, définitions nouvelles
Rien de ceci ne vise à suggérer que les divisions politiques de la démocratie moderne, conceptualisées depuis la Révolution française dans un spectre allant de la gauche à la droite, ont disparu. Les Démocrates et les Républicains ou les sociaux-démocrates et les conservateurs contribuent encore aux choix électoraux bien que leurs positions idéologiques et leurs dissensions internes soient en train de changer (28).
Les clivages liés à la stratification sociale ne sont plus les principaux facteurs de détermination de la position d’un parti, qu’il soit à la gauche ou à la droite du spectre politique. Les sujets tournant autour de questions morales, de l’avortement, des « valeurs familiales », des droits civils, de l’égalité des sexes, du multiculturalisme, de l’immigration, du crime et de la sanction, de la politique étrangère et des communautés supranationales orientent les individus et les groupes vers des directions indépendantes de leur situation socio-économique. Cependant, la plupart de ces questions peuvent être rattachées à l’idéologie sociale qui, à son tour, est liée à la religion et à l’éducation.
La signification des termes « gauche » et « droite » est en train de changer. Comme nous l’avons vu, bien qu’il se pensent toujours comme sociaux-démocrates ou socialistes, les partis de gauche se sont largement reconstitués en prenant la forme de libéraux, au sens américain du mot, et mettent l’accent sur des questions postmatérialistes, telles que l’écologie, l’égalité des femmes et des homosexuels, les droits des minorités et les libertés culturelles. A des degrés variés, la droite a évolué vers le libéralisme classique ou des positions libertaires. La gauche insiste sur l’égalité du groupe et la sécurité économique ; la droite sur l’égalité des chances et l’affaiblissement du pouvoir de l’Etat. Logiquement, la droite devrait aussi défendre la liberté personnelle en suivant la ligne soutenue par les libéraux du XIXe siècle, mais les alliances politiques entre les conservateurs en matière économique et les traditionnalistes religieux ont encouragé le conservatisme culturel sur les questions liées au sexe, à la famille et au mode de vie. Compte tenu des variations complexes de la structure des clivages politiques, il est difficile aujourd’hui d’élaborer un modèle cohérent qui différencie la gauche de la droite. Par exemple, certains conseillers du nouveau président des Etats-Unis, George Bush, ont laissé entendre qu’il a une conception « communautariste », étiquette précédemment associée à certains conseillers de Bill Clinton.
Aucune grande tendance, qu’elle soit de gauche ou de droite, ne continue à croire en une utopie, solution à tous les grands problèmes qui passe par la reconstruction fondamentale de la société et du régime politique. Ces conditions de l’après-guerre froide sont de bon augure pour la stabilité démocratique et la paix internationale. C’est désormais un truisme que de dire que les démocraties ne se font pas la guerre ; or, pour l’essentiel, le monde est à présent démocratique. Bien qu’il existe des mouvements et des partis extrémistes, tous sont relativement faibles, en Occident du moins. Les plus puissants sont le Parti de la liberté de Jörg Haider en Autriche avec 27% des voix et le Front national de Jean-Marie le Pen en France qui est soutenu par 15% de l’électorat. Aucun autre n’approche ces niveaux. Il n’y a pas de dirigeant charismatique et peu d’enthousiasme politique. La jeunesse, dont Aristote remarquait qu’elle « a des idées exaltées [... et qui] préférerait faire des choses nobles plutôt que des choses utiles », est nécessairement frustrée (29).
Cette situation changera-t-elle ? Bien sûr : les économies et les sociétés qui en découlent ne restent jamais à l’état fixe. La dynamique intérieure des systèmes de marché amènent des renversements dans les cycles économiques qui peuvent menacer la stabilité démocratique. L’effondrement du Japon a remplacé le miracle japonais. Le passage de la France à gauche en 1997 et l’appui de Le Pen à la droite ne furent pas seulement facilités par les valeurs étatiques du pays, mais aussi par un taux de chômage de 12%. Les facteurs démographiques menacent de saper les fondations des systèmes de sécurité sociale et de santé. L’irruption de nouveaux acteurs importants sur la scène internationale, tels que la Chine, peut et va provoquer de nouveaux déséquilibres commerciaux. Mais toutes ces perspectives et d’autres encore sont pour plus tard.
Pour le moment, la fin de la guerre froide a apparemment marqué la victoire presque complète de l’Amérique et de son idéologie. Les Etats-Unis sont à présent la seule superpuissance. Leur économie est la plus productive. Les grands mouvements récents en faveur d’un changement social égalitaire et de l’amélioration de la qualité de la vie – le féminisme, l’écologie, les droits civils des minorités, les droits des homosexuels – sont tous partis de l’Amérique, comme cela a été le cas des révolutions démocratiques du XIXe siècle. Le monde développé a mieux réussi que jamais en satisfaisant les désirs de consommation de son peuple, ceux des travailleurs manuels comme ceux des classes intellectuelles.
Tout cela devrait rendre les sociétés plus conservatrices et satisfaites d’elles-mêmes. Cependant, les critères sur lesquels les pays occidentaux se jugent à présent eux-mêmes proviennent des credo révolutionnaires français, américain et marxiste. Ils proclament que « tous les hommes naissent égaux » et partagent l’objectif de « la vie, la liberté et la recherche du bonheur ». Cependant, tous les régimes politiques, même les libéraux classiques, doivent échouer pour se conformer pleinement aux objectifs utopiques inhérents aux positions libertaires et à l’égalitarisme. Les Américains inclinent encore plutôt du côté libertaire. Les Européens du côté égalitariste. Les deux tendances préfèrent la liberté à tout et veulent poser de fortes restrictions juridiques au pouvoir étatique. Les Américains préfèrent une société méritocratique, libertaire, au gouvernement efficace, mais faible. Ils n’atteindront pas ces objectifs dans l’absolu, mais ils continueront à les poursuivre. Il faut remarquer que les socialistes, de Marx et Engels à Antonio Gramsci, Anthony Crosland et Michael Harrington, ont tous reconnu que les Etats-Unis s’approchaient davantage socialement (mais évidemment pas économiquement) de leur objectif idéologique d’une société sans classe avec un Etat faible qu’aucun autre système qu’ils aient connu au cours de leur vie. Leon Samson, marxiste américain, concluait au début des années 30 que les radicaux américains ne pouvaient pas vendre le socialisme à un peuple qui croyait vivre déjà dans une société qui, sur le plan opérationnel, mais évidemment pas sur le plan terminologique, se soumettait aux objectifs socialistes.
L’Amérique a toujours une vision idéologique qui lui permet de motiver sa jeunesse. Les Européens s’abandonnent de plus en plus à une vision sociale identique, issue dans une large mesure de la Révolution française et de la démocratie sociale. Tous deux acceptent la concurrence du marché comme le moyen d’augmenter la productivité et, ce faisant, de diminuer les différences de modes de consommation liées à l’appartenance à une classe. Tous deux étendent la portée de l’enseignement supérieur, ce qui a pour conséquence d’accroître la possibilité d’accéder aux rangs de l’élite. On met moins l’accent en Europe sur les différences de statut. L’inégalité économique est naturellement toujours importante et même en augmentation durant les périodes d’innovation technique, comme c’est le cas à présent, parce que les nouvelles compétences sont bien plus demandées que les anciennes. Mais avec le déclin des modèles de respect et d’infériorité sociale et l’accroissement de l’accès à l’information dû au développement de l’Internet, le pouvoir est plus éparpillé.
Ces profonds changements sociaux et économiques continueront à refaçonner la nature des clivages entre les partis dans les prochaines décennies, d’une manière qu’on ne peut sans doute pas totalement prévoir aujourd’hui. Mais, de même que, selon Tony Blair et Bill Clinton, l’ère des gouvernements importants est maintenant révolue, la récente évolution des partis de gauche annonce la fin de la classe comme clivage majeur structurant la politique des partis. Dans les démocraties industrielles avancées, les partis continueront à se répartir sur un spectre gauche-droite mais la « gauche » et la « droite » ne seront plus jamais définies par la lutte entre le socialisme et le capitalisme. Avec la fin de cette grande compétition idéologique, les différences entre les partis se sont amenuisées et sont devenues plus changeantes. Aujourd’hui, la plupart des partis inclinent vers le centre sur les questions économiques, tandis que les systèmes de partis hésitent dans la recherche d’une nouvelle grande ligne de clivage. Il se peut que les bases sociales de ce nouveau clivage, qui aura valeur de définition, n’apparaissent pas de si tôt.
Traduction par Isabelle Hausser
Notes
1 : Karl Marx et Friedrich Engels, « Unpublished letters of Karl Marx and Friedrich Engels to Americans », in Science and Society, n°2, 1938, p.368 ; H.G. Wells, The Future in America, New York, Harper and Brothers, 1906 ; Karl Marx, Capital, vol. 1, Moscou, Foreign languages Publishing House, 1958, p. 8-9. Pour les écrits de Lénine, voir Harvey Klehr, « Leninist theory in search of America », Polity, n°9, 1976, p. 81-96.
2 : Cité par R. Laurence Moore, Europeans Socialists and the American Promised Land, New York, Oxford University Press, 1970, respectivement p.70, 58, 102 et 77.
3 : Max Beer, Fifty Years of International Socialism, Londres, George Allen and Unwin, 1935, p. 109-110.
4 : Léon Trotski, The Living Thoughts of Karl Marx, New York, Longmans, Green, 1939, p. 38-9.
5 : Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, New York, Scribners and Sons, 1958, p. 64-5.
6 : Harvey Klehr, The Theory of American Exceptionalism, thèse de Ph. D., Département d’Histoire de l’Université de Caroline du Nord, Charpel Hill, p. 130. L’étude complète de Fraina-Corey se trouve aux p. 126-130.
7 : « ILO highlights global challenges to trade unions », ILO News, 4 novembre 1997.
8 : Daniel Bell, The Coming of Post-Industrial Society, New York, Basic Books, 1978 ; Radovon Richta et al., Civilizations at the Crossroads, White Plains, New York, International Arts and Sciences Press, 1969.
9 : Alain Touraine, The Post-Industrial Society : Tomorrow’s Social History, New York, Random House, 1971.
10 : Ronald Inglehart, « The Silent revolution in Europe : intergenerational change in post-industrial societies », American Political Science Review, n°65, décembre 1971, p. 991-1017. Cf. aussi Ronald Inglehart, Modernization and Postmodernization, Princeton, Princeton University Press, 1997.
11 : Jean-François Revel, Without Marx or Jesus, Garden City, New York, Doubleday, 1971, p 6-7.
12 : John F. Harris et Fred Barbash, « Blair savors colleague Clinton’s arm on his shoulder », Washington Post, 30 mai 1997.
13 : Tony Blair, « Third Way, better way », Washington Post, 27 septembre 1998.
14 : George Will, « Last rite for socialism », Washington Post, 21 décembre 1997.
15 : Tony Blair, « No favours », New Statesman and Society, n°28, novembre 1994, p.33 ; Madaline Druhan, « Union reforms Stay, Labour leader says », Globe and Mail, Toronto, 1er avril 1997.
16 : Tom Baldwin, « New Labour manifesto steals old tory slogans », Sunday Telegraph, 30 mars 1997 ; John F. Harris et Fred Barbash, « Blair savors colleague Clinton’s arm on his shoulder » ; Alison Mitchell, « In London, 2 young guys sit talking about democracy », New York Times, 30 mai 1997.
17 : Seymour Martin Lipset, « No Third Way : a comparative perspective on the left », in Daniel Chirot ed., The Crisis in Leninism and the Decline of the Left, Seattle, University of Washington Press, 1991, p. 184-185.
18 : Michael Harrington, The Next Left : The History of a Future, New York, Holt, 1987, p. 130-131.
19 : Tom Gallagher and Allan M. Williams, « Introduction », in Tom Gallagher and Allan M. Williams, Southern European Socialism, Manchester University Press, 1989, p.3 ; « As Gonzalez glides rightward », The Economist, 11 mars 1989, dossier Espagne.
20 : Cité dans Seymour Martin Lipset, « No Third Way », op. Cit., p. 188-90 ; Rudolf Scharping, « Freedom, solidarity, individual responsability : reflections on the relationship between politics, money and morality », The Responsive Community, n° 6, automne 1996, p. 53.
21 : John Vinocur, « Downsizing german politics », Foreign Affairs, n°77, septembre-octobre 1998, p 11-12.
22 : Edmund L. Andrews, « Rivals have found little to fight over in german elections », New York Times, 26 septembre 1998 ; Ralph Atkins, « Schröder pledges strict financial control », Financial Times, 11 novembre 1998, p.2.
23 : Roger Cohen, « France’s old soldier fades away », New York Times, 8 juin 1997.
24 : Anne Swardson, « Jospin takes a new stand on austerity », Washington Post, 22 janvier 1998.
25 : « Jospin discovers America », The Economist, 27 juin 1998, p. 50.
26 : Thomas L. Friedman, « The Real G-7’s », New York Times, 19 juin 1997.
27 : Adam Przeworski, Capitalism and Social Democracy, Cambridge University Press, 1985, p. 206 ; Régis Debray, « What left of the left ? », New Perspectives Quarterly, n°7, printemps 1990, p.27.
28 : François Furet, « Democracy and Utopia », Journal of Democracy, n°9, janvier 1998, p. 79.
29 : Aristote, Rhetoric in Richard McKeon ed., The Basic Works of Aristote, New York, Random House, 1941.
 Contrepoints
Contrepoints