Accueil > Société > Justice & police > L’évolution du droit administratif contemporain
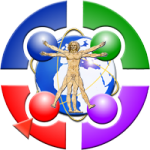 L’évolution du droit administratif contemporain
L’évolution du droit administratif contemporain
mercredi 14 avril 1999
Dorénavant, les choses ont bien changé : de multiples formes, de multiples régimes juridiques s’appliquent à l’action administrative. Aux deux formes classiques de l’action administrative, la police administrative (PA) qui réglemente l’activité des particuliers en vue d’assurer l’ordre public, et le service public (SP) qui lui permet de satisfaire directement un besoin d’intérêt général, se sont ajoutées l’autorisation, l’aide aux entreprises privées, l’octroi d’avantages financiers (subventions, détaxations, etc.) ou juridiques, avec en contrepartie l’agrément ou le contrôle.
Dispersion des organes
Sans doute avant 1914 le droit administratif connaissait-il déjà l’établissement public (EP), forme de décentralisation fonctionnelle de l’activité administrative, et la concession de service public (CSP, dans laquelle l’action administrative était confiée à une personne morale distincte ou même à un particulier). Mais l’EP était étroitement attaché à l’administration, et la CSP créait des liens tels que ce mode de gestion n’était guère que l’exception.
Un établissement public, c’est un SP doté de la personnalité morale. Mais l’EP a connu une profonde évolution : conçu à l’origine comme une simple entité juridique au sein même de l’administration, il s’est progressivement détaché d’elle au point de n’être souvent plus qu’un organisme en marge de l’administration.
Au départ l’EP répond à une décentralisation par service ou fonctionnelle, nous l’avons dit. Et ce pour des motivations très diverses : permettre des libéralités au profit de services d’assistance (hôpitaux, hospices, bureaux d’aide sociale), ou d’organismes culturels (caisse des musées nationaux) ; assurer au service une certaine indépendance face au pouvoir (universités, lycées) ; faciliter la participation des intéressés à la gestion (organismes professionnels tels que les chambres de commerce et d’industrie, CCI). L’EP était alors intégré à l’administration. S’il était doté de la personnalité morale, qui lui assurait l’autonomie financière et permettait la désignation de ses dirigeants par l’élection, il n’en restait pas moins une personne morale de droit public (ses agents étaient des agents publics, sa comptabilité une comptabilité publique). L’EP était soumis à une tutelle étroite de l’autorité centrale. Alors bien souvent il fallait se poser l’importante question de savoir si un organisme donné était un EP ou un organisme privé chargé d’une mission d’intérêt général : dans le premier cas il était dans l’administration ; dans le second cas on était au dehors. Aussi a-t-on longtemps cherché le critère de distinction du côté de l’origine de l’établissement, de sa détention ou non de prérogatives de puissance publique, ou du degré de subordination de l’organisme à l’autorité publique, selon les classifications traditionnelles.
Mais petit à petit l’EP a glissé du dedans vers le dehors. Il fallait donner à la société civile l’impression que ce n’est pas l’administration qui agit, mais un organisme autonome, pour obtenir plus facilement la coopération des administrés. Il fallait aussi échapper à la lourdeur souvent paralysante des règles de la comptabilité publique, ou bien encore éluder le contrôle budgétaire, ou donner aux fonctionnaires une liberté d’action plus grande.
A la simple décentralisation par service succède un éclatement de l’autorité centrale, et un véritable morcellement de l’action administrative. Tout en demeurant une personne publique, l’EP se trouve alors fréquemment à l’extrême limite de l’administration proprement dite : il ne présente plus de différence substantielle avec l’organisme privé situé de l’autre côté de la frontière. D’autant plus que de nombreux EP sont à présent soumis à un régime juridique de droit privé (les établissements publics à caractère industriel et commercial, les EPIC, ont proliféré pour échapper à la lourdeur de la gestion publique, tantôt créés en tant que tels, tantôt résultant de la transformation d’établissements publics à caractère administratif, EPA), et que sont aujourd’hui baptisés "EP" les organismes les plus divers, dont les liens avec l’administration sont souvent plus distendus que ceux qu’entretiennent avec cette dernière des organismes privés similaires. Le problème de la distinction entre EP et établissement privé d’utilité publique change alors de sens : il ne s’agit plus que d’une question de régime juridique, sur des points souvent mineurs, mais non plus d’une question fondamentale. Alors la jurisprudence a abandonné tout critère précis pour s’en tenir à un faisceau d’indices par lequel on déterminera si le législateur a entendu faire vivre un organisme donné sous le régime du droit public ou du droit privé.
Parallèlement, les EP se sont diversifiés et ont reçu des qualifications variées : EP territoriaux, établissements "à caractère culturel", à caractère sanitaire et social. Mais ils ne remettent pas en cause la summa divisio EPA/EPIC. Citons enfin le cas des EP "à double visage", qui reçoivent une qualification donnée mais exercent une double activité : au titre de leur mission administrative ils relèvent du juge administratif (JA) et du droit administratif (DA), tandis que leur activité industrielle et commerciale les soumet au juge judiciaire (JJ) et au droit privé (DP).
Les autorités administratives indépendantes (AAI), qui ne nous intéressent pas ici outre mesure, sont, elles, une création récente. La première, la CNIL (Commission nationale informatique et liberté) date de 1978. Les AAI répondent au désir de mettre en place des organismes de régulation autonomes dans le secteur des libertés publiques et de l’activité économique. Elle sont dépourvues de la personnalité juridique. Elle n’ont pas un pouvoir de gestion mais de décision ; elle échappent ainsi aux contrôles classiques, qu’ils soient de tutelle (puisqu’elles n’ont pas de personnalité juridique) ou hiérarchiques (puisqu’elles sont indépendantes). Cela pose le problème de leur compatibilité avec l’article 20 de la Constitution, au terme duquel "le gouvernement dispose de l’administration".
Mais l’administration n’est plus seulement dans l’administration : l’action administrative intègre aujourd’hui les personnes privées. Cette intégration prend deux formes.
En premier lieu, elle se matérialise par la collaboration des particuliers à des tâches d’intérêt général. Telle est l’origine de la formule de la CSP. Dès le milieu du XIXe siècle, l’administration a confié l’exécution de nombreux SP de caractère technique à des entrepreneurs privés qu’elle estimait mieux équipés qu’elle pour les assurer de façon satisfaisante.
Il est intéressant de noter que la CSP a connu une évolution inverse de celle de l’EP. Alors que l’EP s’est rapproché des personnes privées, la concession s’est intégrée davantage à l’administration. Ce que nous ne pouvons que déplorer.
A l’origine le concessionnaire était un entrepreneur qui assumait les profits et les risques d’une gestion capitaliste. L’administration du XIXe ne désirait pas se charger de l’exploitation des SP des chemins de fer, du gaz, de l’électricité, de l’eau, etc. (mais ces activités sont-elles des SP ?) car ces services exigeaient des investissements considérables et une compétence économique que l’État libéral ne reconnaissait pas. L’établissement de l’infrastructure et de l’exploitation du service étaient confiées à une société privée, l’administration se bornant à veiller à ce que le concessionnaire s’acquitte correctement de sa mission de gérant d’un SP. Entrepreneur privé, le concessionnaire avait droit au maintien de l’équilibre financier du contrat (théories de l’imprévision et du fait du prince, lesquelles allaient ensuite être étendues à tous les contrats administratifs). De même, le personnel du concessionnaire était un personnel de droit privé, et les contrats conclus par le concessionnaire avec les tiers et les usagers des contrats de droit commun. Cependant le concessionnaire était soumis à un étroit contrôle de la part de l’administration. Le contrat de concession comprenait, à côté de clauses purement contractuelles, des stipulations de caractère réglementaire, que l’administration pouvait modifier unilatéralement à tout moment (celles qui concernaient l’organisation et le fonctionnement du service). Le concessionnaire était aussi assujetti à l’obligation d’exécuter son contrat dans des conditions particulièrement strictes (continuité du service ; égalité de tous les usagers devant ce dernier ; ses agents eux-mêmes étaient astreints à un droit de grève soumis aux mêmes règles que celui des agents publics ; enfin les obligations du concessionnaire étaient sanctionnées de façon très sévère : mise sous séquestre, déchéance).
Ces règles continuent certes à s’appliquer, mais elles régissent aujourd’hui une réalité différente. Dans un premier temps, le concédant a été conduit à aider toujours davantage le concessionnaire sur le plan financier : la longue histoire des avances de l’État aux compagnies de chemin de fer (avant la création de la SNCF en 1937) en constitue la meilleure illustration. De plus, la CSP est accordée de plus en plus fréquemment à des organismes dont la forme juridique est certes celle d’une société anonyme, mais dont la majorité, voire la totalité du capital a été souscrite par des collectivités publiques ou dont le contrôle appartient en fait à l’État (cas de la SNCF jusqu’en 1982, ou des sociétés d’économie mixte, les SEM). Encore plus remarquable est l’octroi d’une concession, non plus à une entreprise même apparemment privée, mais à un véritable EP (EDF-GDF, les CCI concessionnaires d’installations portuaires ou d’aéroports). On frise ici l’absurde.
Mais cette association ne se limite pas à la concession. L’exploitation des transports en commun, d’activités scientifiques, hospitalières, culturelles, sportives ou éducatives marquent une véritable privatisation du SP. Ne confie-t-on pas à présent au secteur privé la construction de certaines autoroutes, le financement des télécommunications ou l’exploitation d’activités audiovisuelles ?
Alors l’administration a créé de toutes pièces des organismes de droit privé, voire parfois des organismes facticement privés, destinés à lui permettre d’accomplir sa mission.
Le principal cas de figure est celui de la SA (société anonyme). On a pu voir dans l’histoire de France des SA dont la totalité des actions appartiennent à l’État (sociétés de crédit et d’assurances nationalisées à la Libération). Il y a aussi bien sûr, nous l’avons dit, le cas des SEM. Mais il faut surtout noter que la formule de la SA sert aujourd’hui à rompre le cloisonnement administratif et à associer des collectivités publiques ou semi-publiques à une même tâche (grâce à la Caisse des dépôts et consignation, l’État est ainsi largement présent dans le secteur de l’équipement du territoire). Ces divers organismes créent de surcroît des filiales, qui les associent entre eux ou avec des entreprises privées, diluant toujours davantage la responsabilité des personnes publiques.
Lorsque l’administration agit par la création d’associations, ses motifs sont pour le moins obscurs. Pour acquérir la souplesse nécessaire à une action efficace, pour obtenir le concours des chefs d’entreprise dont la collaboration est parfois nécessaire, pour surmonter les obstacles posés par le statut de la fonction publique, ou pour obtenir la collaboration de fonctionnaires de plusieurs ministères, on crée une association. Plutôt que d’abroger des réglementations devenues néfastes, on préfère les tourner en faisant transiter l’action administrative par des organismes dont le caractère juridique permet d’échapper à tout contrôle et à toute contrainte et qui ne constituent pas autre chose qu’un prolongement déguisé de l’administration.
Enfin l’administration agit par la voie d’organismes innommés (CPAM-CRAM/CAF par exemple, ou les syndicats médicaux). Ce sont des sociétés mutualistes dont les relations avec les gens qui cotisent sont soumises au droit privé. Ce n’est qu’une espèce d’un genre qu’il faut bien nommer "indéterminé" : il existe ainsi des organismes dont on ne sait pas toujours s’ils sont des personnes publiques ou des personnes privées (CE, 1942, Monpeurt ; CE, 1943, Bouguen : les organismes de direction de l’économie et les organisations professionnelles ne sont pas des EP mais sont soumis en partie au droit privé et en partie au droit administratif. Ce n’est qu’en 1984 que le CE se prononcera sur leur caractère privé).
Bien sûr les raisons avancées pour justifier l’action administrative par personnes interposées ne sont pas sans valeur. Mais les inconvénients sont nombreux : l’action administrative devient difficile à cerner. De plus, le recours à la formule de la société ou de l’association est dans tous les cas ou presque (pour certaines SEM) une fiction. Il n’est donc guère surprenant que la distinction des personnes publiques et des personnes privées soit devenue insaisissable. Parmi les entreprises publiques, les unes ont un caractère d’EP (EDF, SNCF, Poste, France Telecom), d’autres celui de sociétés privées (sociétés de banques et d’assurances), d’autres enfin un statut indéterminé (Renault par exemple), sans que les formules retenues exercent une influence appréciable sur la réalité des rapports de ces entreprises avec l’administration.
La seule conclusion que l’on peut en tirer, c’est que le droit se prête à bien des contorsions, à bien des manipulations, de la part d’une puissance publique plus tutélaire que jamais par le nombre d’entités qu’elle contrôle, mais qui masque la lame de ses intentions sous un épais voile.
Diversification des moyens
Classiquement, l’action administrative était caractérisée par l’inégalité de condition entre l’administration et les administrés. Aujourd’hui, par moyens exorbitants du droit commun, on n’entend pas seulement des prérogatives, mais aussi des sujétions. D’ailleurs, l’administration utilise de moins en moins ces moyens exorbitants et abandonne souvent la " gestion publique " au profit de la " gestion privée ".
Rappelons tout d’abord l’essentiel : c’est par ses PPP (prérogatives de puissance publique), ses moyens exorbitants du droit commun, que l’action administrative se rattache au droit public, constitutionnel en particulier. Mais comme le souligne J. Rivéro, ces dérogations au droit commun ne jouent pas toujours dans le sens de l’administration : elle est astreinte à la poursuite du but précis assigné par la loi à chaque type de pouvoir. L’administration est assujettie à des règles sévères pour le recrutement des agents publics et le choix des cocontractants. L’exercice de sa compétence par une autorité administrative ne peut faire l’objet d’une renonciation ou d’une délégation.
Ainsi, s’il est vrai que l’action administrative utilise essentiellement la décision unilatérale, elle se manifeste de plus en plus par le procédé contractuel.
Dans l’acte administratif unilatéral (AAU) classique, il est capital de noter que l’administration peut modifier unilatéralement la situation juridique des administrés sans passer par le juge ; elle n’émet pas de simples prétentions, mais prend de véritables décisions. A contrario, un acte, même unilatéral, qui ne modifie pas l’ordonnancement juridique n’est pas une décision exécutoire (par exemple un vœu, une proposition, etc.). De même, des mesure d’ordre intérieur (MOI), des circulaires, des directives, qui ne concernent que le fonctionnement interne de l’administration, ne sont pas des AAU (hormis le cas où l’autorité administrative compétente a utilisé une de ces formes pour édicter en réalité une règle de droit nouvelle, le CE y voyant alors une véritable loi).
Cet AAU a deux prérogatives particulières :
![]() le privilège du préalable, qui signifie que la décision modifie immédiatement l’ordre juridique ;
le privilège du préalable, qui signifie que la décision modifie immédiatement l’ordre juridique ;
![]() le privilège de l’exécution d’office, qui permet à l’administration d’utiliser la force si le particulier n’exécute pas de bon gré ("Quand la maison brûle, on ne va pas demander au juge l’autorisation d’y envoyer les pompiers" disait Romieu).
le privilège de l’exécution d’office, qui permet à l’administration d’utiliser la force si le particulier n’exécute pas de bon gré ("Quand la maison brûle, on ne va pas demander au juge l’autorisation d’y envoyer les pompiers" disait Romieu).
La théorie de la décision exécutoire (ou AAU) recouvre aujourd’hui l’ensemble de l’action administrative, quelle que soit la nature juridique de l’organisme dont elle émane. Et elle comporte de nombreuses sujétions pour l’administration : la décision (individuelle créatrice de droits) devient intangible à l’expiration du délai de recours contentieux (2 mois), et l’administration ne pourrait plus la retirer - même si elle était illégale (principe d’intangibilité des décisions individuelles créatrices de droits). De plus les décisions (individuelles ou réglementaires) ne sont opposables qu’après leur notification ou publication.
C’est à cette théorie de la décision exécutoire que se rattachent plusieurs autres pouvoirs dont dispose l’administration : la pouvoir réglementaire en premier lieu. C’est la faculté de prendre des décisions exécutoires de caractère général et impersonnel. Ses titulaires sont multiples (l’article 21 de la Constitution en attribue le pouvoir au premier ministre, sous réserve de l’article 13C qui l’attribue au président de la République pour les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres). (Le préfet, le maire, les présidents de Conseils généraux/régionaux, et même différents organismes privés : les ordres professionnels, disposent également de ce pouvoir réglementaire). Mais bien entendu, en dehors de cette hypothèse, les ministres notamment ne disposent pas du pouvoir réglementaire (aussi les circulaires ministérielles comportant des dispositions réglementaires doivent-elles souvent être annulées par le juge administratif ; et nonobstant la reconnaissance par le CE d’un pouvoir d’orientation dont les ministres disposent, afin d’élaborer des directives indiquant comment l’administration entend exercer son pouvoir d’appréciation).
Le pouvoir réglementaire ne crée pas de droits acquis. Les administrés peuvent exiger de l’administration la modification de règlements ne correspondant plus à la situation actuelle. Enfin l’administration est tenue d’abroger à tout moment, à la demande d’un administré, tout règlement illégal (CE, Alitalia, 1989).
Un autre pouvoir dérivé de la théorie de la décision exécutoire est le pouvoir de police , auquel nous avons fait allusion plus haut. Il consiste en effet à limiter la libre action des particuliers par des décisions dont le but est d’assurer l’ordre public. Certaines restrictions sont prévues par la loi elle-même, mais l’administration peut aller au-delà (maire, président du CG/CR, préfet), en dehors du pouvoir détenu par le gouvernement de déterminer des mesures de police sur l’ensemble du territoire (CE, 1919, Labonne). Trois points sont à souligner :
L’autorité de police inférieure conserve la faculté de rendre plus contraignante les mesures prises par l’autorité supérieure (le maire pour le code de la route, ou le visa des films par exemple) ;
La notion d’ordre public doit être prise dans un sens extensif (ordre matériel, sécurité et salubrité publiques, mais aussi parfois la moralité ou l’esthétique) ;
Enfin la mesure de police n’a pas à être précédée du respect des droits de la défense. Donc elle n’est pas créatrice de droits et peut donc à tout moment être rapportée par l’administration.
Enfin le dernier pouvoir dérivé, quoique beaucoup moins connu, est la théorie des pouvoirs implicites. Le CE reconnaît en effet aux organes participant à l’action administrative les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Ainsi tout chef de service a le pouvoir de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous son autorité. Ou encore les ordres professionnels disposent des mêmes compétences. Enfin, le gouvernement lui-même doit veiller à ce qu’à toute époque les services publics soient en état de fonctionner (CE, 1950, Dehaene).
A côté de la décision exécutoire, l’administration agit également par contrat : elle passe aussi bien des contrats de droit privé, soumis aux règles du Code civil, que des contrats administratifs.
Au titre des prérogatives dont elle dispose, l’administration peut modifier unilatéralement les obligations du cocontractant en vue de les adapter aux nécessités du service public ; elle peut même mettre fin au contrat si les besoins du service l’exigent. Elle peut prononcer à l’égard du cocontractant négligent des sanctions, même non prévues au contrat, et ce sans constatation préalable de la faute par le juge : la décision exécutoire réapparaît ainsi au sein du contrat - devenu léonin.
En contrepartie l’administration a des sujétions, au premier rang desquelles le fait qu’elle ne dispose pas d’une compétence discrétionnaire pour choisir son cocontractant. D’autre part le cocontractant a droit, non seulement à la rémunération prévue, mais encore au rétablissement de l’équilibre financier du contrat. On rencontre ici les théories, propres aux contrats administratifs, du fait du prince (aggravation des charges du cocontractant par l’administration partie du contrat) et surtout de l’imprévision (bouleversement de l’économie du contrat par un fait extérieur aux parties : CE, 1916, Gaz de Bordeaux).
Aussi, à l’immuabilité et à la rigidité du contrat civil, s’oppose la mutabilité et la flexibilité du contrat administratif ; on ne peut que le regretter dans la mesure où cette flexibilité altère l’autorité de la signature des parties. Cependant, les choses se déroulent plutôt bien in concreto car, en cas de sujétions imprévues, le cocontractant de l’administration ne manque pas de bénéficier de ses indemnités ; la jurisprudence du Conseil d’Etat est à cet égard exemplaire.
D’autre part, l’administration a besoin, pour assumer ses missions, de collaborateurs qui exécutent les ordres du gouvernement et possèdent les qualités techniques et humaines nécessaires. Pour autant, elle doit assurer à ses collaborateurs une sécurité et une stabilité suffisantes. Ainsi la loi du 13 juillet 1983 fixe l’agent public dans un cadre légal et réglementaire. Il n’est pas uni à l’administration par un contrat ; ses droits et obligations sont définies par des règles impersonnelles et générales qui s’appliquent à tous les agents de sa catégorie. La nomination est un "acte-condition" portant application à l’intéressé de l’ensemble des règles régissant sa fonction. Il en résulte qu’un fonctionnaire n’a aucun droit acquis (individuel) au maintien de la réglementation en vigueur - ce qui, malgré tout, reste un atteinte au principe de sécurité avancé plus haut.
L’administration n’a pas de pouvoir discrétionnaire pour le recrutement de ses fonctionnaires. Elle doit en principe procéder au recrutement par voie de concours, sans tenir compte du sexe, de la religion, ou des opinions politiques des candidats. Mais le sacro-saint et hypocrite intérêt du service autorise de nombreuses dérogations à cette règle.
Par ailleurs, le fonctionnaire doit pouvoir compter sur le déroulement normal de sa carrière, laquelle est scindée en corps, grades et emplois. A ce titre, il a droit à une rémunération, c’est-à-dire à un traitement prolongé par une pension de retraite, fixés par les lois et règlements.
Enfin, le fonctionnaire demeure celui que Hauriou nommait un "citoyen spécial" : il a bien sûr droit à la liberté de conscience, à la liberté d’expression aussi (neutralité dans l’exécution du service, liberté au dehors, mais à condition de ne pas entraver, par son attitude, le fonctionnement normal du SP), à la liberté syndicale (la représentation des syndicats est quatre fois plus forte dans le public que dans le privé), et au droit de grève (principe de valeur constitutionnelle, mais auquel le législateur peut apporter les limitations nécessaires en vue d’assurer la continuité du SP - qui est aussi un principe à valeur constitutionnelle).
Hormis le droit de la fonction publique, un autre régime exorbitant du droit commun est celui des biens. Surtout lors de leur acquisition : l’administration peut en effet user de l’expropriation par exemple. Citons aussi le cas moins connu de la procédure de l’élargissement (les propriétés privées non bâties incluses dans le nouveau tracé d’une voie sont immédiatement incorporées au domaine ; les propriétés bâties sont frappées de la servitude de reculement, qui interdit les travaux confortatifs afin de ne pas retarder le moment où l’immeuble sera détruit et où le terrain pourra être incorporé à la voie).
Plus généralement, en raison de son affectation à l’utilité générale, le domaine public est soumis à un régime de protection exorbitant du droit commun. Il en découle l’impossibilité pour les particuliers d’acquérir une parcelle du domaine public par voie de prescription, et l’existence au profit de l’administration d’un pouvoir de police pour assurer la conservation du domaine. Un principe majeur, et particulièrement lourd pour l’administration, est celui de l’indisponibilité : sauf désaffectation préalable, toute vente d’une parcelle du domaine public est entachée de nullité. Enfin, toute autorisation d’utilisation du domaine public est précaire ; serait-elle même accordée par un contrat qu’elle serait encore sujette à résiliation à n’importe quel moment, car tout contrat portant occupation du domaine public est un contrat administratif par détermination de la loi.
Similaire est le cas des travaux publics, dans la mesure où les marchés passés par l’administration sont des contrats administratifs. L’administration a un pouvoir de direction et de contrôle particulièrement strict (les ordres de service). Par ailleurs, l’exécutant d’un travail public a un droit d’occupation temporaire qui lui permet, par autorisation préfectorale, d’occuper temporairement des propriétés privées voisines d’un chantier pour y entreposer sont matériel par exemple. On ne peut que déplorer cette atteinte la plupart du temps inutile à la propriété privée, au demeurant fort imprévisible car dépendant du gré et des humeurs d’un préfet, juge et partie.
Enfin un principe juridictionnel interdit au juge, tant judiciaire qu’administratif, d’ordonner la destruction d’un ouvrage public irrégulièrement bâti, fût-ce sur une propriété privée. Or un propriétaire privé qui bâtit une construction et qui voit son permis de construire annulé par le juge administratif doit, lui, démolir sa construction. Alors même que la faute à l’origine de cette annulation incombe à l’autorité qui a signé le permis de construire (en général, le maire). Cette asymétrie n’est pas du tout justifiée, ou plus exactement ne l’est que pour certains ouvrages publics (un sens giratoire, par exemple), mais pas pour un bâtiment public.
Heureusement, l’administration a des sujétions en regard à ce telles prérogatives. Elle doit réparation, même en l’absence de faute, de tous les dommages causés à des tiers par l’exécution du travail public, ainsi que par l’existence et le fonctionnement d’un ouvrage public. Cette responsabilité sans faute présente l’avancée majeure et la plus positive du droit administratif.
Quant aux dommages causés aux usagers, l’administration ne peut dégager sa responsabilité qu’en établissant qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage.
Plus généralement, la diversification des moyens qu’utilise l’administration passe par une distinction classique entre gestion publique et gestion privée. La doctrine du XIXe établissait une correspondance parfaite entre gestion par l’administration d’un SP et l’application d’un régime exorbitant du droit commun. La jurisprudence a considérablement modifié cette approche : dès 1873, le Commissaire du gouvernement David admettait devant le Tribunal des conflits (TC) que le droit privé retrouverait son empire lorsque l’Etat n’agirait pas comme "puissance publique", mais comme "personne civile capable de s’obliger par des contrats dans les termes du droit commun". En 1912, l’arrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges vint consacrer définitivement la possibilité pour une collectivité publique de passer des contrats dans les conditions du droit commun.
Ainsi se trouvait établie en droit positif la distinction entre la gestion administrative ou publique et la gestion privée de l’administration. Il était désormais admis qu’une collectivité publique pouvait renoncer à l’emploi de mesures exorbitantes du droit commun pour "se mettre en civil". Même constatation pour le personnel, les biens et les travaux.
Cela est vrai également des services publics gérés par des personnes privées : un organisme privé investi d’une mission de service public (MSP) utilise, ou non, selon le cas, les PPP. La diversification des moyens se cumule, on le constate, avec la dispersion des organes.
A la notion de gestion privée dans les SP s’est ajoutée, depuis 1921, celle de SP soumis entièrement au régime du droit privé. Il s’agit de personnes, publiques ou privées, gérant des SPIC (Services publics à caractère industriel et commercial) dans les termes du droit commun. Ces services peuvent être exploités soit par des sociétés privées concessionnaires (concessions de transports urbains), soit par des EPIC (EP à caractère industriel et commercial, tels que la SNCF ou EDF), soit même en régie (régies municipales d’eau - ce qui est très fort). La différence est considérable avec la gestion privée dans les SP : ce ne sont plus des actes ou activités isolés qui cessent de revêtir un caractère exorbitant, mais des activités globales. Aussi la jurisprudence a tenté de mettre un frein aux débordements : le caractère industriel et commercial a été dénié à des activités auxquelles on le reconnaissait auparavant ; des aspects toujours plus nombreux des SPIC ont été soumis au droit public (par exemple, est une décision administrative la disposition du règlement du personnel d’Air France - SPIC géré par une personne privée - obligeant les hôtesses de l’air à quitter le service en cas de mariage).
En général le choix entre la gestion publique et la gestion privée est laissée à l’administration. Parfois c’est la loi qui dicte à l’administration les moyens à employer. Mais le plus souvent c’est le juge qui décide que, quelle que soit l’intention de l’administration, la nature de l’acte ou de l’activité implique soit le régime exorbitant, soit le régime de droit commun. La jurisprudence tend ainsi à freiner la tendance à une soumission excessive de l’action publique au droit privé.
3. La gradation des fins
Ceci nous amène tout naturellement à nous interroger sur ce qu’il faut entendre par SP et AIG (activité d’intérêt général). En fait, la notion de SP a à la fois un sens matériel (une activité d’intérêt général), et un sens organique (prise en mains par les pouvoirs publics). La doctrine classique, comme on peut s’en douter, établissait une concordance parfaite entre la conception matérielle et la conception organique du SP. Mais à partir du moment où l’on admit que les particuliers pouvaient être appelés à collaborer à des tâches d’intérêt général, la notion matérielle du SP devait l’emporter, et le SP tendait dès lors à devenir synonyme d’AIG.
Or, rien n’est plus malaisé que de définir un SP au sens matériel du terme. En fait, il faut ajouter quelque chose à la notion d’intérêt général, qui constitue certes un élément nécessaire à la notion de SP, mais ne saurait en constituer un élément suffisant.
Ainsi le plus souvent le juge s’attache au caractère plus ou moins important, ou prééminent, du but visé. C’est une appréciation subjective, variant selon l’époque et le l’état des mœurs. Il est intéressant de savoir qu’un théâtre, un stade, une piscine ou un remonte-pente, ou l’organisation d’un festival de BD n’étaient pas considérés à l’origine comme un SP. Le résultat de cette appréciation subjective est parfois inattendu : le CE reconnaît le caractère de SP au tir d’un feu d’artifice lors d’une fête communale, mais le refuse à l’organisation d’une course de chevaux faite à la même occasion par exemple. L’exploitation des ressources hydrauliques est considérée comme un SP, mais non celle des ressources minières ou pétrolières ; et les exemples du même ordre sont nombreux.
A côté de ces activités de "plus grand service", assurées dans l’intérêt direct des administrés, les activités de "plus grand profit" assurées dans l’intérêt propre de l’organisation qui les exerce (selon Chapus) constituent une catégorie de SP non négligeable. Une jurisprudence traditionnelle, mais largement critiquée, refuse cependant le caractère de SP à la gestion par les collectivités publiques de leur domaine privé.
Le juge utilise - tout de même - des indices plus ou moins précis : la circonstance que le législateur a prévu pour l’existence de l’activité litigieuse un REDC est un signe tangible de l’importance qu’il y attache ; ou encore la soumission d’un organisme chargé d’une activité générale à un contrôle étroit de l’administration est un signe sinon déterminant, du moins précieux, pour le juge.
Une activité prise en charge par une personne publique est présumée constituer un SP, alors que la présomption inverse joue pour les activités exercées par des organismes privés : celles-ci ne revêtent donc le caractère de SP que si des indices précis jouent en ce sens (p. ex. l’origine de l’institution, l’octroi de PPP, sa soumission au contrôle de l’administration, son AIG). L’élément organique se révèle donc un facteur déterminant de la définition du SP matériel.
Dans certains cas enfin, le législateur prend expressément position : le secteur privé aussi bien que le secteur public de la consommation audiovisuelle constitue un SP au sens matériel du terme ; de même, c’est la loi qui définit comme un SP l’exploitation du transport ferroviaire par la SNCF. Ces choix sont contestables, mais ils ont le mérite de la clarté.
Il s’établit ainsi une gradation dans les fins de l’action administrative. Certaines méritent le titre de SP, d’autres constituent seulement des AIG. La notion de SP est donc plus étroite que celle d’AIG. Et la distinction joue indépendamment de la nature de l’organisme chargé de l’activité en cause. Par exemple, la gestion du domaine privé ou l’entretien des églises par les collectivités publiques sont de simples AIG ; l’exploitation d’une installation sportive ou d’une colonie de vacances constitue un SP. Même distinction pour l’activité des EP : les hôpitaux, les universités, EDF, etc., gèrent des SP ; les Charbonnages de France exercent seulement une AIG.
La distinction n’est pas sans valeur, car l’AIG se distingue du SP par un régime juridique différent.
D’une part, ce n’est que lorsqu’ils gèrent des SP proprement dit que les organismes privés peuvent prendre des décisions ayant un caractère administratif et que leur responsabilité peut être engagée devant le juge administratif. Ainsi la décision d’une fédération de tennis relative à l’homologation des balles a un caractère administratif, car cette fédération gère un SP, à la différence du règlement intérieur d’un comité économique agricole - lequel remplit une simple mission d’intérêt général.
De plus, certaines règles s’appliquent aux seuls SP : il s’agit des fameuses lois de Rolland (continuité, égalité, adaptation, à quoi l’on peut ajouter la neutralité).
Enfin, rappelons que les AIG demeurent malgré tout distinctes à bien des égards des activités d’intérêt privé. Un organisme privé d’intérêt général peut bénéficier de certaines PPP (expropriation par exemple), et être soumis à certains contrôles. La gestion du domaine privé des collectivités publiques est elle-même caractérisée par différents éléments exorbitants du droit de la propriété privée - et si l’on ne veut aller jusqu’à y voir un SPA, on doit au moins lui reconnaître le caractère d’une AIG.
 Contrepoints
Contrepoints