Accueil > Argumentaires > Édito > Une débâcle budgétaire programmée
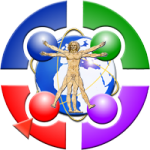 Une débâcle budgétaire programmée
Une débâcle budgétaire programmée
dimanche 14 avril 2002
Il conçoit son action comme si la crise bel et bien ouverte dans le monde atlantique du capitalisme financier façon Wall Street, mais à laquelle l’Etat français a prêté main forte via France Télécom et sa complaisance vis-à-vis des grands groupes (chacun d’eux constitue un lobby), n’appelait de sa part aucune mesure de sauvegarde.
L’absence de décisions claires et courageuses a certainement quelque chose à voir avec le parti pris par l’Elysée. Parmi les consultations électorales du printemps, il a décidé que la plus importante est non pas le résultat des élections législatives, mais celui du deuxième tour de l’élection présidentielle. Aucun message clair ne s’en dégage, sinon celui d’un consensus contraint et équivoque, ô combien contingent, dénué de tout contenu transposable en programme de gouvernement.
La confusion et l’arrogance de l’élite dirigeante sont telles que seul l’exercice effectif de la démocratie pourrait, du moins on doit l’espérer, la mettre en échec. En voici une flagrante illustration : pour parer aux effets négatifs les plus visibles de la politique dite « sociale » (par exemple le RMIste, à la faveur de l’allocation logement et de la CMU, « gagnant » plus et étant désormais beaucoup mieux protégé contre la maladie que le smicard !), l’élite de gauche comme de droite ne trouve rien de mieux qu’une mesure aussi technocratique, aussi artificielle et aussi contraire à la dignité des salariés que la prime pour l’emploi. Cela dispense gouvernants et patronat de réfléchir sérieusement sur une politique viable de revalorisation des salaires, compatible avec leurs intérêts. Le pouvoir politique a bien décidé un alignement rapide par le haut du SMIC. Mais ce relèvement est-il compatible avec son option budgétaire qui fait peser sur l’appareil productif d’énormes charges ?
La société française dans son ensemble se refuse à une évidence qui va contre les préjugés enseignés comme vérité. Choisir entre d’une part une politique visant à l’équilibre comme une chose bonne en soi - malheureusement, le Pacte de stabilité en faisait un pensum : on a les symboles qu’on mérite ! - et d’autre part le genre de politique annoncée par MM. Raffarin et Mer, et qui consiste à continuer de sacraliser au nom de la croissance la dépense publique, comporte un enjeu politique de première grandeur.
L’option qui va dans le sens de la pente descendante, c’est la politique de perpétuation du déficit. Aux politiciens, elle confère de facto le pouvoir quasi discrétionnaire de corriger par des dispositions technocratiques et onéreuses leurs propres erreurs. En vertu de quel miracle les politiciens trouvent-ils les ressources pour échafauder, sur le socle de l’économie réelle et productive, des superstructures de plus en plus étouffantes ? Elles leur sont procurées par les facilités infinies et apparemment indolores - jusqu’au jour où il en résulte une remontée dévastatrice des taux d’intérêt - que donne le recours discret, aux yeux du grand public en tout cas, aux emprunts du Trésor sur le marché. Selon le projet de loi de Finances en cours de discussion, plus de 16 % des dépenses de l’Etat seront financés de cette façon en 2003. On s’est habitué à cet ordre de pourcentage. Il est considérable. La dette publique accumulée qui en résulte forme vite, ce qui est le cas, une masse supérieure à la capitalisation de toutes sociétés opérant sur le territoire national. En 1974, elle était pratiquement nulle.
L’option alternative, et que le monde développé ne connaît plus depuis 1974, l’année de tous les bouleversements - la fin du plein-emploi à temps complet, le début des mouvements erratiques de capitaux sur toute la planète, le monde communiste de l’époque n’y échappant pas lui-même, via des prêts bancaires massifs... -, c’est la gestion des finances publiques sur le modèle d’une économie domestique. A ceci près que l’arbitrage incessant entre dépenses et recettes, ces dernières provenant presque exclusivement de l’impôt, place le pouvoir politique devant toutes ces responsabilités tant à l’égard de ceux qui reçoivent que de ceux qui payent : gouvernement qui propose et Parlement qui dispose. Bref, un ordre économique et financier incomparablement plus démocratique en dépit des apparences, et aussi beaucoup moins bousculé. Par excellence, la matière première de l’économie spéculative, ce sont les titres de la dette publique.
Je ne dis pas qu’il suffirait de rétablir l’équilibre budgétaire, comme l’ont fait la Grande-Bretagne, la Suède, la Finlande et d’autres pays du Nord, mais aussi l’Espagne, pour faire de la zone euro une zone de relative stabilité. Mais, c’est à coup sûr une condition nécessaire.
La théorie au nom de laquelle la dépense déficitaire (« deficit spending ») doit prendre le relais des investissements privés défaillants continue de jouir d’un prestige incompréhensible, à moins de se satisfaire de l’argument d’autorité (celle de Keynes en l’occurrence). Pour deux raisons au moins, il convient de la critiquer. D’abord, parce que l’emprunt public, même indolore, n’est pas anodin. En empruntant, on soustrait des ressources au prêteur. De ce point de vue, l’effet de l’emprunt est le même que celui de l’impôt. Ensuite, parce que la dette, une fois accumulée, a sa propre dynamique. Dans beaucoup de circonstances, cette dynamique peut annuler, et bien au-delà, les retombées, supposées bénéfiques, de la dépense publique. En période de turbulence des marchés et de récession, les épargnants recherchent désespérément la sécurité. Le Trésor la leur offre sous forme de titres d’emprunt portant sa signature. Que resterait-il de disponible pour l’investissement dans une activité économique, autrement plus risquée ? On le voit bien au Japon.
Le gouvernement Jospin, comme chacun sait, a eu, à dix ans de distance, le même réflexe que celui de Michel Rocard (1988-1991). Dans les deux cas, des rentrées fiscales considérables et inattendues n’ont pas été affectées à la diminution de la dette. Elles ont financé des dépenses nouvelles ou certains allégements fiscaux. Aussi bien en 2001 qu’en 1990, la France a ainsi abordé le renversement de conjoncture avec des finances publiques dégradées en profondeur. Dès le deuxième semestre 1990, et cela jusqu’en 1995, les prévisions de croissance économique ont été grossièrement surévaluées.
Pour 1991, la loi de Finances tablait sur une progression de 2,7 %, on réalisa 0,8 % ; pour 1993, on avait prévu 2,6 %, l’activité fut en recul (- 1,4 %). A telles enseignes qu’il est arrivé qu’on se trompe de plus du simple au double sur la prévision du déficit ! Une des raisons aura été ce que certains auteurs ont appelé la « porosité croissante entre le budget de l’Etat et les régimes sociaux ». Sur ce terrain, l’héritage laissé par la gauche plurielle aggrave très fortement la vulnérabilité des finances publiques. La CMU, l’APA (allocation personnalisée d’autonomie), mais aussi les 35 heures, même amendées, sont, du point de vue budgétaire notamment, autant de facteurs d’explosion.
 Contrepoints
Contrepoints