Accueil > Politique > Actualité politique > Les gardes-chiourme de la démocratie sociale
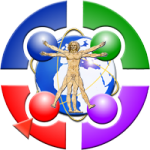 Les gardes-chiourme de la démocratie sociale
Les gardes-chiourme de la démocratie sociale
dimanche 14 avril 2002
Propos recueillis par Joseph Macé-Scaron et Alexis Lacroix
[14 novembre 2002]
LE FIGARO. – Qu’est-ce qui a changé dans le paysage intellectuel français ?
La haine a renversé toutes les digues. Deux exemples : dans Le Rappel à l’ordre, un livre publié par les éditions du Seuil, à l’enseigne de la « République des idées », collection que dirige Pierre Rosanvallon, professeur au Collège de France et président du Centre Raymond-Aron, Daniel Lindenberg, membre du comité de rédaction de la revue Esprit, vient de m’apprendre, non seulement que j’étais un fieffé réactionnaire – y a-t-il d’ailleurs des réactionnaires qui ne soient pas fieffés ? –, mais qu’avec Régis Debray, Pierre Manent, Pierre-André Taguieff, Marcel Gauchet, Philippe Muray, Maurice Dantec, Michel Houellebecq, Shmuel Trigano et quelques autres, j’avais préparé la catastrophe du 21 avril, c’est-à-dire la présence de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de l’élection présidentielle, et qu’en trouvant à redire à la culture de masse, à l’idéologie des droits de l’homme, à mai 68, à l’omniprésente apologie du métissage, je m’inscrivais dans la lignée de ces intellectuels qui, au temps de la peste brune, se déchaînaient contre les métèques et les valeurs de la démocratie. Comme un bonheur ne vient jamais seul, je découvre dans Le Monde diplomatique, sous la signature de Maurice T. Maschino, qu’en compagnie cette fois de Pascal Bruckner, d’André Glucksmann, de Pierre Nora, de Jacques Julliard, de Bernard-Henri Lévy, je suis un « nouveau réactionnaire », c’est-à-dire un suppôt de l’empire israélo-américain.
Le retour tonitruant de la catégorie de « réac » signifie que la parenthèse antitotalitaire se ferme. De son aile radicale à son extrême centre, l’intelligentsia engagée militarise la vie de l’esprit. Il n’y a plus d’oeuvre singulière, il y a deux camps – l’humanité et ses ennemis.
Comment expliquez-vous ce retour apparent à la pensée binaire – pour autant que cette dernière ait jamais cessé de se déployer ?
Depuis la Révolution, les adolescents et les intellectuels sont perpétuellement tentés de concevoir la politique comme la poursuite de la guerre par les moyens de l’injure.
Daniel Lindenberg cependant innove : à l’encontre des robespierristes classiques, il frappe d’infamie les détracteurs de l’état des choses et non ses partisans. Son titre est son programme : il rappelle à l’ordre les geignards, les grincheux, les inquiets, tous ceux à qui on n’a pas su faire aimer l’an 2000 et qui souffrent du monde tel qu’il va.
Camus disait :
« Le démocrate est modeste, car il est celui qui admet qu’un adversaire puisse avoir raison, qui le laisse donc s’exprimer, et qui accepte de réfléchir à ses arguments. »
Mais le démocrate a laissé place au démocratiste. Pour celui-ci, la démocratie n’est pas une scène où s’échangent des opinions ; c’est un mouvement irrésistible : incarnant l’histoire en marche, le démocratiste s’indigne de rencontrer tant de momies, tant de rebuts, tant de vestiges de l’Ancien Régime parmi ses contemporains. A défaut de pouvoir leur couper la tête, il leur fait savoir qu’ils devraient être morts.
En confondant réactivité du penseur et pensée réactionnaire, cette position ne pèche-t-elle pas par anti-intellectualisme ?
Les robespierristes de toutes obédiences tiennent le président américain pour un imbécile heureux parce qu’il a dénoncé l’« axe du Mal », alors même qu’ils évoluent dans un espace à deux dimensions et qu’ils considèrent ceux qui ont des idées adverses comme des scélérats, destinés à remplir, au plus vite, les poubelles de l’histoire.
Aujourd’hui il y a une nouveauté : Robespierre semble descendre en droite ligne de la famille antitotalitaire...
Dans la liste de suspects que dresse l’auteur-épurateur du Rappel à l’ordre, un nom manque, et cette absence est assourdissante. C’est le nom de Paul Thibaud, coupable de tous les péchés (souverainisme, anti-soixante-huitardisme, critique du droit-de-l’hommisme, défense vieux jeu de l’école républicaine et j’en passe), mais ancien directeur de la revue Esprit ; gracieux jusqu’au bout, le livre de Lindenberg est un parricide qui ne s’avoue pas. Je compte quelques amis chers dans cette revue. J’espère pouvoir m’expliquer avec eux et leur demander ce qui leur reste de la pensée antitotalitaire et de son refus de réduire la pluralité humaine au schéma manichéen d’une lutte entre le Bien et le fascisme, jamais plus vivant que depuis qu’il a été vaincu.
Orwell n’avait-il pas raison de déplorer que la gauche fût toujours antifasciste, mais rarement antitotalitaire ?
Aujourd’hui, ce n’est plus au profit de Staline et des staliniens, c’est au bénéfice d’une démocratie postnationale, propre sur elle, indemne d’histoire et de géographie, pure de toute composante atavique et héréditaire, qu’on oublie que les antifascistes les plus conséquents qu’il y ait eu en Europe sont deux personnages très enracinés, deux patriotes ombrageux et de surcroît conservateurs : de Gaulle, Churchill. Le jour est proche où l’on découvrira ce qu’il y a de pétainiste chez de Gaulle – et, tant qu’on y est, de lepéniste chez Churchill. Que faire en outre de Kundera, ce romancier certes cosmopolite mais qui, dans sa préface à Miracle en Bohême de Josef Skvorecki, a le front d’opposer le printemps de Prague, révolte populaire des modérés, explosion de scepticisme postrévolutionnaire, à l’explosion de radicalité lyrique et juvénile du mai parisien ? Et Raymond Aron lui- même, avec ses considérations désobligeantes sur le mouvement étudiant, est-il vraiment du bon côté de la barrière ? Peut-être faudrait-il rebaptiser Institut Guy-Debord le centre qui porte son nom. Ce n’est qu’un début : l’épuration continue.
Il est interdit d’interdire, mais il est un domaine qui doit échapper par définition à toute critique : mai 68. La mémoire de cet événement n’est-elle pas, au fond, notre dernier tabou ?
Mai 68 a tout désacralisé sauf mai 68. Ce temple a désormais ses gardiens sourcilleux qui ne tolèrent pas le plus petit dissentiment, qui mettent à l’index l’irrévérence et le sarcasme. Gare aux chevaliers de la Barre qui refusent de plier le genou au passage de leurs parades et de leurs processions !
Rien n’est plus comique que le spectacle de cette dévotion pontifiante à l’esprit de révolte ; une bien-pensance est née dont les fidèles nous expliquent que, jusqu’en avril 1968, la France était un pays raciste, xénophobe, misogyne où, à l’abri des hauts murs des lycées-casernes, les professeurs torturaient les enfants à coups de règle en fer et de violence symbolique. A en croire ces incontestables contestataires, mai nous a simultanément délivrés du Moyen Âge, du XIXe siècle, de l’Occupation, de l’esclavage et de l’apartheid scolaires. Cette légende est parfaitement ridicule : tout en gardant de ce moment intense un souvenir ému, je sais que s’est alors cristallisée une confusion dévastatrice entre le pouvoir et l’autorité, entre le maître qui conquiert et celui qui enseigne.
Comme dit Hannah Arendt, la mère de tous les fascismes,
« l’autorité a été abolie par les adultes et cela ne peut signifier qu’une chose – que les adultes refusent d’assumer la responsabilité du monde dans lequel ils ont placé les enfants ».
Dans le noyau de la pensée 68, on trouve, à la fin, une délégitimation de l’autorité et un goût prononcé pour le pouvoir... D’où vient cet étrange alliage ?
Mai 68 n’a pas été une révolution, mais plutôt un adieu, formulé dans les termes de la révolution, à la révolution même, ou, pour le dire avec les mots de Levinas (lors d’un entretien publié par Esprit),
« une dernière accolade à la justice humaine, au bonheur et à la perfection après l’apparition de la vérité que l’idéal communiste avait dégénéré en bureaucratie totalitaire ».
Tout cependant n’a pas été perdu. 68 a gardé et nous a légué quelque chose de l’idée révolutionnaire : la haine des ancêtres, l’esprit de la table rase. Un des lieux communs de l’heure est qu’à l’exception de ce qui préfigure le bel aujourd’hui démocratique, notre histoire nationale est un long cortège de crimes.
Et nous ne sommes pas seuls en cause : toutes les patries charnelles sont maintenant sommées par l’antiracisme de se dissoudre dans le village global (nommé par anti phrase : « société ouverte »). Si le passé est invoqué, c’est toujours pour montrer son abjection ou, au moins, son imperfection. Imbu de sa supériorité morale, le présent ne transmet plus que lui-même. Voilà pourquoi notre enseignement est devenu si bête.
La définition de l’intellectuel n’est-elle pas, d’ailleurs, en train de changer, comme en témoigne la lecture la plus courante du conflit israélo-palestinien ?
La brutalisation de la vie intellectuelle est une retombée de la guerre israélo-palestinienne. Dans Dissent, une revue de gauche américaine, le philosophe Michael Walzer écrit qu’il y a quatre guerres en une au Proche-Orient : celle qu’à travers le terrorisme des Palestiniens mènent pour la destruction d’Israël, le combat palestinien pour un Etat à côté d’Israël, la guerre d’Israël pour sa sécurité et la guerre que mènent certains Israéliens pour maintenir les implantations ou annexer tout ou partie de la Cisjordanie. Cette complexité n’a pas sa place en France. Dans sa version tiers-mondiste comme dans sa version molle, la gauche intellectuelle nous explique que les terroristes agissent par désespoir et qu’il n’y a qu’une seule guerre, l’affrontement d’un peuple épris de liberté et d’une puissance coloniale.
L’Europe ne se sépare-t-elle pas de l’Amérique sur ce point ? Pourquoi semble-t-il y avoir aux Etats-Unis plus de place pour une gauche qui fasse droit au sens des nuances ?
Je ne sais pas. Mais je constate avec effroi qu’ici, chez nous, il apparaît légitime, intéressant, utile au débat, digne de la république des idées, conforme aux usages de la discussion civilisée en vigueur au Centre Aron, compatible avec le souci de la vérité qui habite le Collège de France, de « se la jouer antifasciste » en annonçant le retour du mal idéologique suprême et en ajoutant par surcroît à celui-ci une dimension juive. When Jews turn right, écrit Lindenberg : quand les Juifs viennent grossir les bataillons de la nouvelle offensive maurrassienne...
Justement. L’auteur du Rappel à l’ordre montre du doigt les intellectuels juifs « dénonçant avec une assurance qui ne laisse guère de place au doute ou à la contradiction une « vague d’antisémi tisme » dont la réalité, en tant que telle, reste pourtant sujette à caution ». Qu’en pensez-vous ?
Les agressions judéophobes et les synagogues qui flambent n’étant plus imputables à la bonne vieille extrême droite et aux Dupont-Lajoie que les progressistes aiment tant détester, on met en doute, de José Bové à Daniel Lindenberg, la réalité, la quantité, la gravité de ces événements. Et quand on reconnaît leur existence, c’est pour y voir une réaction certes un peu nerveuse, mais compréhensible, aux images quotidiennes de la violence des Israéliens. Il se répand dans notre pays une haine d’autant plus inquiétante qu’elle est inculpabilisable : on a cessé de reprocher aux Juifs d’être juifs et de menacer l’identité nationale, on leur en veut de ne plus être juifs et d’avoir déserté la place de l’Autre pour celle du bourreau ou de son complice.
N’est-il pas surprenant que les hommes politiques de gauche se montrent plus disposés que beaucoup d’intellectuels à dénoncer les positions antirépublicaines d’un certain nombre de représentants de l’islam ?
Il ne faut pas se lasser de dire que la catégorie de « réactionnaire » est totalement fictive. A l’ennemi aux mille visages, Lindenberg fait grief d’avoir dénoncé, en 1999, l’intervention de l’Otan en ex-Yougoslavie. Or, dès novembre 1991, pendant le siège de Vukovar, à une époque où sévissait partout l’indifférence à ce combat de nègres dans un tunnel, j’ai pris position contre l’agression serbe et plaidé pour une action énergique de la communauté internationale. Mais les différences de sensibilité n’empêchent pas les convergences ponctuelles.
En 1989 j’ai écrit, avec Régis Debray, Catherine Kintzler, Elisabeth de Fontenay et Elisabeth Badinter un manifeste contre le foulard islamique à l’école. Avant de saisir le Conseil d’Etat, le ministre Lionel Jospin pensait que tout devait être fait pour convaincre les jeunes filles d’abandonner le foulard et que, si celles-ci s’obstinaient, il fallait prendre acte de ce refus, et céder. Cette négociabilité des principes nous semblait dangereuse, et d’abord pour ces jeunes filles.
Daniel Lindenberg a beau nous accuser de rejeter l’islam et de succomber au racisme, je ne crois pas que la suite des événements nous ait donné tort : il n’y a pas de pire hospitalité que celle qui n’a que son ouverture à offrir, et il n’y a pas de réponse plus désastreuse à l’intégrisme musulman que la « shame pride » comme dit Philippe Muray mon compagnon de galère, d’une France narcissiquement installée dans la honte et le dénigrement de soi.
 Contrepoints
Contrepoints
Messages
1. Les gardes-chiourme de la d, 15 novembre 2008, 10:50
cette article est precis mais je n ai pas compris , ca veut dire quoi chiourme ?